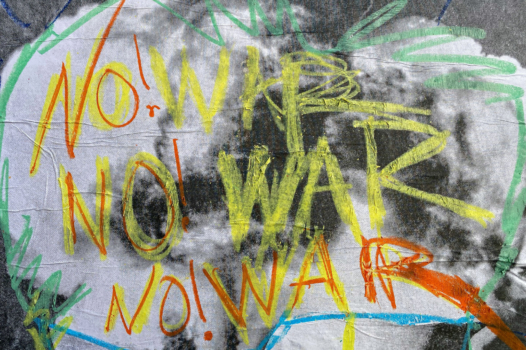Tous feux, tout flambe
Les incendies en France et sur le pourtour méditerranéen, chaque été ou presque, sont l’une des conséquences du réchauffement climatique, mais plus encore peut-être du mode d’appropriation et d’exploitation des forêts.
dans l’hebdo N° 1879 Acheter ce numéro

Les feux de forêt par temps de canicule sont devenus une chronique estivale récurrente, avec une ampleur croissante. En 2022, c’était la lande sud-girondine, avec un pic à La Teste-de-Buch autour de la dune du Pyla, qui s’enflammait. Cette année, c’était le tour de l’Aude et son massif des Corbières. Ces deux sinistres, comme ceux dans les pays du pourtour méditerranéen, sont bien sûr l’une des conséquences du réchauffement climatique, mais plus encore peut-être du mode d’appropriation et d’exploitation des forêts.
La transformation du modèle productif a des conséquences redoutables.
Bien que géographiquement très différentes, la Gironde, un plat pays couvert essentiellement de pins maritimes, et l’Aude, un arrière-pays accidenté où prédomine la garrigue, ont deux massifs forestiers qui présentent des ressemblances propices à la propagation très rapide des incendies. Les Corbières connaissent un embroussaillement croissant qui constitue un combustible facilement inflammable. Sa première cause est le recul du pastoralisme : le bétail ne nettoie plus la garrigue et les hommes au travail ne l’y habitent ni ne la parcourent plus. S’ajoutent à cela le recul de la vigne et le retrait des viticulteurs qui entretenaient les alentours.
Dans les Landes de Gascogne, mêmes causes, mêmes effets : disparition du pastoralisme d’antan (les bergers sur leurs échasses ne se voient plus que dans les fêtes de village), là aussi embroussaillement progressif de la forêt. Et la transformation du modèle productif a des conséquences redoutables : l’activité de gemmage abandonnée à partir de la décennie 1960, pour laquelle une main-d’œuvre considérable était nécessaire pour recueillir la résine sur chaque pin et donc entretenir chaque parcelle, a fait place à une production quasi exclusive de bois, destinée surtout à fabriquer pâte à papier et carton d’emballage.
La financiarisation de la forêt va de pair avec le productivisme forestier.
Les trois quarts de la forêt française appartiennent à des propriétaires privés. La gestion collective en est rendue difficile. Certes, la forêt de La Teste-de-Buch est restée depuis le XVe siècle une forêt « d’usage » où chacun peut couper du bois pour sa consommation. Mais la déprise agricole et l’exode rural facilitent le délaissement des parcelles et leur regroupement, car leur éparpillement est vu comme un obstacle à l’exploitation. Ce droit d’usage tombe donc en désuétude.
La loi du 10 juillet 2023 pour prévenir le risque incendie encourage les propriétaires à souscrire à un compte d’investissement forestier et d’assurance qui donne droit, pour l’épargne qui y est placée, à une défiscalisation de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Pour les compagnies d’assurances, l’enjeu est de développer un marché du risque climatique. Et pour les grandes entreprises à la recherche de crédits carbone, c’est… « pin » bénit. Par exemple, Orange a signé un contrat en 2021 avec la coopérative privée Alliance forêt bois pour acheter des crédits carbone afin de compenser le surplus de carbone qu’elle émet. En devenant le support d’actifs financiers, la forêt entre ainsi dans la logique mortifère du capitalisme.
Le mode d’appropriation et le mode d’exploitation de la forêt qui prédominent montrent que le modèle de Garret Hardin préconisant l’extension de la propriété privée pour protéger les « biens communs » produit exactement le contraire, et la financiarisation de la forêt va de pair avec le productivisme forestier. Avec les feux, tout flambera, même la finance spéculant sur les forêts.
Chaque semaine, nous donnons la parole à des économistes hétérodoxes dont nous partageons les constats… et les combats. Parce que, croyez-le ou non, d’autres politiques économiques sont possibles.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Libre-échange : sinistre Saint-Valentin indo-européenne

L’Allemagne et la règle d’or

Le modèle extractiviste vénézuélien, tout sauf une référence