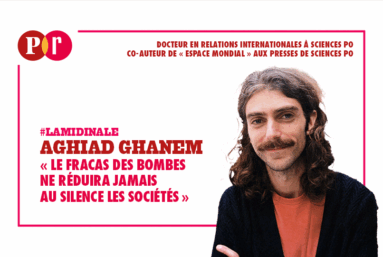COP 21 : Un accord pour la petite histoire
Le texte adopté au Bourget est peu contraignant, et escamote les garde-fous pour les populations du Sud. Décryptage.
dans l’hebdo N° 1382-1384 Acheter ce numéro

Historique. Mais pas au-delà du sens propre du terme : l’accord climatique dit « de Paris », loué avec emphase par les officiels et les négociateurs épuisés, larme à l’œil, est avant tout novateur parce que c’est la première fois qu’un texte de cette nature est signé par 195 pays, la quasi-totalité des nations de la planète. C’est un pas, mais un petit pas seulement. Il était indispensable, mais le sentiment donné par les déclarations, samedi soir, qu’il s’agit du pacte tant attendu « pour sauver la planète », est éminemment trompeur. Dossier archivé, donc ? Après avoir mobilisé les médias français pendant des semaines, il disparaissait des gros titres le lendemain même, chassé par le résultat des élections régionales.
« Escroquerie »
Réaction immédiate et cinglante d’Attac. François Hollande et Laurent Fabius, président de la COP 21 se félicitaient-ils, victorieux, de cet accord « ambitieux, juste, et juridiquement contraignant » comme ils l’avaient souhaité ? « Une escroquerie intellectuelle », qualifie Maxime Combes, porte-parole sur les enjeux climatiques. « Une mascarade », pour la Confédération paysanne, qui ne contient « rien de bon pour les peuples ». Certes, l’accord de Paris signe une petite prouesse diplomatique, et entérine une réelle prise de conscience collective de la réalité du dérèglement. Cependant, il n’est absolument pas de nature à rassurer sur l’issue de la bataille climatique. En de nombreux points, il justifie même les commentaires alarmistes des ONG. Détail des principales décisions. « Nettement en dessous de 2 °C », voire jusqu’à 1,5 °C : c’est à ce niveau que l’accord affirme vouloir contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. En apparence, il s’agit d’un durcissement de l’ambition affichée jusqu’alors. En réalité, une pure parade diplomatique. Pour consentir à signer, les petits pays insulaires exigeaient une référence à 1,5 °C, plafond propre à contenir la menace de submersion de leurs territoires par la dilatation des océans. Mais parfaitement inaccessible en l’état : la borne de 1° C est presque atteinte, et au regard des engagements de réduction d’émissions pris par les pays avant d’arriver à la COP 21 (à supposer qu’ils s’y tiennent), il sera déjà trop tard pour les atolls dans une décennie à peine. D’ici à la fin du siècle, le réchauffement planétaire pourrait dépasser 3 °C (voir ci-contre). Des révisions volontaires d’engagement peuvent intervenir dès 2020, mais le prochain rendez-vous « obligatoire » n’est inscrit qu’en… 2025 ! D’ici là, rien de contraignant dans l’accord, ce que les États se contentent de « noter avec préoccupation » : il n’est spécifié aucune date pour faire culminer les émissions mondiales. Pour la compensation des émissions, on compte explicitement sur les « puits » de gaz à effet de serre (comme le stockage souterrain du CO2), et au cours de la deuxième moitié du siècle (au lieu de 2050). Pour rallier l’Arabie saoudite et le Venezuela notamment, il n’y a pas la moindre référence à la sortie des énergies fossiles. Ni à une taxe carbone. Et la seule mention des énergies renouvelables se trouve dans le préambule de l’accord, à simple valeur déclarative. Au chapitre ambition, cet accord ressemble à un décor de western : derrière le panneau de façade du saloon, c’est le désert.
100 milliards de dollars
C’est le montant annuel, à partir de 2020, du fonds vert prévu pour aider les pays pauvres dans la lutte climatique. Un objectif calé… depuis 2009. Au Bourget, les avancées sont microscopiques sur ce chapitre crucial, qui conditionne pourtant l’adhésion du Sud. Si le texte signale qu’il s’agit d’un « plancher », à rehausser dès 2025 en fonction des besoins, cette mention figure hors accord (sinon le Congrès étatsunien, républicain, n’y aurait jamais donné son aval). Avancée renvoyée donc à des débats ultérieurs, de même que la décision concernant la fraction des sommes affectée à l’adaptation des pays pauvres au dérèglement. S’il est confirmé que ce sont les pays riches, responsables historiques du dérèglement, qui alimenteront le fonds, d’autres sont invités à le faire aussi. La question financière promet donc bien des atermoiements à venir.
Contrainte molle
Il n’existe aucun dispositif de contrôle ou de sanction permettant de s’assurer que les pays tiennent leurs engagements, charge qui leur incombe individuellement ! La valeur contraignante de l’accord tient ainsi à la bonne foi des signataires ainsi qu’à l’image qu’ils donneraient d’eux s’ils y dérogeaient… L’entrée en vigueur, prévue pour 2020, suppose auparavant une ratification par au moins 55 pays totalisant au moins 55 % des émissions mondiales. Avec une clause similaire, le Protocole de Kyoto, adopté en 1997, n’était entré en vigueur que huit ans plus tard.
Injustice climatique
Les négociations climatiques ont prévu de traiter des « pertes et préjudices » induits par le dérèglement : ce mécanisme est réduit au minimum. Surtout, il n’est plus question de « responsabilité » ni de « compensation » de la part des pays riches, qui n’auront pas à indemniser les autres pour les dégâts historiquement causés par leurs émissions. La référence au respect et à la protection des droits humains et des populations indigènes a également été évacuée de l’accord, rétrogradée dans les colonnes du préambule. C’est la porte ouverte à des mécanismes de stockage du CO2 utilisant les forêts ou les sols tropicaux, « considérés comme inoccupés, simples réservoirs mobilisables pour absorber du carbone sans garantie de protection des occupants », déplore Maureen Jorand, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre solidaire. Idem pour la sécurité alimentaire, expulsée. À la place, le texte veille à ce que la « production alimentaire » ne soit pas menacée. Décryptage : des pays agro-industriels comme l’Argentine, gros exportateurs, ne veulent surtout pas que la lutte climatique affecte leur modèle économique. D’une manière générale, le cœur de l’accord a graduellement été expurgé de toute référence à la protection des intérêts des populations.
Pour aller plus loin…
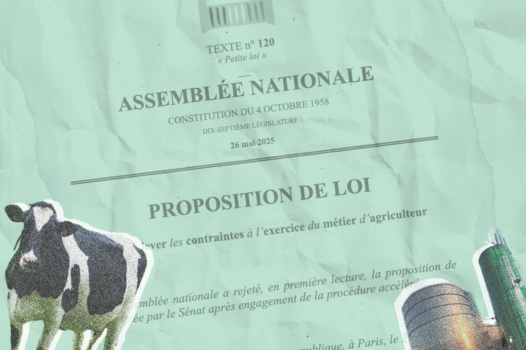
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides