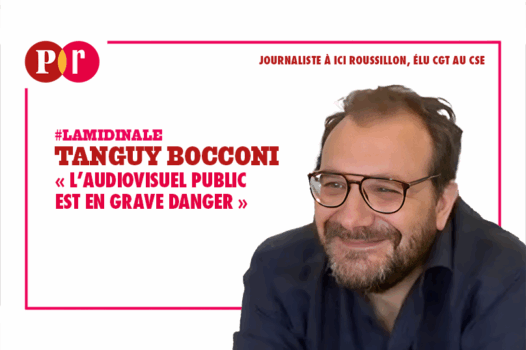Comment sont formés les magistrats ?
Élitisme et reproduction sociale caractérisent encore le parcours des juges.
dans l’hebdo N° 1438 Acheter ce numéro

L’École nationale de la magistrature […] apparaît coupée du monde et de la vie, parfois déconnectée de la réalité. [En son sein] se mettent en place un élitisme inapproprié et le sentiment d’une toute-puissance dangereuse pour l’impartialité de la fonction de juger. » C’est ce qu’affirmait le barreau de Paris au Conseil de l’Ordre, en 2006, dans un document intitulé Ensemble vers une meilleure justice.
Écrit par une dizaine de professionnels du droit, le document est encore marqué par l’affaire d’Outreau, qui avait remis en cause le travail des avocats et des magistrats, notamment celui de Fabrice Burgaud, alors juge d’instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Quelques mois avant le procès, le trentenaire sortait tout frais diplômé de l’École nationale de la magistrature (ENM).
Depuis, l’ENM a mis en place des stages dans des cabinets d’avocats. Mais elle souffre encore des travers caractéristiques des écoles de la haute fonction publique. En cause, une formation jugée élitiste, au sein de laquelle la reproduction sociale est encore vive, et parfois une porosité avec la hiérarchie et les élus locaux, qui freinent ou bloquent certains dossiers pour ne pas gêner un processus électoral.
Cette proximité avec les politiques, et plus généralement avec les notables, s’explique-t-elle seulement par des critères sociologiques ? « Encore au milieu du XXe siècle, les magistrats, restés étroitement inscris dans les cercles locaux de notabilité, partagent avec des préfets ou sous-préfets, des avocats et des élus locaux des façons de vivre et de penser et des réflexes de solidarité qui peuvent les amener à fermer les yeux sur des conduites qu’ils ne sauraient traiter comme celles d’un délinquant ordinaire », explique la sociologue Violaine Roussel [1]. Et les juges se devaient d’être plus répressifs vis-à-vis des prévenus sans qualités pour progresser dans la hiérarchie, comme le développe Vanessa Codaccioni dans Justice d’exception [2].
La fondation en 1958 de l’ENM, l’arrivée d’élèves issus des classes moyennes et la création, dix ans plus tard, du Syndicat de la magistrature, classé à gauche, instaurent un rapport plus distancié avec les gouvernants. Ce qui aboutira dans les années 1990 aux premiers scandales politiques.
C’est justement à cette période que l’ENM souhaite former ses élèves à la déontologie. Daniel Ludet, directeur de l’institution entre 1992 et 1996, explique qu’aux futurs magistrats est enseignée « une mise à distance critique de leurs préjugés ». « C’est un phénomène assez récent », concède-t-il. Depuis un décret datant de 2008, dans le pôle « humanités judiciaires », on trouve un chapitre intitulé « éthique publique », avec des précisions sur l’indépendance et l’impartialité. Un bagage théorique, couplé avec des conférences, censé conduire les auditeurs vers le droit chemin, loin de leurs a priori.
Et ces auditeurs, qui sont-ils ? Sur la promotion 2016, 49 % viennent de facs de droit. Les autres sont des professionnels en reconversion. Plus de 60 % des élèves se sont préparés au concours dans un institut d’études judiciaires, où l’inscription coûte entre 850 et 2 500 euros l’année. La profession de leurs parents est un indice de reproduction sociale : les cadres supérieurs et les professions libérales sont surreprésentés. Sur les 246 élèves, quatre ont un père ouvrier non qualifié, deux une mère agricultrice. « C’est un problème sur lequel butent toutes les écoles de la haute fonction publique », constate Daniel Ludet.
Comme d’autres grandes institutions, l’ENM ouvre en 2008 trois classes préparatoires « Égalité des chances », permettant à des élèves issus de milieux populaires d’avoir plus de moyens pour accéder aux épreuves. En 2016, sur les 54 candidats, 8 sont reçus au concours d’entrée. Selon Emmanuelle Perreux, directrice adjointe de la formation à l’ENM, ces classes « ont pour objectif d’approfondir la méthodologie et la culture générale » – des tentatives de l’institution pour ouvrir ses portes. « Il y a la volonté de donner aux futurs magistrats une plus grande ouverture. C’est une attente interne mais aussi de l’opinion publique. »
Cette politique d’ouverture se heurte toutefois au fonctionnement de la justice, qui, parfois, « encourage au conformisme », note Michel Deléan, du service justice de Mediapart. Même si les sociologues ne sont pas nombreux à se spécialiser dans ce domaine, certaines pratiques ont été expliquées. C’est le cas pour la répartition et la représentation des femmes dans la justice. Comme l’a étudié le Collectif Onze dans Au tribunal des couples [3], 70 % des admis à l’ENM sont des femmes, les trois quarts travaillent aux affaires familiales, et très peu occupent un haut poste dans la magistrature.
Autre stratégie visant à neutraliser les carrières : l’évaluation annuelle. Réalisée par le président de la cour d’appel pour les magistrats du siège, et par le procureur général pour ceux du parquet, elle tient compte du travail et du comportement des magistrats, mais elle détermine aussi une « prime modulable ». Cette prime est calculée en fonction de la contribution des magistrats au « bon fonctionnement du service public de la justice ». Difficile, donc, de déranger l’institution, ce qui pousse à la productivité et au chiffre. Les syndicats avaient alerté le Conseil d’État. Réponse : « aucune atteinte à l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ».
[1] « Les changements d’ethos des magistrats », Le Fonctionnement politique de la justice, La Découverte, 2007.
[2] Éditions du CNRS, 2015.
[3] Éditions Odile Jacob, 2013.
Retrouvez l’intégralité de notre dossier « Existe-t-il une justice de classe ? » ici.
Pour aller plus loin…

Au Blanc-Mesnil, qui veut déraciner les Tilleuls ?

Cathos intégristes et écoles privées : le véritable « entrisme »

Bétharram : derrière les défaillances de l’État, le silence complice de l’Église