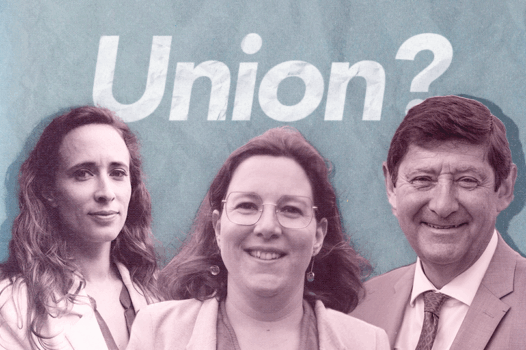Emmanuel Macron : Sur un malentendu… ça ne peut pas marcher
Alors qu’Emmanuel Macron affirme « appliquer son programme » – déjà très imprécis lors de la campagne –, nombre de ses électeurs peuvent légitimement se sentir floués.
dans l’hebdo N° 1501-1502 Acheter ce numéro

Et si Emmanuel Macron avait été élu sur un malentendu ? Depuis un an, émettre cette hypothèse attire sur tous ceux qui s’y risquent les foudres des soutiens, avoués ou non, du chef de l’État. Pourtant, si l’élection du président de la République n’est pas contestable – elle n’a d’ailleurs jamais été contestée –, il est licite de rappeler ce que sa victoire « par effraction », comme il la qualifie lui-même, doit aux circonstances exceptionnelles de ce scrutin : la fin crépusculaire du quinquennat de François Hollande, la certitude que Marine Le Pen serait au second tour, les affaires de François Fillon… Au soir de son élection, le 7 mai 2017, le candidat reconnaissait d’ailleurs lucidement avoir « été élu par des gens qui ne [l]’ont pas choisi ». Dans l’entretien à Corse-Matin (18 août 2017) où il rapportait ce propos, Christophe Castaner, qui était encore le porte-parole du gouvernement, précisait : « Ceux qui l’ont choisi, c’est 24 % des Français. » Soit son score au premier tour.
Les plus aisés comblés
Un an plus tard, dans un entretien à La Nouvelle Revue française, le chef de l’État se considère certes comme une « aberration » du point de vue du « système politique traditionnel » – puisqu’il semblait jusqu’ici acquis qu’il était impossible d’emporter cette élection sans l’appui d’un parti et sans une solide expérience d’élu local et national – tout en donnant de sa victoire une lecture dépolitisée : « En réalité, je ne suis que l’émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Cela ne se résume pas en formules, mais c’est bien le cœur de l’aventure politique. En somme, on est toujours l’instrument de quelque chose qui vous dépasse. » Gageons que cette lecture aventurière de son élection, au vu de la politique mise en œuvre, surprendra plus encore les électeurs de gauche qui ont voté Macron au second tour pour faire barrage à l’extrême droite. Quand ils ne l’ont pas fait dès le premier tour afin d’éviter un second tour Fillon-Le Pen.
Laurent Berger, peu suspect d’hostilité systématique à l’égard de l’exécutif, le reconnaissait, dimanche 29 avril : « Si vous me demandez “c’est quoi, l’élément aujourd’hui qu’on ne retrouve pas de la campagne d’Emmanuel Macron ?”, je dirai la bienveillance et l’attention aux plus fragiles », a déclaré le secrétaire général de la CFDT au « Grand Rendez-vous » de CNews, Europe 1 et Les Échos. Cette perception négative est confirmée par de nombreuses enquêtes d’opinion. Celle réalisée par l’institut Elabe entre l’entretien présidentiel sur TF1 et celui accordé à BFM TV et Mediapart indique que 67 % des personnes interrogées considèrent que la politique menée est plutôt en faveur des plus aisés, 6 % estimant qu’elle est davantage en faveur des classes moyennes et des classes les plus aisées.
L’examen des mesures fiscales du gouvernement justifie l’image de « président des riches » qui colle désormais à Emmanuel Macron. La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière, la fin de la taxation sur les dividendes et de celle sur les salaires élevés, ajoutées au plafonnement de la taxation sur le capital, augmentent de près de 7 milliards d’euros le pouvoir d’achat des ménages les plus fortunés. Tandis que la hausse de la CSG, la baisse des APL, la suppression de 260 000 emplois aidés et le gel des pensions de retraite diminuent de près de 9 milliards celui des ménages concernés, lesquels subiront plus gravement la hausse du forfait hospitalier et la baisse du budget de la Sécurité sociale, qui renchérit le coût des mutuelles, et la baisse du budget de l’État (7 milliards tout de même !), avec ses effets sur les services publics. Une fois élu, celui qui se présentait comme « le candidat du travail » s’est révélé être un zélé promoteur de la rente… Un sacré malentendu.
Face aux contestations que soulève sa politique, Emmanuel Macron et sa majorité répètent qu’ils ne font qu’appliquer le programme sur lequel ils ont été élus. La République en marche diffuse ainsi, auprès des marcheurs et sur son site Internet, des listes de réalisations accompagnées de la mention « fait » ou « en cours ». Un argument repris par bien des éditorialistes. « Emmanuel Macron coche les unes après les autres ses promesses de campagne. Cela donne incontestablement […] une forte légitimité à son action », se félicite Dominique Seux (Les Échos, 20 avril), pour qui le chef de l’État a raison de répéter « je fais ce que j’ai dit », cette rigueur étant sa « principale différence avec ses prédécesseurs ».
Outre qu’il érige le programme en dogme et investit l’agir d’une légitimité que seules ses conséquences devraient lui donner, cet argument d’autorité doit être nuancé. La campagne électorale d’Emmanuel Macron, centrée sur la nouveauté qu’incarnaient le candidat et son mouvement, a relégué au second plan le programme, dévoilé tardivement. Jusqu’au premier tour, le candidat s’était contenté d’en donner le cap et d’en tracer les grandes lignes en des termes suffisamment flous pour pouvoir être interprétés de manière contradictoire.
Marketing
De surcroît, dans la version détaillée de ce programme, ne sont évoqués ni la réforme de la SNCF, ni la baisse des APL et les regroupements d’offices HLM dans la loi Élan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) présentée récemment en conseil des ministres, ni la réécriture du code civil pour modifier l’objet social de l’entreprise. Dans sa forme vulgarisée – une brochure de 32 pages, à la tonalité très marketing, distribuée par les marcheurs –, on ne lit nulle part l’annonce de la suppression massive des emplois aidés, ni la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur la durée du mandat, ni l’augmentation de la CSG. Le candidat y promet en revanche d’améliorer « le pouvoir d’achat de tous les travailleurs » par la réduction des « cotisations payées par les salariés, les indépendants et les fonctionnaires ». Si cette réduction (étalée en deux temps) a permis une petite augmentation du salaire net dans le secteur privé, les fonctionnaires n’auront, eux, obtenu qu’une compensation au centime près de la hausse de la CSG.
Jusqu’aux élections législatives, le nouveau pouvoir a entretenu le flou sur ses intentions. Le 6 juin, à cinq jours du scrutin, le Premier ministre, Édouard Philippe, remettait aux partenaires sociaux un document présentant les six réformes sociales, dont celle du code du travail, que son gouvernement souhaitait mettre en œuvre en dix-huit mois. Accompagné de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, il évoquait la volonté de son gouvernement de « rénover notre modèle social ». Au sortir de l’été, il n’était déjà plus question de le rénover mais de le « transformer », ce qui marque plus qu’une nuance.
De fait, la première réforme du quinquennat par ordonnances a profondément transformé le code du travail. Avec l’inversion de la hiérarchie des normes, la modification du droit du licenciement et de la justice prud’homale, et l’affaiblissement du rôle des syndicats, décidés par le gouvernement et votés sans mot dire par la cohorte des députés LREM, le code protecteur des salariés s’est mué en un code protecteur des entreprises, de leurs dirigeants et, in fine, des actionnaires. Pour la première fois de notre histoire, jugeait alors Jacky Bontems, un ancien membre de la direction de la CFDT, animateur de Démocratie vivante, un think tank « macroniste de gauche », « une séquence de négociations sur l’assouplissement du marché du travail se termine sans contrepartie aucune pour les salariés en matière de sécurisation ».
Flexibilité
Fin janvier, à Davos, Emmanuel Macron a défendu en anglais ses réformes pour adapter la France à la mondialisation, la « rendre plus compétitive » et « plus flexible ». Parmi elles, la réforme du code du travail, mais aussi celle de l’accès à l’université. « En France, nous corrigeons les inégalités avec des taxes et des normes, mais sans les empêcher. Cela avait affaibli notre compétitivité », a-t-il plaidé, rappelant aussi son plan sur cinq ans de baisse d’impôts sur les sociétés, la fortune, les revenus financiers et les ménages. « France is back », s’est-il félicité dans le droit fil du sommet « Choose France », où il avait déroulé le tapis rouge à 140 chefs d’entreprise, dont des dirigeants de multinationales telles que Google, pour les convaincre d’investir dans l’Hexagone.
Revenant ensuite au français, le chef de l’État avait dénoncé les excès du dumping fiscal et social de cette même mondialisation, avant de demander aux entreprises de « renoncer à l’optimisation fiscale à tous crins » et d’appeler les États à une coopération sur la fiscalité sans laquelle il sera vain d’espérer convaincre « les classes moyennes que la mondialisation est bonne pour elles ». Un discours moral et des vœux d’un côté ; de l’autre, des lois qui libéralisent, ouvrent à la concurrence, financiarisent l’économie et suppriment les protections, reproduisant ce que font tous les dirigeants des pays occidentaux depuis trente ans. L’équilibre rhétorique, qui pouvait être celui d’un programme, se heurte désormais à la réalité de sa mise en pratique. Fin du malentendu.
Pour aller plus loin…

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?