La tentation néolibérale de Michel Foucault
Mitchell Dean et Daniel Zamora analysent la défiance du philosophe, à la fin de sa vie, envers le projet social-étatique.
Article paru
dans l’hebdo N° 1571 Acheter ce numéro
dans l’hebdo N° 1571 Acheter ce numéro
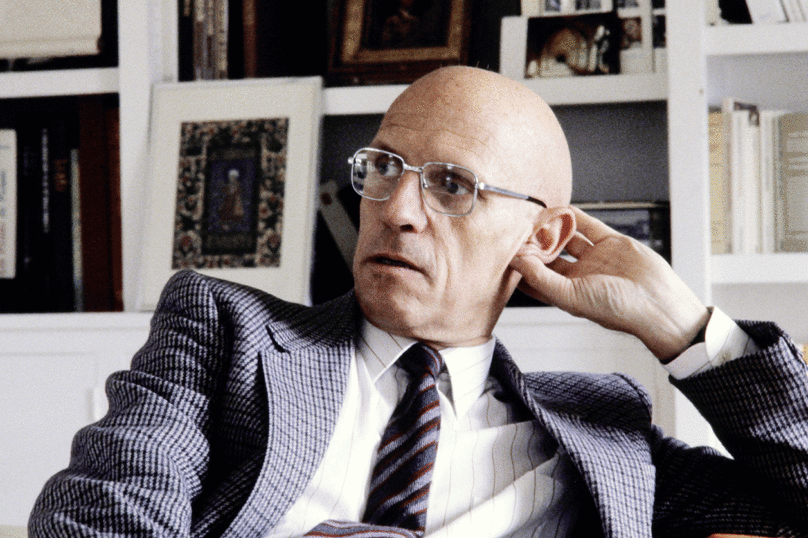
Au printemps 1975, Michel Foucault prend du LSD avec deux amis à Zabriskie Point, en Californie. Ils « passent » ce que l’écrivain Tom Wolfe a appelé un « acid test ». Foucault en sort transformé. Comme il l’écrira à l’un des deux participants, cette « grande expérience » fut pour lui « une des plus importantes de [sa] vie ». À tel point que cela l’amène à modifier entièrement le plan de sa gigantesque Histoire de la sexualité – pourtant annoncé dans le premier volume, La Volonté de
