Être noir en France en 2008
Alors que paraît la première étude d’envergure sur les Noirs de France, les minorités « visibles » continuent de subir des discriminations dans la société française. Des faits que l’abstraction républicaine contribue à minimiser.
Un dossier à lire dans notre rubrique **Société** .
dans l’hebdo N° 1007 Acheter ce numéro
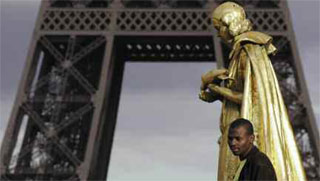
En 1909, aux États-Unis, William E. B. Du Bois, qui, en 1895, fut le premier Noir diplômé de philosophie à Harvard, fondait l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP). Dans son livre-manifeste daté de 1903, les Âmes du peuple noir [^2], il écrivait : «Le problème noir n’est rien d’autre qu’un test concret des principes fondateurs de la grande république.» Bien que le contexte américain soit évidemment tout autre, cette phrase sonne étrangement juste dans la société française d’aujourd’hui. Comment vit-on comme Noir en France en 2008~? Quel regard la population noire de France porte-t-elle sur la société dans laquelle elle vit ?
Lors d’un concert au Trocadéro, le 13 mai 2005, à la mémoire des victimes de l’esclavage. Saget/AFP
Première étude synthétique publiée en France sur le sujet, le livre de Pap Ndiaye la Condition noire. Essai sur une minorité française constitue bien à ce titre un événement, tout d’abord dans le champ des sciences sociales (voir entretien ci-contre). En prenant les Noirs de France pour objet de recherche, l’auteur ne se limite pas à une histoire de l’esclavage ou du racisme, ces deux questions n’apparaissant «que de manière oblique». Aussi, il rappelle que, si
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

En CRA, le double enfermement des personnes psychiatrisées
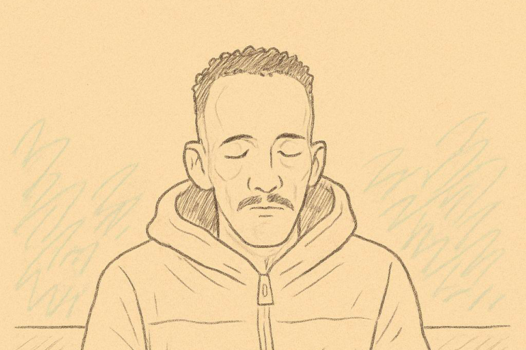
Ahmed N. voulait « soigner sa tête » : à Calais, les exilés abandonnés face aux souffrances psychologiques

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »







