Eric Hobsbawm : «Je reste un historien engagé»
Dans un livre rassemblant de récentes interventions aux confins de l’histoire et de la science politique, l’historien britannique Eric J. Hobsbawm analyse la période depuis 1989, marquée par l’hégémonie américaine. Et nous livre, à 91 ans, son approche du métier d’historien.
dans l’hebdo N° 1051 Acheter ce numéro
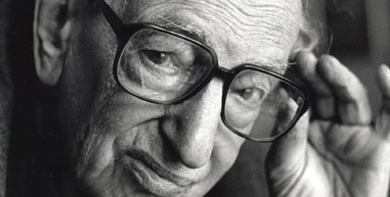
Politis : Dans les premières pages de votre autobiographie [^2],
vous écriviez que votre livre sur l’histoire du XXe siècle, « l’Âge des extrêmes » [^3], était celui d’un « participant observer » , qu’on peut traduire aussi bien par « observateur participant » que par « spectateur engagé ». Que signifie pour vous ce terme, et ce nouveau livre qui paraît aujourd’hui est-il aussi une réflexion sur le début du XXIe siècle, écrite par un « spectateur engagé » ?
Eric J. Hobsbawm : Ce terme signifie pour moi qu’il faut toujours essayer d’être un scientifique indépendant et rigoureux, mais en ayant en même temps un point de vue vis-à-vis du sujet sur lequel on travaille. C’est une notion qui a été forgée par les chercheurs en sciences sociales, qui, lors d’enquêtes de terrain, revendiquaient leurs convictions socialistes et ne cachaient pas leur sympathie pour les milieux sur lesquels ils travaillaient. Le problème pour un chercheur est de maintenir un certain degré d’empathie tout en continuant à mener des recherches et des analyses rigoureuses, et de ne pas tomber dans la propagande ou l’idéologie. C’est ce à quoi j’ai toujours essayé de me tenir. Or, si je me suis toujours considéré comme un « historien engagé [^4] », c’est que je crois qu’il est impossible de faire de l’histoire en pensant atteindre une hypothétique neutralité. Je suis un chercheur qui ne cache pas son engagement pour certaines idées politiques, mais qui s’efforce toujours, en dépit parfois de certaines proximités idéologiques, de conserver une distance afin de ne pas transiger avec la rigueur scientifique. Savoir ensuite dans quelle mesure on réussit à tenir cet équilibre difficile, c’est une autre question !
Vous avez montré que le « court XXe siècle » a été notamment marqué par une modification radicale du rapport au passé,
ou plutôt du « passé dans le présent ». Diriez-vous qu’il est plus difficile d’être un historien aujourd’hui, vu cette sorte d’accélération du temps à laquelle on assiste et de mise à distance du passé ?
Je ne crois pas vraiment qu’il soit plus difficile d’être un historien aujourd’hui que par le passé. Cependant, les façons élémentaires de faire de l’histoire ont beaucoup changé depuis les années 1970 et 1980, essentiellement parce que les principaux problèmes historiques qui étaient abordés par ma génération d’historiens, essentiellement liés aux changements sociaux, aux transformations sociales, ont été depuis délaissés et peu à peu marginalisés. Les gens se sont concentrés sur d’autres choses en retournant, par exemple, à une histoire plus narrative, ou en se focalisant sur l’histoire culturelle et l’histoire des idées. Aussi, je pense qu’il est peut-être même plus simple aujourd’hui d’être historien. En effet, les usages publics impropres ou abusifs de l’histoire sont devenus, depuis une trentaine d’années, si fréquents et si évidents que cela a renforcé le rôle fondamental des historiens, en particulier des historiens critiques. Notamment, durant cette période, sont nés un grand nombre de nouveaux États qui se sont littéralement inventé une histoire nationale et dont la création a même été conduite par des gens qui se présentaient comme des historiens, comme en Croatie, ou parmi la première génération de responsables politiques en Géorgie. Ces gens ont construit de véritables opérations mythologiques à propos de leur propre passé.
C’est pourquoi je crois que le rôle des historiens est encore plus fondamental. Je me suis intéressé dans un de mes ouvrages aux traditions inventées de toutes pièces par la monarchie britannique [^5], souvent au XIXe siècle (et dont la plupart des Anglais pensent qu’elles datent de plusieurs centaines d’années), afin de mettre en lumière les usages politiques importants qui en étaient retirés. Le même phénomène s’est produit dans ces jeunes États qui tentent aujourd’hui de créer leur propre « roman national ». Les historiens ont là un rôle fondamental à jouer pour dévoiler les usages politiques de ces « histoires » mythifiées.
Pour en venir à ce nouveau livre, vous analysez les relations internationales actuelles et notamment la place de la superpuissance américaine en utilisant le terme d’« empire ».
Or, en historien, vous montrez
les différences fondamentales avec les empires qui ont existé dans le passé. Pourquoi parler alors d’empire ?
Il y a eu différents types d’empires au cours de l’histoire. Les premiers, les plus anciens, s’étendaient sur de très grands territoires avec des populations très diverses et étaient dirigés par un centre unique. Je pense ici, par exemple, à l’empire ottoman, aux empires perse ou mongol, à l’empire austro-hongrois ou à l’empire russe des tsars… Parmi ceux-ci, les derniers ont disparu à la fin de la Première Guerre mondiale, à l’exception de l’empire russe, qui, en quelque sorte, a été sauvé par la révolution bolchevique. La deuxième catégorie est celle des empires coloniaux, typiques du mode de développement du capitalisme aux XVIIIe et XIXe siècles. Ceux-ci ont quasiment tous disparu également dans la seconde moitié du XXe siècle, après avoir commencé à montrer des prémisses de crise durant l’entre-deux-guerres. Ce qui demeure aujourd’hui est, je crois, un troisième type d’empires que l’on pourrait appeler des empires hégémoniques, qui reposent à la fois sur l’acceptation d’une supériorité en matière de ressources, de forces et de puissance, mais n’impliquent pas nécessairement le même mode d’exploitation des territoires que les autres types. Ce que j’analyse dans ce livre est qu’il y a aujourd’hui deux empires de ce type dans le monde qui sont potentiellement capables de durer, voire de se développer : le premier est la Chine, qui d’une certaine manière parvient à faire perdurer des comportements hégémoniques dans les régions du monde sur lesquelles son influence s’exerce avec plus ou moins de rigueur ; le second est les États-Unis. Dans ce dernier cas, l’hégémonie ne s’est pas traduite par une exploitation des territoires ou nations sous son influence, mais elle n’a cessé de se renforcer, surtout depuis 1945, comme superpuissance. Et depuis la fin de la Guerre froide, elle n’a plus aucun rival potentiel.
Ce que j’essaie de montrer dans un des textes de ce livre est la différence de l’hégémonie américaine par rapport à l’empire britannique, qui, s’il fut un empire colonial avec les caractéristiques d’exploitation dont j’ai parlé précédemment, avait aussi pour une part une influence de caractère hégémonique, par exemple sur des pays comme l’Argentine ou le Portugal. Or, l’hégémonie américaine est quelque chose à part aujourd’hui et diffère de l’empire britannique pour un certain nombre de raisons.
Notamment le fait que la puissance britannique, liée à la généralisation de l’économie capitaliste aux quatre coins du monde, était largement dépendante de son commerce avec l’extérieur et de ses importations. Les États-Unis, au contraire, sont extrêmement peu dépendants, et leur force repose principalement sur leurs propres ressources : ce sont les pays sous leur influence qui sont plutôt dépendants d’eux, et cela ne fait que renforcer leur caractère hégémonique. Néanmoins, il me semble que les États-Unis, malgré leur puissance extraordinaire, ne pourront maintenir une telle hégémonie parce qu’ils ont été trop arrogants avec les autres, spécialement pendant les années Bush, et que le monde est trop compliqué aujourd’hui pour pouvoir continuer ainsi. Ce qui ne veut pas dire que les États-Unis ne resteront pas un État extrêmement riche, puissant, et sans doute toujours le premier sur le plan militaire. Mais je doute que la forme actuelle de l’empire, qui finalement est directement issu du monde façonné en 1945 puis de la disparition de l’URSS, puisse durer encore longtemps. Leur puissance militaire, notamment, demeurera, mais elle est surtout adaptée à des formes de conflits armés du siècle passé, qui sont de plus en plus rares de nos jours.
Vous introduisez justement,
à propos des formes de relations internationales contemporaines,
le concept d’« impérialisme des droits humains »…
Je crois que ce concept a vu le jour depuis la chute de l’Union soviétique avec la guerre en Bosnie. À partir de cette nouvelle période historique et du fait de l’importance des médias dans nos sociétés, il a été facile de faire croire aux gens, eux-mêmes de bonne foi, que la seule solution à la violence et au chaos en ex-Yougoslavie était une intervention américaine. Même des gens modérés, voire progressistes, en ont été convaincus. Depuis, de nombreuses opérations ont été menées sur ce modèle, avec plus ou moins de succès. Pourtant, je ne peux m’empêcher de penser qu’une telle politique, généralement appelée « ingérence », repose fondamentalement sur la conviction profonde de l’Occident de sa propre supériorité, ou de la supériorité blanche. Nous pensons toujours que nous, nous savons, nous sommes civilisés, et que nous devons « leur » apprendre, « les » empêcher de s’entre-tuer, etc. Je crois que c’est une grave erreur. Bien entendu, je n’exclus pas qu’il y ait certains cas isolés où l’urgence commande d’agir, mais élaborer une théorie générale de l’ingérence, comme l’ont fait des gens tels que Bernard Kouchner, ne peut que reposer sur l’espoir de voir les États-Unis se charger de l’appliquer. Cela ne peut dans les faits que renforcer la suprématie américaine. Ce qui n’a absolument rien à voir avec les droits humains…
Vous avez revendiqué toute votre vie votre attachement à Marx. Pensez-vous que la pensée marxiste demeure une grille de lecture valable pour le monde actuel ?
Je crois en effet que Marx et la conception matérialiste de l’histoire restent les meilleurs guides pour appréhender l’histoire, en tant qu’analyse du développement des sociétés humaines depuis les origines jusqu’à nos jours. Je ne dirais pas qu’ils doivent être appliqués de façon abrupte à toutes les sociétés, en particulier les plus lointaines et les plus différentes des nôtres. Mais en ce qui concerne le capitalisme, Marx demeure le guide le plus pertinent car il fut le premier à avoir parfaitement décrit les tendances naturelles du capitalisme à la globalisation. Et je ne pense pas ici uniquement aux seules conséquences économiques de la globalisation, mais également à celles en matière culturelle, politique, etc. En outre, Marx a décrit avec précision le modus operandi du capitalisme à produire ses propres contradictions, ses conflits internes et les crises qui vont régulièrement se produire. Il a élaboré le premier un modèle de réflexion qui a ensuite été repris et développé par beaucoup d’autres penseurs, je pense en premier lieu à Schumpeter. Or, ce que j’observe est que cette nature intrinsèque du capitalisme à engendrer ses propres crises a été, de façon totalement dogmatique, complètement oubliée depuis une trentaine d’années. Aussi, pour moi, la pensée néolibérale qui a dominé pendant cette période me semble moins se fonder sur la réalité de l’économie que relever d’une sorte de théologie. Or Marx a élaboré une méthode complexe et efficace pour étudier les différentes manières d’évoluer du système, même si l’on sait bien que les solutions ne se trouvent pas en lisant directement les œuvres de Marx, mais en utilisant sa méthode et en l’appliquant aux situations nouvelles.
À la fin de votre introduction à l’Âge des extrêmes , vous écriviez : « Ce siècle finit mal. » Diriez-vous que le XXIe siècle a aussi mal commencé que le XXe siècle a fini ? Êtes-vous pessimiste aujourd’hui ?
Au contraire, je crois finalement que je suis un optimiste. Bien entendu, avec l’âge, n’importe qui devient de plus en plus réaliste, comparé à ses espérances de jeunesse. De même, plus on vieillit, plus on est dubitatif quant à l’avenir. Mais, pour quelqu’un comme moi qui a traversé tout le XXe siècle, il est en même temps très difficile de se retourner sur le siècle passé en éprouvant des satisfactions. Pour ma part, j’éprouve plus de satisfactions à me retourner vers le XIXe siècle qui est, comme disent les historiens, « ma période ». Quant au XXIe siècle, il ne fait aucun doute qu’il a très mal commencé. Tout ce que je peux dire est que certaines des pires tendances de l’espèce humaine semblent malheureusement se perpétuer. Je pense aux formes de barbarie qui se sont développées depuis la Première Guerre mondiale, que l’on avait un instant cru voir disparaître, et qui me semblent symbolisées aujourd’hui par le retour de la torture. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on avait pu croire que la torture serait peu à peu bannie de l’histoire. Le fait de voir que la torture est réapparue et qu’elle a même été justifiée m’inquiète beaucoup. J’avais espéré avec la fin de la Guerre froide que nous connaîtrions un véritable progrès en la matière. Avoir découvert, à mon âge, que ce ne serait pas le cas me rend, d’un certain point de vue, je vous l’accorde, extrêmement pessimiste.
Une autre raison de ne pas être optimiste est la question environnementale. Si nous ne l’affrontons pas effectivement, je n’ose même pas dire la résoudre, alors il est clair que l’avenir de l’ensemble de l’humanité va être catastrophique. Enfin, une autre de mes grandes inquiétudes est que le progrès scientifique soit maintenant parvenu à interférer dans la génétique du genre humain, de le modifier biologiquement. Cela ne donne, à mon avis, aucune raison d’être vraiment optimiste. Cependant, comme je l’ai déjà dit, je refuse de sombrer outre mesure dans le pessimisme, car si l’humanité a été capable de survivre au XXe siècle, je crois qu’elle sera capable de survivre à n’importe quelle autre époque !
.
[^2]: Franc-tireur. Autobiographie, traduit par Dominique Peters et Yves Coleman, Éd. Ramsay, 2005.
[^3]: L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, éditions Complexe/Le Monde diplomatique, 1999, Éd. André Versaille, 2008
[^4]: Prononcé en français.
[^5]: L’Invention de la tradition, Eric J. Hobsbawm & Terence Ranger, traduit par Christine Vivier, Éd. Amsterdam, 2005.
Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »







