Une vie engagée dans l’Histoire
Rescapé de Buchenwald, ancien communiste, Paul Noirot fut un pionnier de l’AFP. Journaliste engagé, il fonda en 1970 Politique Hebdo, melting-pot de la gauche. Il est aujourd’hui à la tête des éditions Riveneuve. Bon pied bon œil.
dans l’hebdo N° 1062-1064 Acheter ce numéro
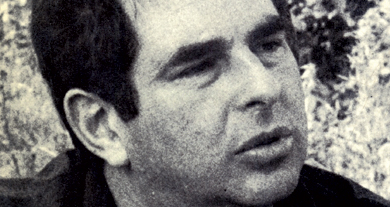
Octobre 1970. Un nouveau journal s’affiche en kiosque. Nom de baptême : Politique Hebdo. Nature : hebdomadaire, comme son titre l’indique. 3 francs le numéro. 100 francs l’abonnement annuel. Fonction : donner la voix à un communisme libéral. Adresse postale de la rédaction : rue des Petits-Hôtels, dans le Xe arrondissement de Paris, au-dessus de la rue Lafayette. Directeur de publication : Paul Noirot.
Retour en arrière.
Paul Noirot est né le 18 novembre 1923, à Paris. Sa mère, d’origine ukrainienne, est médecin ; son père, journaliste. Il flotte dans la famille un état d’esprit « communisant ». Études secondaires classiques avant de se destiner à la biologie et aux mathématiques à Normale sup. Tombe la guerre. Qui modifie un tantinet les plans de carrière. Direction Bordeaux, puis Sète et Marseille. Le baccalauréat entre les déménagements. Il tente vainement de rejoindre les forces françaises en Afrique du Nord. À défaut, il entre dans la Résistance. En guise de fait d’armes, reste le sabotage d’une représentation lyrique devant un parterre d’uniformes allemands à l’Opéra de Marseille. À l’orée de 1943, il adhère au Parti communiste clandestin. En novembre de la même année, il est arrêté sur le quai de la gare d’Ambert (Puy-de-Dôme), à la suite de la chute du réseau Alliance, versé dans les faux papiers. Conduit à Vichy, incarcéré à Clermont-Ferrand dans une ancienne caserne. Battu, torturé. Puis déporté au camp de Buchenwald un mois plus tard. Il y apprend « la fantastique fragilité d’une existence livrée aux hasards ». Paul Noirot tient la mort par la main, en ingénieur mécanicien, sous la botte nazie, réceptionniste du matériel de guerre qu’il doit estampiller d’un aigle à croix gammée. Son poste impose de valider un matériel qui, soudainement, se trouve mal soudé, mal rivé, mal peint, mal façonné. C’est une façon de freiner la marche infernale.
Paul Noirot survit à Buchenwald jusqu’en avril 1945, avant de survivre à une autre brinquebale, à travers une Allemagne en flammes, menée par les SS en déroute, puis d’être libéré par une division américaine.
Après la guerre, Paul Noirot entame de nouvelles études, une licence de physique à la Sorbonne. Mais son père, cofondateur de l’Agence France presse (AFP), créée à la Libération de Paris, en septembre 1944, sur les fondations de l’agence Havas, meurt brutalement. Foin des études. Boulot dare-dare. Paul Noirot, suivant l’invitation des proches du pater, Claude Roussel notamment, entre à l’AFP. Journaliste stagiaire, il a alors 23 ans. Et il apprend sur le tas.
De Buchenwald, s’il a développé un scepticisme à l’égard des individus, Paul Noirot traîne dans sa caboche « un internationalisme vrai » . La période se donne à l’euphorie dans une Europe en pleine mutation. Dans cette année 1946, bardé de tampons tricolores, il a pour premières missions de traverser une Allemagne « prostrée dans ses ruines ». Parallèlement, il pige pour Action, « hebdomadaire d’avant-garde dont l’Express ne sera plus tard qu’une copie ». Témoignant d’une féerie aux confins du désastre, il écrit son tout premier papier, qu’il titre Voyage au bout de la nuit, « sans craindre la référence littéraire ».
Au fil des années, suivant l’évolution des « démocraties populaires », le jeune journaliste va s’intéresser de plus en plus aux pages économie. Son scepticisme à l’égard des individus va se renforcer : au gré des influences de Georges Bidault, trublion trouble de la Quatrième République, tirant les ficelles de l’AFP (officiellement dirigée par Maurice Nègre), Noirot est viré de l’Agence, après avoir mené une grève contre la direction. Ses responsabilités à la CGT et son appartenance au Parti communiste ne passent pas.
Le rebond se joue précisément sur le parquet du Parti, qui lui propose, à l’automne 1951, un poste dans son quotidien Ce soir, dont Pierre Daix est rédacteur en chef. Dans l’hiver 1952-1953, quand le journal s’éteint, Paul Noirot trouve une place dans la revue de politique étrangère du Parti, Démocratie nouvelle, dont tous les dirigeants communistes des pays de l’Est sont membres du comité de rédaction (tels Togliatti, Politt, Geminder, Djilas, Slansky, Zambrowski). L’arrivée de Paul Noirot est appuyée par Jacques Duclos, directeur de la revue, non sans la réticence de quelques cadres. Noirot a déjà la réputation retorse du contestataire.
Il n’empêche, il y restera jusqu’en 1969, parmi les animateurs principaux de la rédaction. Soit une quinzaine d’années, gavées par la guerre froide, le tournant de la déstalinisation, l’entrée des chars russes à Budapest, les intrigues du Parti, les dissimulations, les luttes fratricides. Une quinzaine d’années ponctuées par Mai 68. À l’intérieur du PC, il devient un opposant, un résistant résolument ouvert. Il défend l’esprit de Mai 68, soutient Dubcek, condamne les répressions de Prague. Dans les décombres fumants d’un printemps mal tourné, Démocratie nouvelle est suspendu (un euphémisme forcément doux). Avec la complicité de quelques journalistes de Démocratie, Paul Noirot crée alors Politique aujourd’hui, qui se veut « une revue mensuelle de gauche, anti-stalinienne, représentant divers courants », se rappelle-t-il. C’est trop, c’est beaucoup trop. En 1969, il est exclu du Parti.
À l’automne 1970, le mensuel va accoucher de Politique Hebdo, financé par une souscription qui parvient à glaner un milliard de centimes ! En 32 pages, l’hebdo est généraliste, avec des rubriques de politique, d’économie et de culture. Tirage moyen, 20 000 exemplaires. La rédaction est une mosaïque de tendances, où se croisent sympathisants et/ou militants du Parti socialiste, de Lutte ouvrière, de la LCR, du PCI, des proches ou exclus du PC. Tous horizons, toutes sensibilités. S’y bousculent les dominicains Paul Blanquart et Philippe Roqueplo, Claude-Marie Vadrot (sous le pseudo de Claude Boris), Jérôme Clément (actuel président d’Arte), Jean Duflot (aujourd’hui responsable de la radio de la communauté de Forcalquier), Roger Dosse, Madeleine Rebérioux, Hervé Hamon, Patrick Rotman, Claude Angeli (plus tard rédacteur en chef du Canard enchaîné )… Tout un arc-en-ciel de personnalités et de mouvances, qui crée une dynamique en même temps que des rapports compliqués quand chacun prêche pour sa paroisse. Surtout, se souvient Paul Noirot, « Politique Hebdo a été l’occasion de souligner certains thèmes, de défendre certaines causes, dans l’esprit d’après-68 : la démocratie algérienne, la torture pratiquée par l’armée française, le féminisme, l’affaire Touvier, le Vietnam… »
Si le journal a eu « une influence bien plus importante que son nombre d’acheteurs » , attirant un lectorat jeune, l’aventure de Politique Hebdo s’achève, faute de fifrelins, en 1978. Le journal connaît une résurrection au moment de la campagne présidentielle de Mitterrand, en 1981. Brève renaissance qui ne survit pas aux lendemains de l’élection. Dans le curriculum vitae de Paul Noirot, à l’effervescence de Politique Hebdo succède la Lettre internationale, essentiellement littéraire, un enseignement à Sciences-Po puis à l’ENA sur les racines culturelles de l’Europe, avant d’endosser un rôle de directeur éditorial au sein de Maisonneuve & Larose (maison déjà plus que centenaire, à vocation universitaire), aux côtés d’Alain Jauson. En 2006, toujours avec Alain Jauson, il crée les éditions Riveneuve, tournées vers les ouvrages littéraires, historiques et politiques, où se mêlent le roi René, Guillaume Budé et le roman comique de Scaron.
En 1976, chez Stock, dans la Mémoire ouverte , Paul Noirot relatait ses souvenirs, de l’adolescence au mitan des années 1970. Aujourd’hui, partageant son temps entre Paris et la Sarthe (ayant même doté Riveneuve d’une annexe sarthoise), toujours porté par le goût de l’écriture et du témoignage, il envisage d’écrire la suite. La matière est dense.






