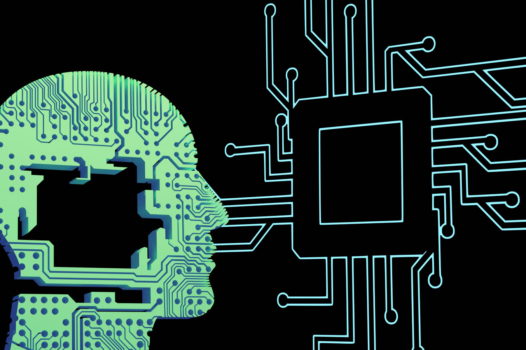Que doit être la contribution climat ?
dans l’hebdo N° 1073 Acheter ce numéro
Tout comme les cotisations sociales ne sont pas des charges, une contribution climat-énergie (CCE) écologiste ne doit pas être un impôt ordinaire, un simple prélèvement sur les revenus. Elle doit être la contribution de la société à son impact sur le dérèglement climatique et la destruction des ressources énergétiques non renouvelables comme le pétrole ou le gaz, la mesure de ce que les économistes appellent une externalité négative. Elle ne peut pas se résumer à une simple hausse des prix car celle-ci reste minime par rapport aux conséquences de la raréfaction du pétrole ou aux coûts du dérèglement climatique. Le rapport Stern a évalué le coût de l’inaction contre le changement climatique à un minimum de 5 500 milliards d’euros sur dix ans.
La CCE est donc différente de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La hausse du prix des carburants est inéluctable, CCE ou pas !
Mais pour cela, une véritable CCE doit respecter des conditions que le prochain projet gouvernemental ne respecte pas. Tous les gaz à effet de serre (GES) doivent être concernés : pas uniquement le gaz carbonique (75 % des GES), mais aussi le méthane ou le protoxyde d’azote. Car sinon, cela exclut certains secteurs agricoles ou celui des déchets. Ensuite, aucun secteur industriel ne doit être exclu de la contribution. Or, le projet actuel exonère la grande industrie (38 % des émissions) au prétexte qu’elle est déjà imposée à travers le système européen d’échange de quotas d’émission. Ces quotas, alloués gratuitement jusqu’en 2012, modifient à la marge le comportement des entreprises, voire peuvent accélérer la délocalisation de certaines d’entre elles, énergivores, qui vendraient leurs quotas aux secteurs non délocalisables comme les producteurs d’électricité. Nous ferions mieux d’en finir avec ce marché [[« Plaidoyer contre les marchés des droits de polluer », Jérôme Gleizes et Yann Moulier-Boutang,
Ecorev’, novembre 2000, http://ecorev.org/spip.php?article49.]].
L’énergie électrique est exclue de l’assiette alors que sa production représente 8 % des émissions françaises de GES. En exonérant l’électricité, l’objectif de maîtriser la consommation d’énergie s’éloigne, et c’est une prime cachée au nucléaire, compatible avec la logique gouvernementale de faire de celle-ci une énergie propre ! Ensuite, le prix de départ est trop faible pour avoir un effet [^2]. Il affectera plus les ménages pauvres, qui n’ont pas la possibilité d’utiliser des solutions alternatives de transport ou de chauffage, sans modifier les comportements des plus riches. Ce phénomène va être amplifié par le fait que le reversement de compensation sera identique pour tous. Pourtant, d’autres pays, comme le Danemark, la Finlande, la Suède, ont mis en place des fiscalités carbone plus élevées avec des effets positifs sur la réduction de l’émission des GES. Ce prix est d’autant plus faible que nous ne connaissons pas le taux de progressivité annuel prévu.
Mais notre critique principale est qu’une politique efficace contre le dérèglement climatique ne peut reposer uniquement sur des mesures fiscales et incitatives. Il faut diminuer la consommation des ressources non renouvelables et l’émission de gaz à effet de serre avant que des mesures radicales de rationnement s’imposent ou que des changements climatiques irréversibles surgissent. Ce que les écologistes attendent de la CCE, ce ne sont pas les effets prix d’une taxe pigouvienne [^3] mais la mesure du coût de l’atteinte à la biosphère. Pour répondre à l’objectif de réduction des GES et de la consommation des ressources non renouvelables, il faut la compléter par des investissements ciblés permettant une décarbonisation de nos économies, une relocalisation des productions, une isolation thermique des lieux de vie, une réduction des transports routiers, une production d’énergies renouvelables… Mais il faudra aussi s’émanciper en se libérant des aliénations, à commencer par celle fondée sur le dogme de la croissance comme seule réponse à la crise économique.
[^2]: « Le prix du carbone », Benjamin Dessus, Politis , n° 1071.
[^3]: « À quoi sert la taxe carbone ? », Liêm Hoang-Ngoc, Politis n° 1067.
Pour aller plus loin…

« Rendre sa dignité à chaque invisible »

La révolution sera culturelle ou ne sera pas

Fabien Roussel : « Le temps est venu de la cohabitation »