Copenhague : l’heure du plan B
La conférence internationale de Barcelone, ultime réunion préparatoire au sommet des Nations unies, a pris acte de l’impossibilité de parvenir à un accord complet avant plusieurs mois.
dans l’hebdo N° 1076 Acheter ce numéro

On ne signera pas, à Copenhague, de traité de lutte contre le dérèglement climatique, tant les positions restent éloignées. C’est la conclusion de la conférence de Barcelone (qui s’est tenue du 2 au 6 novembre). Les négociations ne reprendront en plénière que dans la capitale danoise, lors du sommet des Nations unies (du 7 au 18 décembre).
Copenhague pourrait donc se contenter d’enregistrer une déclaration politique « contraignante »
– c’est-à-dire signée par des chefs d’État et de gouvernement [^2] –, annexée à des engagements de réduction des gaz à effet de serre de la part des pays qui y consentent, à défaut de consensus sur un objectif global. Quant à la conclusion d’un traité en bonne et due forme, elle pourrait attendre encore une année.
Ce demi-échec consommé n’est pas surprenant : la mauvaise nouvelle était contenue dans la très décevante conférence de Poznan, l’an dernier, qui consacrait une année de piétinements [^3]. La dernière ligne droite ne devrait cependant pas être morose, car la situation est beaucoup plus ouverte que pressenti. Le point sur le rapport de forces.
– Le poids des attentes. « Copenhague ou jamais » : le slogan n’est pas dévalorisé malgré l’aveu de Barcelone. La pression qui pèse sur les négociateurs ne devrait pas se relâcher, et il reste possible d’arracher des avancées significatives à Copenhague : personne n’envisage la perspective d’un vide juridique, que créerait un retard dans la signature d’un accord succédant au protocole de Kyoto, caduc après 2012 ; la mobilisation enfle au sein des opinions publiques, qui s’apprêtent à demander des comptes aux gouvernements trop timorés.
– Le laborieux retour des États-Unis. Il est acquis que le grand absent du protocole de Kyoto va regagner le cénacle international. Mais jusqu’où ? Échaudé par le précédent de Kyoto – le Congrès et Bush avaient refusé d’avaliser la signature apposée au bas du protocole –, Obama ne veut s’engager que soutenu par une loi nationale. Freinée par le puissant lobby charbonnier, elle ne devrait cependant pas être prête avant Copenhague. Pour 2020, l’horizon clé de Copenhague, les États-Unis ne sont actuellement prêts qu’à une baisse de 7 % de leurs émissions par rapport à leur niveau de 1990. Très loin de la référence définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) : les pays industrialisés devraient s’engager à hauteur de 25 à 40 %. Les États-Unis conditionnent aussi leur bonne volonté à un engagement de tous les pays – surtout les grands « émergents » (Chine, Inde, Brésil, etc.).
– La surenchère du Japon. Le pays, qui n’annonçait pas mieux que les États-Unis, a récemment porté son engagement à 25 % de réduction pour 2020 : de quoi motiver une Union européenne qui se voulait à la pointe de la bataille avec une « offre » à 20 %, mais qu’elle prétend pouvoir porter à 30 %.
– La main pour la Chine. Le pays est récemment devenu le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les États-Unis. Un « record » complaisamment popularisé par les pays occidentaux, afin de masquer qu’ils portent à 75 % la responsabilité historique de l’accumulation de ces gaz dans l’atmosphère. Mais cette publicité se retourne aussi contre eux : la Chine apparaît aujourd’hui maîtresse du jeu. Aucun accord sérieux ne peut désormais aboutir sans son engagement, mais aussi celui des autres grands pays émergents. Premier pas : la Chine consent à réduire ses émissions par point de PIB gagné ; mais elle n’entend pas négocier sa croissance économique, et réclame des pays industrialisés – États-Unis en tête – un engagement de réduire leurs émissions de 40 % au moins en 2020 !
– La motivation des pays pauvres. Cette dernière demande est soutenue par l’ensemble du groupe dit G77 des principaux pays du Sud. Dont les Africains, qui ont brièvement quitté la table des négociations à Barcelone. Une première qui a fait sensation, motivée par la grande faiblesse des propositions financières des pays riches. Un calcul européen officiel estime à 110 milliards d’euros les sommes nécessaires aux pays du Sud pour qu’ils s’adaptent au dérèglement climatique et réduisent leurs émissions.
À ce jour, l’Union européenne, principal acteur à s’être exprimé sur le sujet, n’envisage de participer qu’entre 2 et 15 milliards, suggérant que l’effort soit en partie financé par les marchés de quotas de CO2, mais aussi par une contribution des pays du Sud, ce qu’ils refusent, estimant que le Nord porte l’essentiel de la « dette climatique ».
– Le cri d’Aosis. Poussière de populations, l’alliance Aosis, qui regroupe 49 petites nations insulaires, est cependant parvenue à s’imposer comme la mauvaise conscience des nations : une hausse de 2 °C de la moyenne planétaire des températures, déjà plus que probable, condamnerait à la submersion plusieurs de ces îles, qui ne manquent pas une occasion de dénoncer par avance les responsables du drame qui les menace.
[^2]: Une quarantaine d’entre eux sont déjà pressentis, y compris Barack Obama.
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes
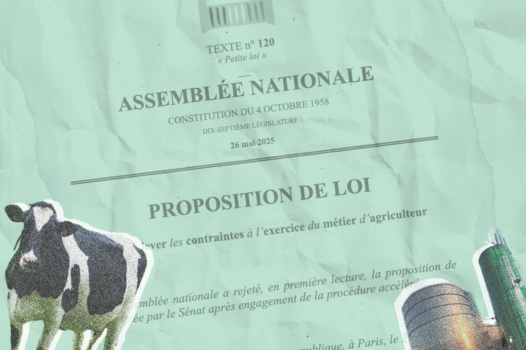
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides







