Didier Tabuteau : « Il faut un débat sur l’assurance maladie »
Signataire d’un appel à sauver la Sécurité sociale, Didier Tabuteau défend un système de soins accessible à tous et participatif.
dans l’hebdo N° 1268 Acheter ce numéro
Didier Tabuteau, qui publie un essai sur la démocratie sanitaire [^2], en explique la nécessité et le fonctionnement. Il analyse également les dysfonctionnements actuels de notre système de soins.
Un appel à sauver la Sécurité sociale est paru le 25 août, les initiatives pour changer le système de santé se multiplient. Qu’est-ce qui bloque ?
Didier Tabuteau : Cet appel prend position « pour un débat public sur la santé ». L’assurance maladie et les complémentaires doivent faire l’objet d’un débat public. C’est aussi important que les retraites, l’éducation ou l’emploi. Or, particularité française, les débats politiques portent rarement sur des questions de santé. Il y a des raisons historiques : les optimistes disent que c’est parce que le système fonctionnait bien. Les autres estiment que c’est parce qu’il est trop complexe. Surtout, la maîtrise du système a longtemps été déléguée au corps médical. Puis la démocratie sociale s’en est vue confier les manettes en 1945. L’État ne pilote que depuis la création du service public hospitalier en 1970. Les conséquences ne s’en font pas encore sentir alors que l’attente de la population est forte. Cela dit, les récents appels à changer le système ne sont pas restés sans effet : les débats sur les déserts médicaux ou les dépassements d’honoraires sont le signe d’un mouvement, même modeste. Le débat sur la Sécurité sociale n’a pas encore trouvé place.
Qu’est-ce que la démocratie sanitaire ?
Il y a la démocratie politique, la démocratie sociale et, depuis les années 1990 – du fait de l’épidémie de sida, du téléthon, des associations de malades –, la démocratie sanitaire. Soit l’idée que les questions de santé supposent l’intervention des associations et des patients. Tout le monde doit pouvoir participer aux grandes décisions concernant le système de santé parce que la protection de la santé est une des composantes du contrat social. L’ambition étant de défendre l’accès de tous à des soins de qualité ainsi qu’à la prévention.
En matière d’accès aux soins, le système n’a-t-il pas reculé ?
Le système crée des inégalités par manque d’organisation et de coordination. Il souffre de grosses disparités territoriales. En outre, le reste à charge pour les patients a augmenté. Aujourd’hui, hors affections longue durée (ALD) et hospitalisation, le taux de remboursement pour les soins courants est d’environ 50 %. C’est donc le niveau d’assurances complémentaires qui est déterminant pour supporter les restes à charge. 94 % de la population bénéficient d’une complémentaire, mais on observe une dégradation du niveau de protection complémentaire. Ces assurances sont très inégalitaires et la concurrence a des effets pervers.
La solution serait-elle de revenir à un fort taux de prise en charge par la Sécurité sociale ?
Il faudrait en effet augmenter ce taux de prise en charge, mais cela suppose de réorienter les sommes que la collectivité consacre aux complémentaires via les primes d’assurance, mais aussi certaines exonérations fiscales et sociales, vers l’assurance maladie. Les complémentaires doivent rester complémentaires et non se substituer à la Sécurité sociale. Le problème, c’est que le financement de l’assurance maladie repose sur des prélèvements obligatoires, pas les complémentaires. Il semble cependant que l’attachement à un système de prise en charge qui soit le même pour tous persiste, même si les éléments de la solidarité sont plus difficiles à identifier.
Quelle forme donner à ce débat ?
Les états généraux sur les droits des malades en 1998 ont été une expérience vraiment intéressante. Il doit y avoir un débat au niveau régional mais nous avons également besoin d’une négociation nationale avec tous les acteurs : professionnels de santé, associations de patients, partenaires sociaux, complémentaires et État. Il faut redéfinir les règles du jeu.
[^2]: Démocratie sanitaire, les nouveaux défis de la politique de santé , Didier Tabuteau, Odile Jacob, 286 p., 23,90 euros.
Pour aller plus loin…

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »
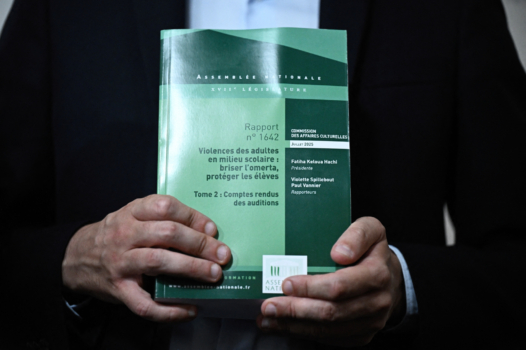
Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »







