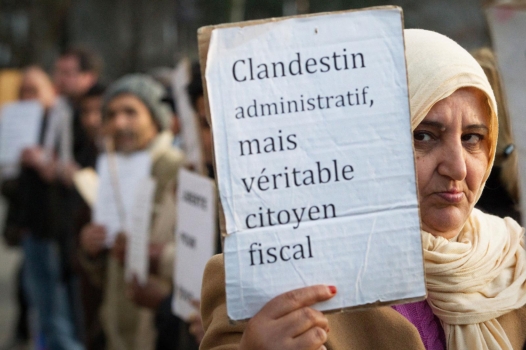Soins palliatifs, la fin d’un tabou ?
Après la conférence de citoyens sur la fin de vie, on a beaucoup parlé de la légalisation de l’euthanasie, moins de la médecine palliative. Il est pourtant urgent de la développer massivement.
dans l’hebdo N° 1285 Acheter ce numéro
Les soins palliatifs érigés en cause nationale, c’est possible ? Le 16 décembre 2013, la conférence de citoyens sur la fin de vie s’est prononcée pour un droit au suicide assisté et des exceptions d’euthanasie (voir Politis n° 1282). Ces préconisations ont été abondamment relayées parce qu’elles vont beaucoup plus loin que celles rendues notamment par le Comité consultatif national d’éthique. Pour autant, elles ne figuraient pas en tête de l’avis de la conférence de citoyens, réclamant un développement massif des soins palliatifs. L’information n’a pas frappé tant il est de bon ton de défendre les soins palliatifs a priori. Mais rendre égalitaire
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »