Notre-Dame-des-Landes : Un demi-siècle d’entêtement
Cinquante ans après son émergence, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est devenu l’emblème des « grands projets inutiles », cristallisant une opposition de plus en plus résolue.
dans l’hebdo N° 1411 Acheter ce numéro

Qui sont les entêtés ? Si Notre-Dame-des-Landes est « la plus vieille et longue lutte foncière de France », comme l’affirme l’opposant local Julien Durand, c’est que le projet d’aéroport remonte à la fin des années 1960. Et sa survivance en 2016, avec une ambition à peine retouchée, raconte l’invraisemblable résilience d’une idée accouchée des Trente Glorieuses, rescapée des chocs pétroliers, insensible à la crise économique, et méprisant désormais la crise écologique.
Au début des années 1970, le doigt des ingénieurs de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire (Datar) désigne un bocage niché entre Nantes et Saint-Nazaire : Notre-Dame-des-Landes. Idéal pour un aéroport international – futur « Rotterdam aérien » de l’Europe pour une future « Ruhr du XXIe siècle », s’enthousiasment des élus. « Le projet ressortait à chaque élection locale », raconte Sylvain Fresneau, exploitant sur cette aire convoitée. En 1974, elle devient « zone d’aménagement différé » (ZAD) pour que le conseil général puisse peu à peu préempter les terres disponibles, « pour un futur projet qui n’était jamais débattu », précise-t-il.
L’aéroport était taillé pour accueillir le Concorde et jusqu’à 9 millions de passagers par an en 2000, quand celui de Nantes-Atlantique, au sud de Nantes, est actuellement deux fois moins fréquenté. Une surface de 1 220 hectares de terres (1 650 ha, plus tard) est promise au bétonnage : les agriculteurs sont les premiers à se mettre en branle, au sein de l’Adeca [^1]. À l’époque, ils sont plus enclins à la négociation qu’à la jacquerie, d’autant que les chocs pétroliers mettent bientôt en sommeil le projet pharaonique.
Surprise : le plan ressurgit dans les années 1990. Jean-Marc Ayrault, député-maire socialiste de Nantes, a de grandes ambitions pour sa région. La conquête de l’aéroport devient sa marotte. « Plus que tout autre, juge Geneviève Coiffard, membre d’Attac, il est l’âme damnée du projet » – l’Ayraultport, se moquent les détracteurs.
De plus en plus nombreux, les « anti » s’associent en 2000 au sein de l’Acipa [^2], ouverte à tout citoyen. Car l’affaire devient sérieuse. La machine étatique s’est mise en branle. Soutenu par des élus locaux dont il maîtrise les investitures, l’influent Ayrault a trouvé l’oreille du gouvernement Jospin et de son ministre des Transports, le communiste Jean-Claude Gayssot, dont le parti défend le projet jusqu’à ce jour.
Le débat public est houleux. La moutarde monte encore au nez de Sylvain Fresneau à l’évocation de cet énarque hautain « venu de Paris » imposer ses vues. « Une tête à claques, il a largement contribué à faire prendre la mayonnaise de la résistance ! » Jusqu’alors pilotée par un élu socialiste prêt à des compromis sur l’implantation de l’aéroport, l’Acipa se radicalise : ça sera désormais « ni ici, ni ailleurs ! ». Les environnementalistes se rallient, ainsi que les Verts et les Alternatifs. Tous se retrouvent dès 2003 au sein d’une Coordination des opposants – passée depuis de 14 à plus de 50 organisations.
Ce premier grand front ne parvient cependant pas à faire dérailler l’enquête publique (2006-2007), ni la déclaration d’utilité publique (2008), ni l’attribution de la concession à Vinci deux ans plus tard. Sur la ZAD, les expropriations sont lancées. L’étau se resserre. En quête de soutiens à l’extérieur, les opposants organisent alors à Notre-Dame-des-Landes, du 3 au 9 août 2009, le premier « camp climat » de France, à l’image de ces rassemblements que les activistes anglais installent près de sites industriels nocifs pour le climat.
Décisif : « À partir de ce moment, le mouvement nous échappe », se réjouit Dominique Fresneau. Il y a beaucoup de jeunes, adeptes de l’autonomie et de l’autogestion. Les « historiques » les appellent à rester. Ils seront entendus.
Un premier squat s’ouvre au Rosier. Les nouveaux venus rebaptisent la ZAD en « zone à défendre » et s’installent par dizaines dans des fermes et des maisons expropriées ou des cabanes construites selon leur inspiration. « Cette stratégie d’occupation du terrain se révélera déterminante pour la lutte », souligne Françoise Verchère, alors vice-présidente du conseil départemental et qui s’y engage à travers le Cédpa naissant [^3], collectif d’élus comptant aujourd’hui plus d’un millier de membres. La solidarité paysanne s’élargit : en 2011, des agriculteurs de Loire-Atlantique créent le Copain 44 [^4], qui essaimera dans les départements voisins. « Cette gauche -paysanne braquée contre l’aéroport, ça a collé une sacrée épine dans le pied d’Ayrault, témoigne Marcel Thébault, encore exploitant sur la ZAD. L’opposition s’étendait et devenait un mouvement populaire, ce qu’il tentait d’éviter à tout prix. »
Sur la ZAD, la situation se tend de plus en plus. Les paysans et les habitants qui ont refusé l’expropriation à l’amiable se voient signifier une mesure d’expulsion prochaine. Au printemps 2012, quelques-uns d’entre eux se mettent en grève de la faim et interpellent le candidat Hollande. Favori de la présidentielle, celui-ci impose prudemment un moratoire à Ayrault, Premier ministre pressenti : pas d’expulsions avant l’épuisement des recours juridiques déposés par les familles.
Mais il ne sera jamais question de débattre du bien-fondé du projet. Le gouvernement, qui a compris que les « zadistes » entravent toute intervention des pelleteuses, déclenche le 16 octobre l’opération César pour les évacuer de force. En vain. Jusqu’à 1 200 policiers et gendarmes affrontent une guérilla très pugnace. Le 17 novembre, une manifestation de 40 000 personnes engage même la réoccupation de la ZAD. Ayrault et Valls (son ministre de l’Intérieur) leur concèdent une commission de dialogue et des études complémentaires. « Ils ont surtout provoqué l’explosion de la mobilisation au niveau national, et même européen », constate Dominique Fresneau. Des « comités Notre-Dame-des-Landes » se créent partout : plus de 200 à ce jour.
Le rapport de force a changé. En 2013, il poussera Hollande à étendre le moratoire : pas de chantier avant l’épuisement de tous les recours – contre les expulsions mais aussi les infractions environnementales, etc. Pourtant, Valls anticipe. Fin 2015 (à la veille de la COP 21 !), il annonce les premiers travaux pour le printemps suivant. Nouvelle ébullition : début 2016, des milliers de manifestants bloquent le périphérique nantais, puis la nationale Nantes-Vannes. Et le 11 février le Président annonce la tenue d’une consultation, organisée le 26 juin.
Le mouvement des « anti » a déjà dit tout le mal qu’il pensait de cette manipulation. Sera-t-il suivi ? Les 9 et 10 juillet, il invite à un rassemblement à Notre-Dame-des-Landes, comme tous les ans [^5]. L’ampleur de la mobilisation sera déterminante pour la suite de la lutte, dès l’automne prochain.
[^1] Association de défense des exploitants concernés par le projet d’aéroport
[^2] Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
[^3] Collectif d’élus doutant de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
[^4] Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par l’aéroport Notre-Dame-des-Landes.
[^5] Voir www.acipa-ndl.fr
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes
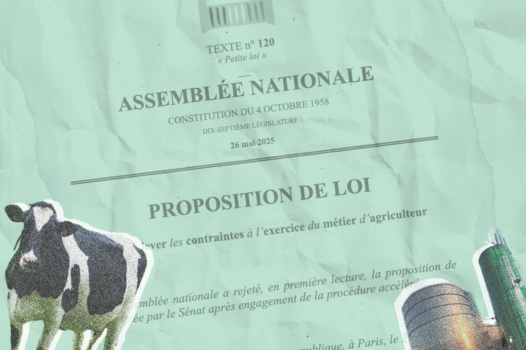
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides







