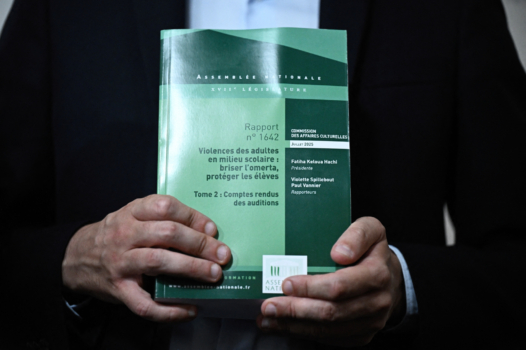Questions après Nice
Des sociologues, des psychanalystes, des syndicalistes, des spécialistes du jihadisme nous livrent leur analyse d’un événement qui a bouleversé notre pays.
dans l’hebdo N° 1413-1415 Acheter ce numéro

Le massacre commis par un homme qui a jeté son camion dans la foule des promeneurs, fauchant 84 vies au soir du 14-Juillet à Nice, ne cesse d’interroger notre société. Qui était-il ? Avait-il des liens avec Daech ? Pouvait-on éviter le crime ? Que penser de la réaction des politiques ? Cet événement est-il en rapport avec la situation en Syrie et en Irak ? Politis a interrogé plusieurs spécialistes.
Quels effets la tragédie de Nice peut-elle avoir sur la société française ?
Le sociologue Michel Wieviorka [^1] note combien le consensus, cette fois, s’est rapidement « dissous », notamment du fait de la logique « hautement conflictuelle » de la campagne présidentielle. Pour le psychanalyste Gérard Haddad [^2], la société française va désormais vivre « dans une réelle angoisse », doublée d’un « effet dépressif qui peut vite se traduire par une certaine violence, à l’instar des huées accueillant à Nice Manuel Valls, venu pour la cérémonie d’hommage aux victimes. Mais le risque principal est bien sûr une montée encore plus forte de la haine des musulmans, dans une recherche du bouc émissaire classique en ce cas ». Pourtant, ces risques de réactions violentes au sein de la société tiennent aussi, pour Michel Wieviorka, « à la crise politique actuelle » après que le pouvoir a « hystérisé le pays avec une loi travail rejetée par les trois quarts de la population »…
La démocratie française peut-elle être en danger ?
Les principes de la démocratie sont d’ores et déjà bien entamés, notamment avec la quatrième prorogation de l’état d’urgence, annoncée au lendemain de l’attentat.
Pour la présidente de la Ligue des droits de l’homme (LDH), Françoise Dumont, « la loi Urvoas, par les compétences sécuritaires qu’elle octroie à l’exécutif, organise déjà une sorte d’état d’urgence sans état d’urgence. Il y a donc lieu de considérer notre démocratie en danger, car l’équilibre entre les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif est rompu au profit du seul exécutif. En habituant en outre les gens à l’idée qu’on peut se passer du pouvoir judiciaire ; comme si on ne pouvait pas faire confiance aux juges ! ». Une « dérive autoritaire », selon elle, qui a pourtant une efficacité plus que limitée contre les attaques terroristes. Mais qui peut constituer une menace pour les militants, opposés à la loi travail, par exemple.
Les dispositifs sécuritaires au niveau des municipalités sont-ils efficaces ?
« Si Paris avait été équipée du même matériel que nous, avait déclaré Christian Estrosi, le 19 janvier 2015, lors d’un conseil municipal extraordinaire sur la sécurité convoqué après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, les frères Kouachi n’auraient pas passé trois carrefours sans être repérés. » L’homme fort de Nice, ville qui compte la police municipale la plus nombreuse de France – 357 agents en 2015 et armés –, et le plus important réseau de caméras – la capitale de la Côte d’Azur en compte 1 257, soit une pour 270 habitants –, a fait depuis son accession à la mairie, en 2008, de la sécurité son cheval de bataille. Et s’il n’est plus officiellement maire depuis le 13 juin, il conserve la sécurité dans ses attributions de premier adjoint au maire. Toutefois, il ne suffit pas de rebaptiser « vidéoprotection » la « vidéosurveillance », ce qu’a fait en 2011 le gouvernement Fillon avec la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « loi Loppsi », pour protéger réellement les citoyens. Face à l’irruption du camion tueur sur la promenade des Anglais, le 14-Juillet, ce matériel n’a pas été d’une grande utilité. Et Christian Estrosi, qui, à l’automne dernier, alors qu’il était candidat aux régionales, promettait aux électeurs de « renforcer [leur] sécurité dans [leur] région », affirme désormais que « toutes les missions de sécurité relèvent de l’État et non des collectivités ».
Que penser de l’attitude des politiques ?
Les réactions des dirigeants d’extrême droite mais aussi de la droite, ont dépassé toute décence. Des lance-roquettes, dont Henri Guaino veut équiper les militaires de « Sentinelle », à l’état de siège, que voudrait instaurer Frédéric Lefebvre, ce fut un festival de surenchères guerrières. Dans cette compétition qu’attise la primaire présidentielle, la plus surprenante (et inquiétante) est encore la brusque radicalisation d’Alain Juppé : « Si tous les moyens avaient été pris, le drame n’aurait pas eu lieu », a-t-il affirmé sur RTL alors que des victimes gisaient encore sur la promenade des Anglais. Le maire de Bordeaux aurait-il oublié qu’en 1995, quand il était Premier ministre, la France a connu six attentats islamistes qui ont fait 8 morts et 273 blessés ? Même Nicolas Sarkozy a jugé qu’il n’était « pas raisonnable de dire que si on avait fait ceci ou cela, l’attentat n’aurait pas eu lieu ». Ce qui n’a pas empêché l’ancien président de la République d’affirmer sur TF1 que « tout ce qui aurait dû être fait depuis dix-huit mois ne l’a pas été » pour mieux rappeler ses propositions : bracelet électronique ou placement en centre de rétention des individus soupçonnés de radicalisation, fermeture des lieux de culte… Au passage, le président de LR a par deux fois parlé de « terrorisme islamique » usant d’un adjectif désignant, de façon tout à fait irresponsable, l’islam tout entier comme l’ennemi.
Qu’en est-il de l’évolution des effectifs de police depuis 2012 et du renseignement ?
Alexandre Langlois, secrétaire général de la CGT Police: « Sous Sarkozy, nous avons subi 12 000 suppressions de postes. Certes, depuis 2012, il y a eu un recrutement de 9 000 postes, mais ça fait toujours une différence de 3 000. Face à l’emballement, ils ont eu recours à un recrutement massif mais imparfait. Par exemple, au garage de la police à Paris, des gardiens de la paix sont utilisés comme mécanos ! Et la dernière promotion, sortie de l’école de police en juin, n’a pas pu faire le stage de trois mois qui conclut l’année de formation normalement. Ils ont été directement envoyés sur les fan-zones parisiennes. Dans ce contexte de menace terroriste, c’était un double risque. Nous sommes dans du palliatif, avec des gens qui apprennent sur le tas. Le plan Sentinelle donne un sentiment de sécurité, mais cela ne sécurise rien. Idem pour la réserve opérationnelle et l’état d’urgence : cela n’empêche pas les attentats. Nous ne voulons plus être l’alibi com’ du gouvernement.
Le renseignement territorial est basé sur les sources humaines. Or, on leur dit de ne plus y avoir recours. Pour l’anti-terrorisme, cela consiste à se rendre dans les mosquées pour rencontrer les imams qui nous alertent parfois. Notre boulot est de vérifier si la personne est seulement très imprégnée de sa religion ou si c’est une déviance. Il faut reconnaître que le gouvernement a renforcé les effectifs mais pas les moyens pour travailler. Par exemple, nous manquons de véhicules, donc nous ne pouvons pas aller sur place. Pareil dans les bureaux. Ils ont mis en place un filtrage interne pour les sites sensibles et dès que nous les consultons, nous laissons une trace leur indiquant : “Le ministère de l’intérieur a consulté votre site.’’ Face à tous ces dysfonctionnements, Cazeneuve n’a qu’une excuse : les services de renseignement européens ne nous donnent pas d’information. »
Que nous dit le profil du tueur de Nice ?
Raphaël Liogier, sociologue [^3] : « Nous ne sommes plus face à un terrorisme de radicalisation comme dans les années 1990. Le ministre de l’Intérieur parle de “radicalisation rapide”. On pourrait dire express ! On glisse vers une forme de déprofessionnalisation d’un terrorisme disséminé sans cellules ni filières. Le tueur de Nice était un homme pris dans un délire narcissique et de vengeance qui battait sa femme et entretenait un rapport étrange avec son corps : il faisait beaucoup de musculation, consommait des protéines en permanence, se prenait en photo, était obsédé sexuel… Un profil de frustration et de quête de virilité qu’on a pu rencontrer déjà avec Amedy Coulibaly, un des tueurs de janvier 2015. En d’autres temps, le tueur de Nice se serait peut-être livré à un crime “ordinaire”, comme les tueries de masse qu’on observe aux États-Unis, ou ne serait pas passé à l’acte. Aujourd’hui, Daech fournit à qui veut un kit de héros clé en main. Plus besoin de Kalachnikov : une arme blanche peut suffire, ou simplement pousser des gens sur les rails du métro ! Et 100 000 policiers supplémentaires ne pourront empêcher de tels actes. Ce qu’il faut, c’est arrêter de faire le jeu de Daech en faisant croire, par exemple, que de tels ninjas ralliés en deux clics sont des fondamentalistes : jusqu’à récemment, le tueur de Nice ne faisait pas la prière, mangeait du porc, buvait de l’alcool, ne portait pas la barbe, etc. Il n’a pas “basculé” dans la radicalisation : il a trouvé dans Daech, qui truste le marché, la justification glorieuse d’un passage à l’acte. »
Patrick Amoyel, psychanalyste, directeur des recherches freudiennes et fondateur de l’association Entre’Autres à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis : « Les dernières révélations concernant le tueur de Nice montrent qu’il visionnait des vidéos de décapitation depuis des mois et qu’il était en contact avec des individus radicalisés. À Entr’Autres, on dit qu’il ne peut y avoir de radicalisation rapide. Certains sautent de la case “rupture identitaire” aux cases “radicalisation religieuse” et “radicalisation politique” sans passer par la case “pratique religieuse”, et portent en eux un “être terroriste”, ce qui ne veut pas dire qu’ils vont forcément passer à l’acte. La bascule rapide, c’est dans le sentiment de culpabilité : quelque chose leur fait brutalement prendre conscience que la seule issue pour effacer leur montagne de péchés est le martyre. Le tueur de Nice ne fréquentait pas la mosquée, mais tout le monde autour de lui la fréquentait. »
Le gouvernement a-t-il une responsabilité dans l’attentat de Nice ?
Raphaël Liogier : « Quelques heures après l’attentat de Nice, le Président a déclaré qu’il s’agissait d’un acte islamiste avant même qu’il soit revendiqué par Daech. Dans le monde arabe, sa phrase sur “la guerre contre l’islamisme” a été traduite par “guerre contre l’islam”. En outre, la France est le seul pays où une philosophe féministe (Élisabeth Badinter), qui condamne une prétendue “mode islamique”, est relayée par le Premier ministre lui-même, alors même que cette mode pourrait être perçue comme un signe d’intégration : les jeunes filles qui se retrouvent dans le modest clothing, soit des tenues religieuses discrètes, sont vilipendées par les radicaux sur les réseaux sociaux. Ça n’est qu’un exemple. Depuis deux ans, le gouvernement accroît les frustrations. »
Les attentats viennent-ils en représailles à des défaites de Daech en Irak et en Syrie ?
Jean-Pierre Filiu, historien [^4] : « La dynamique de Daech associe de manière dialectique les combats territoriaux et les projections internationales. Celles-ci ne sont pas forcément la conséquence de ceux-là, mais participent toujours d’une dynamique d’ensemble dont je suis contraint de reconnaître qu’elle est en extension. »
Est-il vrai que Daech est en recul en Irak et en Syrie ?
Jean-Pierre Filiu : « Il n’y a aucun recul de Daech. En Syrie, l’organisation a profité de la concentration de l’offensive russo-Assad contre Alep pour regagner du terrain, notamment dans la zone de Palmyre. En Irak, Falloujah est une victoire à la Pyrrhus. D’abord, parce qu’elle a été ressentie comme un désastre par la population arabe sunnite à cause de l’arrivée dans la ville de milices chiites. Ce qui renforce cette aliénation sunnite sur laquelle prospère Daech. D’autre part, juste après cette libération, Bagdad a été frappé par le pire attentat depuis 2003, ce qui aurait dû faire méditer sur la dimension de cette “victoire” et de la chute de Falloujah. Enfin, nous parlons, chaque fois, de territoires ou de villes qui ont été conquis en quelques semaines ou en quelques jours par Daech, mais dont la reconquête mobilise des moyens exorbitants. Ce qui, d’ailleurs, ne permet pas de mener une action sur d’autres fronts en même temps.
Cette dynamique favorable à Daech ne peut être cassée qu’au centre, c’est-à-dire à Raqqa ou à Mossoul. Non pas parce que c’est une organisation hiérarchisée classique, mais parce que c’est uniquement par un coup au centre que peut être affrontée l’énormité du défi planétaire lancé par Daech. Mais pour cela, il faut des sunnites crédibles. Le problème, c’est que, nulle part, il n’y a une alternative arabe et sunnite à Daech. Une population civile qui tombe aux mains de Kurdes en Syrie, ou de chiites en Irak, craint pour sa propre existence. Il faut ajouter que l’offensive des Russes et du régime syrien contre les rebelles à Alep et la quasi-validation américaine ouvrent un boulevard à Daech. Si le monde entier est uni contre les Arabes sunnites, alors Daech va prospérer. »
[^1] Dernier ouvrage paru : Le Séisme. Marine Le Pen présidente, Robert Laffont, 2016.
[^2] Dernier ouvrage paru : Dans la main droite de Dieu, Premier Parallèle, 2015.
[^3] Dernier ouvrage paru : La guerre des civilisations n’aura pas lieu, CNRS éditions, 2016.
[^4] Dernier ouvrage paru : Les Arabes, leur destin et le nôtre, La Découverte, 2015.
Pour aller plus loin…
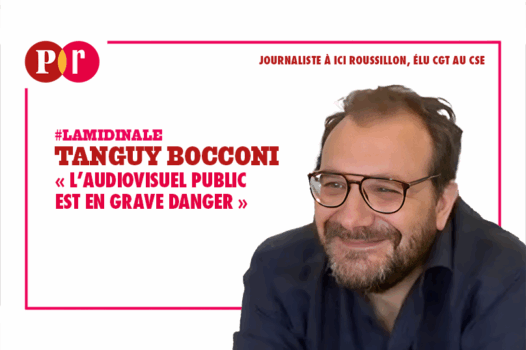
« L’audiovisuel public est en grave danger »

Audiovisuel public : malgré les audiences, une volonté de reprendre la main politiquement

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »