« Taba-Taba », de Patrick Deville : Une famille dans le monde
En dépliant son histoire familiale sur quatre générations, Patrick Deville signe avec Taba-Taba un roman global, érudit et passionnant.
dans l’hebdo N° 1467 Acheter ce numéro

Alexandre Yersin, le découvreur du bacille de la peste, Trotski, Malcolm Lowry… Patrick Deville a pris pour figures principales de ses derniers livres – Peste & Choléra, Viva [1] – des personnages qui ont laissé une marque dans l’histoire. Même si le fil de ses récits croise aussi des anonymes, découverts dans des textes ou réellement rencontrés par l’auteur, qui y mêle en outre des éléments personnels. Voici que Taba-Taba est l’exact inverse de ce qui précède. Non seulement les héros de ce nouvel opus sont des gens qui ont été ballottés par les événements, et par « les dieux marionnettistes », mais tous sont liés de près à Patrick Deville : l’écrivain publie là en effet son roman familial.
Un projet dont la réalisation s’appuie sur un trésor : une immense somme d’archives que sa tante Simonne, dite Monne, a constituée tout au long de sa vie, et qui est revenue à l’auteur quand celle-ci est décédée, à 90 ans. Elle gardait tout – lettres, journaux, factures… y compris ce qui lui était parvenu de ses grands-parents, nés autour de 1860. Une aubaine autant qu’un fardeau, au sens premier du terme, l’auteur, peu sédentaire, se déplaçant souvent avec de lourdes valises pleines de ces archives longues à explorer.
Patrick Deville fait ainsi entrer quatre générations dans Taba-Taba, à partir de ses arrière-grands-parents : Eugénie-Joséphine, quittant Le Caire pour la France à 4 ans, en 1862, et son futur mari, Alexandre Pathey, hussard noir de la République ; leur fille Eugénie, qui a épousé Paul, gymnaste et professeur d’éducation physique ; leurs enfants, Paul-Eugène, dit Loulou, le père de l’auteur, et Monne, sa tante ; et enfin lui-même.
C’est quand il est tout enfant que le roman s’ouvre, au début des années 1960. On le voit dans le parc du Lazaret, un hôpital psychiatrique où son père a trouvé, faute de mieux, un emploi de gardien, situé à l’embouchure de l’estuaire de la Loire, en face de Saint-Nazaire. C’est là qu’il vécut jusqu’à 8 ans. Il y resta immobilisé une année entière à cause d’une opération à la jambe. Et fit alors sa première lecture, fondatrice, Le Tapis volant, récit l’entraînant déjà dans bien des voyages. Lazaret est resté toute sa vie son point d’ancrage, avec, comme compagnon invisible aux autres, ce Taba-Taba qui donne le titre au livre, un pensionnaire, « solitaire ténébreux », qu’il avait élu, enfant, comme camarade.
Mais les chapitres suivants portent d’autres débuts possibles. « Elle pourrait constituer le point de départ de l’enquête : c’est une photographie en noir et blanc de 1956 comme on les tirait à l’époque… » Deux pages plus loin : « Mais c’est un siècle plus tôt, en 1858, de l’autre côté de la Méditerranée, que tout cela pourrait aussi bien commencer… »
Qui a déjà lu Patrick Deville sait que Taba-Taba ne peut ressembler à une saga linéaire et ethnocentrée. Tout en se fondant sur des faits attestés, l’auteur, « obnubilé par les éphémérides, les coïncidences de dates et de lieux », et convaincu à raison que « nos vies ne sont pas chronologiques », emporte immanquablement son lecteur dans un périple à travers l’espace et le temps, enjambant les frontières habituelles. Une union de la géographie et de l’histoire qu’il concrétise lui-même physiquement à bord d’une Passat, avec laquelle il relie tous les endroits que ses ascendants ont connus, créant au présent un jeu d’échos temporels. Et si, en outre, il ne cesse d’arpenter notre planète, y compris pour mener à bien son enquête, c’est afin de faire bénéficier son regard de changements d’échelle : « Après avoir plongé dans le passé de la France comme au fond de la mer en apnée, je remontais m’asseoir sur la grève d’une chambre d’hôtel lointaine, tentais de retrouver mon souffle et un point de vue satellitaire, de voir tout ça de loin, d’éviter la myopie du gallocentrisme. »
Ainsi de l’instituteur Alexandre Pathey, dont les différentes affectations ne l’ont jamais exilé d’Île-de-France, mais que l’auteur montre en train de lire un journal local, L’Abeille d’Étampes du 26 août 1899, le propulsant (et le lecteur avec) vers des tragédies lointaines : à Dankori, au Soudan, au cœur des conquêtes coloniales destructrices. Tristes aventures dont l’enseignant ne pourrait apprendre l’existence à ses élèves s’il le souhaitait, empêché par le « règlement des écoles primaires publiques du département de Seine-et-Oise », dont l’auteur livre des extraits.
Ainsi de la Première Guerre mondiale, que Paul, blessé en 1914 puis fait prisonnier au début de 1915, ne voit pas s’internationaliser. Une période sur laquelle Patrick Deville a des pages particulièrement fortes à propos de la pollution laissée par les combats, notamment en plomb et en mercure, et sur la persistance – sept siècles, estime-t-on – de cette zone rouge dans la région de Verdun. Mais, précise-t-il, ce n’est rien par rapport à Tchernobyl, et moins encore si l’on considère les déchets nucléaires qu’on projette d’enterrer « tout au sud de ce département de la Meuse, sous le village de Bure ».
La Seconde Guerre mondiale occupe un gros morceau de Taba-Taba, où la narration se fait moins elliptique. C’est que Patrick Deville détient de nombreux documents, dont les journaux intimes des protagonistes, parfois tenus en même temps mais à des endroits différents, ce qui donne un effet de simultanéisme saisissant. La famille, en effet, est éclatée. Paul, la cinquantaine, s’engage volontairement le 1er mai 1940, et va errer, au gré de la débâcle, de caserne en caserne. Eugénie, Monne et Loulou restent, au terme de l’exode, dans le Sud-Ouest.
On suit par le menu leurs péripéties jusqu’à leurs retrouvailles, y compris l’entrée en Résistance de Loulou, qui intègre un maquis. L’auteur aurait pu en profiter pour chanter l’héroïsme de son propre père, ce dont il s’abstient. En revanche, il ne manque pas de rappeler certains épisodes tragiques. Comme le sacrifice, à Saint-Nazaire le 28 mars 1942, de soldats anglais, écossais et canadiens pour détruire l’écluse fortifiée construite par les Allemands. Ici, comme à plusieurs autres endroits, Patrick Deville en tire une leçon plus générale, à la manière d’un moraliste, sur le comportement de ses contemporains ou sur le monde tel qu’il va : « En hommage à ces héros, il nous est à présent interdit d’être triste ou malheureux, sinon à quoi bon leur sacrifice », conclut-il, ce qui est discutable.
Érudit, Taba-Taba est aussi une mine à anecdotes et à citations où les écrivains tiennent bonne place. Parmi eux se distinguent Malraux, Larbaud, Cendrars, ainsi que Chateaubriand et Hugo – « deux bons camarades de voyage » –, celui-ci notamment par ses prises de position anticolonialistes, isolées, si précieuses. On apprend notamment que l’hymne polonais contient le nom de Bonaparte, que le siècle de « l’an 40 » dont on « se moque » n’appartient pas au passé, ou que le palais Clam-Gallas, à Vienne, qui abritait l’Institut français, a été vendu par la France au Qatar.
Roman familial, autobiographique et international – « depuis 1860, tous les événements sur la planète sont connectés » –, Taba-Taba a l’ambition d’une littérature sans limites. Il absorbe le monde en son entier, y compris le monde intérieur de l’auteur, le triturant dans une langue et une architecture romanesque singulières, qui éloignent des conformismes de la « rentrée littéraire » et des petits produits en nombre qu’elle génère. Patrick Deville affirme que « cinquante-cinq ans […] c’est un peu la fin de l’adolescence pour un romancier ». Né en 1957, il a donc l’appétit et la vigueur d’un jeune adulte. Quelle sera la suite !
[1] Les deux au Seuil, respectivement en 2012 et 2014.
Taba-Taba, Patrick Deville, Seuil, 430 p., 20 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
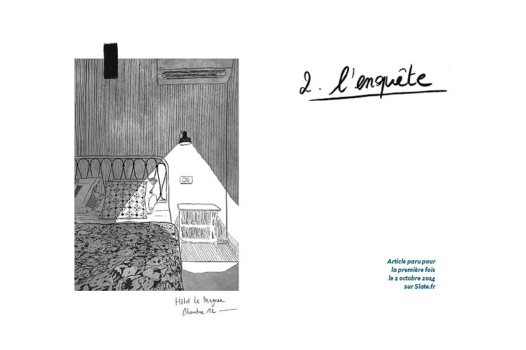
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







