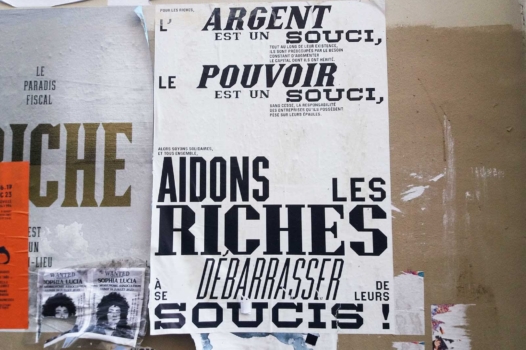Et si on habitait (autrement) ensemble ?
Concevoir et gérer son logement à plusieurs résidents, en fonction de valeurs communes et en dehors de toute spéculation immobilière, tel est le principe de l’habitat participatif.

© AXEL SCHMIDT/AFP
Vivre autrement plutôt que chacun enfermé chez soi » : c’est l’idéal de Loïc Rigaud, membre du Groupe du 4-mars, un projet d’habitat participatif à Lyon. Le jeune homme a rejoint l’aventure en septembre 2016. Fondé sur une logique de partage et de solidarité, ce modèle a émergé en France dans les années 1970 et a pris un nouveau souffle à partir de l’an 2000. Il s’agit d’une forme spécifique d’accès à la propriété : les futurs habitants se rassemblent dans une association sur la base de valeurs communes puis élaborent ensemble la conception, la gestion et les règles de vie de leur logement, en partie collectif. Dans certains projets, cela implique le partage de certains espaces comme des chambres d’amis, un jardin ou des garages ; dans d’autres, c’est avant tout une mutualisation des coûts du logement. Il n’y a pas de règles prédéfinies.
Il est difficile de quantifier ce phénomène, car il existe presque autant de modèles d’habitat participatif que de projets. Dans tous les cas, il met en jeu des acteurs politiques et sociaux souhaitant rester loin de la logique de marché et de la spéculation immobilière. En premier lieu, bien sûr, les citoyens qui s’engagent dans le processus.
« Au début, ce modèle répondait à des idéologies proches de l’autogestion, pour finalement se déplacer vers le partage et la solidarité au quotidien », analyse Camille Devaux [1], maître de conférences en urbanisme et aménagement à l’université de Caen. Les valeurs qui sous-tendent les projets sont multiples et diverses : certains logements se caractérisent par un mode de construction respectueux de l’environnement, d’autres sont élaborés par des seniors comme alternative aux maisons de retraite, tandis que d’autres encore ont un but de mixité sociale, comme le Groupe du 4-mars, qui s’est associé au bailleur social Alliade pour la construction du bâtiment. L’immeuble (dont la livraison est prévue en 2019) sera composé de treize appartements de la coopérative et de onze logements sociaux.
« Si, au démarrage, les personnes investies étaient issues de classes moyennes et supérieures (une nécessité pour l’investissement personnel que demande ce type de projet), on observe une démocratisation au fil du temps, explique Camille Devaux. En effet, dès 2010, les premiers acteurs ont décidé d’ouvrir leur modèle. Grâce à l’implication des organismes HLM et d’autres bailleurs sociaux, le public s’est diversifié. Même si, de manière générale, les participants à de tels projets ont un important capital culturel, si ce n’est financier. »
Qu’est-ce qui pousse ces personnes à investir autant d’efforts et de temps, dans des projets d’habitat coopératif ? Séverine Puel, qui a participé à la création du Groupe du 4-mars, explique que, pour ce projet, c’était avant tout la volonté de continuer d’habiter le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. « En 2009, quand nous avons créé le groupe, les prix de l’immobilier avaient flambé dans le quartier. On aimait cet endroit, et l’habitat participatif nous apparaissait comme un moyen de lutter, à notre échelle, contre la spéculation. »
Ne pas devenir un instrument du marché immobilier : c’est une revendication qui revient souvent dans la bouche des participants à ce type de projets. D’ailleurs, certaines coopératives incluent dans leurs règles une clause de non-spéculation. Lorsque des habitants quittent leur logement, ils récupèrent les parts sociales qu’ils ont achetées lors de leur intégration ; ceux qui emménagent ne payeront pas un centime de plus. Certains projets, bien qu’encore à l’état embryonnaire, vont même plus loin en créant une coopérative de propriétaires dans le parc immobilier privé. Les logements sont ainsi gérés en commun et ne sont pas revendus, le prix des appartements correspondant à celui des parts sociales qui leur sont attachées.
Ce sont les citoyens qui lancent le projet, mais celui-ci devient concret lorsqu’un terrain est trouvé : c’est l’élément foncier qui fait office de déclencheur. « L’accès au foncier est difficile dans les zones denses et sous tension : nous ne pouvons faire le poids face à la concurrence des promoteurs privés, explique Stéphane Singer, directeur de la Scic Hab Fab, qui accompagne des projets de ce genre, et membre du Réseau des acteurs professionnels de l’habitat participatif (RAHP). Les collectivités locales sont un acteur important, puisqu’elles ont en charge la politique urbaine. » Il leur appartient donc de créer les conditions favorables à l’habitat participatif, notamment en favorisant l’accès au foncier.
« Lorsque les participants trouvent un terrain, nous pouvons le leur réserver le temps qu’ils mettent en place leur projet. Mais cela ne veut pas dire que nous le leur donnons, prévient Pierre Zimmermann, coordinateur du Réseau national des collectivités pour l’habitat partagé (RNCHP). Nous pouvons aussi les accompagner financièrement en recrutant des assistants à la maîtrise d’ouvrage (AMO), par exemple. » À l’image de ces AMO, on constate l’émergence d’un secteur professionnel consacré à l’accompagnement des projets d’habitat participatif. Ceux-ci se sont notamment rassemblés dans le RAPH en 2010. Une forme d’encadrement de l’initiative citoyenne : « Pour construire une maison, il y a des compétences spécifiques, rappelle Stéphane Singer. Il faut éviter l’amateurisme. »
Pas d’amateurisme, donc, et, depuis peu, une légitimité législative avec la loi Alur (« pour l’accès au logement et un urbanisme rénové »), adoptée en mars 2014. Son article 47 reconnaît les différents montages possibles en créant deux formes juridiques répondant aux besoins des groupes : la coopérative d’habitants et la société d’attribution et d’autopromotion. Pour Pierre Zimmermann, du RNCHP, cette loi a permis de « fournir un cadre légal permettant le développement des projets. Avant, lorsque les citoyens qui voulaient s’investir se heurtaient à des obstacles administratifs, les banques leur disaient qu’ils n’entraient dans aucune case des formulaires informatiques. » Cette forme de reconnaissance, si symbolique soit-elle, sert surtout aux citoyens à plaider au niveau local. « Il est peut-être trop tôt pour mesurer les impacts concrets de la loi, mais, pour l’instant, nous ne voyons pas beaucoup de bénéfices au niveau opérationnel », nuance toutefois Stéphane Singer.
L’institutionnalisation des projets d’habitat participatif – qui se fait autant via la législation que par la professionnalisation – pose tout de même question. La sociologue Sabrina Bresson voit dans cette entrée en scène d’intermédiaires une manière d’encadrer la participation citoyenne. D’autant que ce « double rôle de “citoyen professionnel”, entre habitants-militants et consultants, est ambigu dans un domaine où la coopération et le partage sont censés restreindre les rapports marchands [2]. » Mettre la logique du marché à la porte implique de veiller à ce qu’elle ne revienne pas par la fenêtre.
Alors que l’habitat participatif s’est particulièrement développé en Suisse (5 % des logements) et en Allemagne (où l’on dénombre deux millions de logements coopératifs), ce modèle reste marginal en France. Camille Devaux estime à 500 le nombre de projets, dont environ 150 ont abouti. « Ce faible chiffre s’explique notamment par l’action de l’État dans le domaine immobilier » : en France, 17 % des ménages bénéficient d’un logement social. Mais le pays connaît actuellement une crise dont témoigne le rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre, qui estime à quatre millions le nombre de personnes mal-logées. L’habitat participatif peut-il contribuer à résorber cette crise ? « Ce n’est pas une solution en tant que telle, mais plutôt un enrichissement des méthodes traditionnelles, estime Pierre Zimmermann. Ce modèle peut constituer une troisième voie pour accéder à un logement. »
Un modèle si minoritaire peut-il se pérenniser ? « Si l’habitat participatif reste en effet marginal, il y a en revanche une diffusion du principe de participation. Des habitants qui décident de construire une terrasse commune dans leur immeuble, c’est déjà une caractéristique de l’habitat participatif, souligne Camille Devaux. C’est peut-être sous cette forme-là que le modèle se diffusera. »
(1) L’Habitat participatif. De l’initiative habitante à l’action publique, Camille Devaux, Presses universitaires de Rennes, 2015.
(2) « L’habitat participatif en France : une alternative sociale à la « crise » ? », Sabrina Bresson, Cahiers de Cost n° 5, 2016.
Pour aller plus loin…

Conclave : comment le Medef a planté les négociations
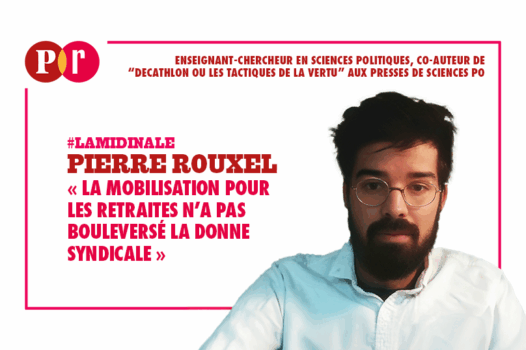
« La mobilisation pour les retraites n’a pas bouleversé la donne syndicale »

Super-Zucman, l’économiste qui veut rétablir la justice fiscale