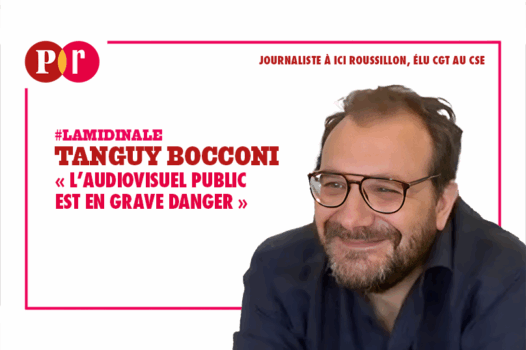Parcoursup, l’école de la concurrence
La psychologue Christine Jarrige craint un renforcement des inégalités dans l’accès aux études supérieures et dénonce le démantèlement des services d’orientation.
dans l’hebdo N° 1519 Acheter ce numéro

© FREDERICK FLORIN/AFP
Psychologue de l’Éducation nationale (PsyEN, ex-conseillère d’orientation-psychologue) en Seine-Saint-Denis depuis près de trente ans et membre du Snes-FSU, Christine Jarrige alerte sur les risques qui pèsent sur l’orientation. Les réformes du bac, du lycée et de l’entrée à l’université modifient le système en profondeur et perturbent les choix des bacheliers et des étudiants. En arrière-plan, la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » va déléguer les missions d’information sur les métiers aux régions, faisant exploser le réseau à visée éducative des Dronisep (1) au profit d’une employabilité rapide et locale. De quoi renforcer l’image de l’élève entrepreneur de lui-même sacrée par Parcoursup.
En faisant disparaître la hiérarchisation des vœux et en multipliant les algorithmes locaux, Parcoursup a-t-il rendu plus aléatoire l’orientation des bacheliers ?
Christine Jarrige : Il faut d’abord bien distinguer orientation, élaboration du projet et affectation. Parcoursup a ajouté à la formulation des vœux des élèves une démarche comprenant une « fiche avenir », un CV et une lettre de motivation. Ces documents pouvaient s’accompagner, comme pour la filière droit, d’un exemplaire d’autoévaluation ou de cours universitaires en ligne. Ce qui a pu en décourager un certain nombre. Plus décourageant encore : le nombre de places et de demandes par formation était affiché. Mais ces chiffres étaient biaisés : ils portaient sur l’année dernière. En outre, en droit en Île-de-France, par exemple, les élèves avaient l’obligation de demander l’ensemble des sites, soit 13 établissements. Ce qui a multiplié d’autant le nombre de vœux, lequel était donc bien supérieur au nombre total d’élèves !
Les élèves ont-ils eu l’impression de participer à une sorte de concours ?
C’est ce qu’a développé la sociologue Annabelle Allouch sous l’appellation _« élève entrepreneur de lui-même ». Chaque jeune doit montrer qui il est et ce qu’il est capable de faire, avec un sentiment de concurrence accentué par le fait de voir son nom grimper ou descendre sur des listes d’attente, quand il n’était pas accepté du premier coup. À 17 ans, c’est difficile. Tous n’en ont pas souffert de la même façon. Mais ce que le ministre a défendu comme un système d’information des élèves s’est révélé très intimidant, voire dissuasif pour beaucoup. Quand on voit qu’il reste des places dans des prépas prestigieuses, en Paces (première année commune aux formations de santé) ou en droit, on se dit que certains élèves n’ont pas osé. Il y a eu un effet d’autocensure évident, a fortiori pour des élèves moyens ou dont les familles ne sont pas très soutenantes, ou qui n’ont pas bénéficié d’un accompagnement.
Est-ce que ce sont effectivement les meilleurs élèves qui ont été pris en priorité ?
Comment le savoir puisque nous n’avons aucun chiffre officiel national ! C’est l’un des éléments qui nous ont le plus manqué. Hormis les données réunies par les responsables de filières ou par certains lycées, nous n’avons disposé d’aucune information fiable pour objectiver le fonctionnement de Parcoursup et comprendre ce qui se passait. Sans compter ce qui a été bricolé à la hâte, parce qu’oublié dans un premier temps, sur le sort des élèves handicapés, ou le dispositif « meilleurs bacheliers », qui a été mis en place en juin, quand beaucoup avaient déjà rempli leurs dossiers.
Si on avait disposé d’indicateurs en temps réel, on aurait pu mieux anticiper certaines étapes de la procédure. Là, personne n’a pu élaborer de stratégie. Reste le problème de fond : le nombre de places dans le supérieur par rapport au nombre d’élèves. Avec des filières qui ne font pas le plein, comme chaque année. Un pourcentage de boursiers a été imposé à chaque département, mais les boursiers ont été classés. Et les taux de boursiers dans les filières parisiennes les plus demandées sont très inférieurs à ceux que l’on trouve en Seine-Saint-Denis.
Avez-vous vu des élèves renoncer à entrer à l’université ?
Impossible, là encore, de l’affirmer sans chiffre officiel. Ce qu’on reçoit comme signaux depuis fin août, ce sont des élèves qui se retrouvent sans rien, en attente d’une place, et les fameux « inactifs », sortis des radars parce qu’ils n’ont pas donné suite quand l’application les a contactés en juillet. Les rectorats ont été attentifs au sort des bacheliers sans affectation. Les grands perdants, ce sont les réorientations : des étudiants qui ont fait une première année dans le supérieur, mais veulent changer de filière. Ils ne sont pas la priorité du gouvernement. On est entré dans la deuxième phase du processus Parcoursup : les élèves ont la liste des places vacantes, mais il n’y a plus de liste d’attente. Les responsables de formation disposent de listes d’attente, mais n’ont pas toujours les coordonnées des élèves qui y figurent…
Sont-ils nombreux à avoir effectué des choix par défaut ?
Une jeune femme en reprise d’études en Seine-Saint-Denis était première sur la liste d’attente d’un DUT à Bobigny et acceptée à l’université de Reims. Elle s’est dit qu’elle allait chercher une chambre à Reims. Mais tous les bacheliers ne sont pas prêts à quitter la maison. Il faut aussi en avoir les moyens. Le défraiement accordé à ceux qui acceptent de partir hors académie va de 200 à 1 000 euros l’année : ça ne paie pas un loyer.
Comme prévu, on a vu le privé exploser. Surtout, on a perdu pas mal d’élèves en route. Ceux qui sont en difficulté scolaire, ceux dont les familles ne sont pas au fait des procédures… Si on les retrouve rapidement, on pourra les prendre en charge. Mais plus ils décrochent, plus ils auront du mal à revenir vers les études. Si c’est pour aller vers une insertion professionnelle, pourquoi pas. Mais c’était quand même des élèves qui avaient fait une demande de poursuite d’études, demande à laquelle la société ne répond pas…
La loi sur l’orientation et la réussite des étudiants (ORE) promettait une révision de l’orientation. Que sont devenus les engagements ?
Lors de la consultation sur Parcoursup organisée en septembre-octobre 2017, j’avais participé à la table ronde sur l’information des élèves. Nous avons connu cinq séances un peu houleuses, et les craintes soulevées alors se confirment aujourd’hui. Si les universités font déjà un gros effort en direction des premières et des terminales avec des journées portes ouvertes, des accueils en cours et des entretiens, la demande d’une bonne partie des syndicats, des organisations lycéennes et des parents d’élèves était de renforcer l’accompagnement. Or, à la dernière séance de cette consultation, les PsyEN avaient été oubliés sur le document préparatoire. On les a fait ajouter, mais, dans le document final – le rapport Filâtre –, ils avaient de nouveau disparu au profit d’une nouvelle mesure : un deuxième professeur principal par classe. Qu’il y ait un renforcement de l’accompagnement par les enseignants, c’est bien, mais cela ne remplace pas des professionnels de l’orientation.
Votre métier est-il menacé ?
Toutes les réformes en cours – lycée, bac, Parcoursup et loi ORE – modifient le système. Et le point central, c’est l’orientation. En outre, le nouveau gouvernement a une conception de l’orientation complètement différente du précédent. En 2017, nous avions enfin obtenu le rassemblement des psychologues scolaires du premier degré et des conseillers d’orientation-psychologues du second degré en un corps unique. Ce qui était une revendication de la FSU depuis trente ans. L’orientation fait le lien avec le développement psychologique, le développement social, le suivi des élèves en situation de handicap, l’investissement scolaire, le rapport aux apprentissages et à l’avenir. Que questionne-t-on quand on interroge un élève sur son projet ? C’est une vision éducative de l’orientation.
Le texte validant ce corps unique comportait des objectifs de lutte contre les inégalités sociales et a été mis en application le 1er septembre 2017. Mais il n’a pas été soutenu par le ministre actuel. Pour Jean-Michel Blanquer, l’orientation, c’est de l’information. Il suffit qu’un élève soit bien informé pour qu’il choisisse bien ce qu’il va faire. Déjà, l’appropriation de l’information n’est pas simple, on peut le vérifier avec Parcoursup. Et, à 15 ans, on ne réfléchit pas à son avenir comme à 18 ans. Cela dépend aussi du milieu dans lequel on vit.
Deuxième coup de massue : la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », promulguée le 6 septembre 2018, transfère aux régions tout ce qui relève de la découverte des métiers. Cela n’entrera en application qu’en janvier 2019, mais on imagine déjà que certaines régions vont favoriser l’insertion locale dans des métiers en tension. Sans compter que, si elles sont parfois en lien avec des partenaires de l’éducation, elles travaillent notamment avec des fondations et des représentants des branches professionnelles. Ce qu’on craint fortement, ce sont des processus d’influence sur les élèves au lieu d’un travail avec eux sur la découverte des métiers. On sort de la perspective de faire des études pour acquérir des connaissances et former des citoyens au profit d’une employabilité rapide sur des métiers en tension. La perspective d’élever le niveau général de qualification n’est plus défendue. Chacun doit rester à sa place. C’est une vision très entrepreneuriale et qui risque de conforter la hiérarchie sociale.
Les centres d’information et d’orientation (CIO) vont-ils disparaître ?
Un bouleversement complet de la carte est prévu avec un rattachement des PsyEN aux établissements et une fermeture des CIO. On n’aurait plus les mêmes missions et, surtout, plus de collectifs de travail. Aujourd’hui, un PsyEN prend en charge en moyenne 1 500 élèves par an, travaille en CIO et dans les établissements, ce qui fait qu’il est à la fois dedans et dehors. Les CIO sont des lieux neutres et plus accessibles aux familles que les lycées. On y organise également des ateliers. On a échoué à faire modifier la loi sur la liberté de choisir son avenir. Tout le réseau s’effondre. C’est d’une violence institutionnelle terrible. D’autant qu’on a appris la nouvelle dans la presse spécialisée.
Comment expliquez-vous que les conseillers d’orientation aient si mauvaise presse ?
Cela vient surtout de la tension autour du passage de la troisième à la seconde. On dit « c’est le conseiller qui m’a orienté », alors que les décisions sont prises par le conseil de classe et le chef d’établissement. Globalement, les PsyEN sont plutôt ouverts et soutenants. On essaie d’être attentifs à ce que l’élève souhaite, mais on travaille aussi à des solutions de repli. Avec un élève en difficulté, on va faire le point sur comment il est dans la classe, sa relation avec les apprentissages, un éventuel problème d’adaptation en arrivant en seconde, une situation familiale difficile… On voit des élèves de tous les milieux. On a la carte des formations, on connaît les conditions d’affectation et on sait que certains circuits sont compliqués. Aujourd’hui plus que jamais.
(1) Délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions.
Pour aller plus loin…

Au Blanc-Mesnil, qui veut déraciner les Tilleuls ?

Cathos intégristes et écoles privées : le véritable « entrisme »

Bétharram : derrière les défaillances de l’État, le silence complice de l’Église