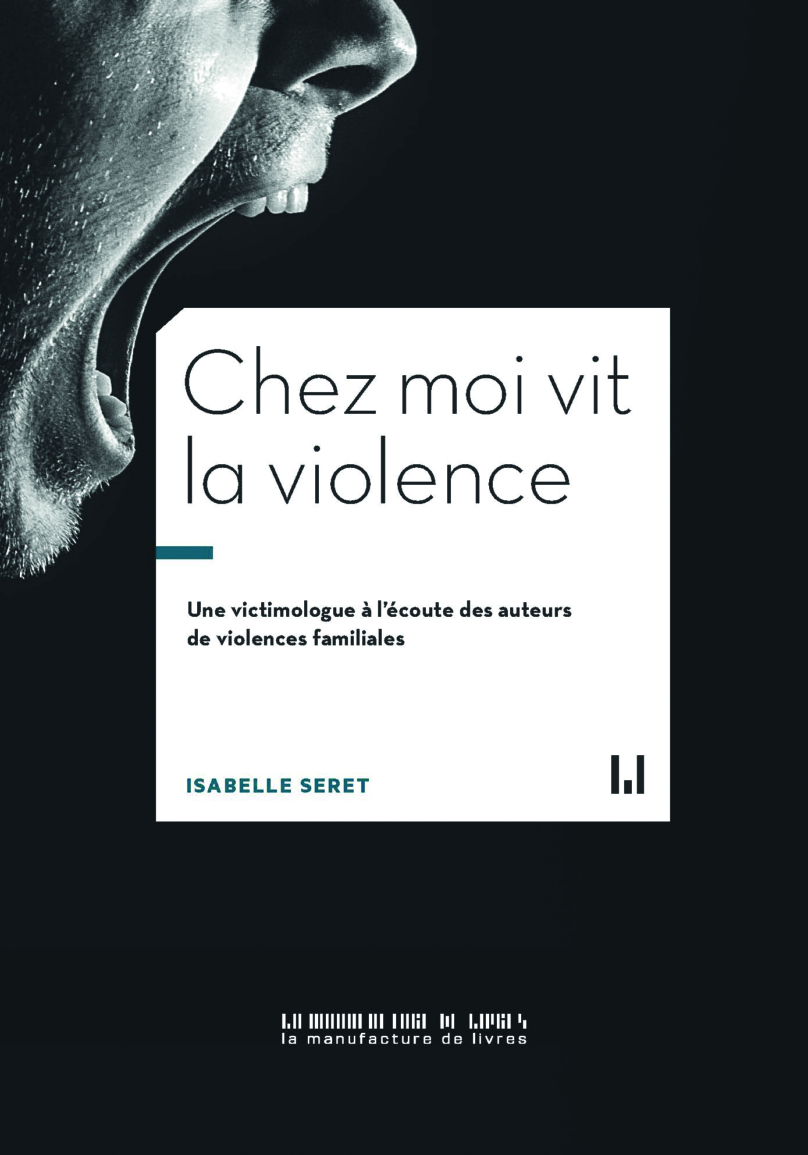« Souvent, les hommes n’ont pas appris à vivre autrement que par la domination »
Intervenante en sociologie clinique, Isabelle Seret analyse la nature des violences commises au sein de la famille et propose des approches pour amener leur auteurs à y renoncer.
dans l’hebdo N° 1725 Acheter ce numéro

La mise en retrait d’Adrien Quatennens du poste de coordinateur de La France insoumise et la démission de Julien Bayou de celui de secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts ont suscité de vifs débats sur ce qu’était un acte violent au sein d’un couple.
Chez moi vit la violence, Éditions La Manufacture de livres, 180 p. 16 euros.
Malgré la connaissance imprécise des faits qui sont reprochés aux deux députés, les commentaires ont fusé sur la nature des gestes décrits par le député du Nord, sur la manière dont ils auraient pu être évités ou sur les différences de comportement entre le compagnon politique et le compagnon de vie. Laissant éclater, une nouvelle fois, les difficultés à traiter cette violence afin qu’elle ne se reproduise plus. C’est l’une des facettes du métier d’Isabelle Seret, victimologue et intervenante en sociologie clinique.
Dans Chez moi vit la violence (éd. La Manufacture de livres, 2022), elle raconte l’accompagnement de ces hommes qui ont harcelé, frappé ou violé leur femme. Elle découvre avec eux leur histoire mais, surtout, leur manière d’en parler. Son but ? Qu’ils prennent conscience de leurs gestes et parviennent à changer d’eux-mêmes.
Pourquoi est-ce si difficile d’admettre que l’on est auteur de violences intrafamiliales ?
Isabelle Seret : J’ai essayé d’aborder cette question dans les ateliers où je suis intervenue. Les hommes que je suivais et qui ont tous été condamnés pour des faits de violence devaient définir ce qu’était un acte violent. Au départ, ils évoquaient des banalités. Puis ils ont parlé des coups, des injures ou des actes sexuels non consentis.
On a replacé ces comportements dans ce qui était interdit ou autorisé, et les niveaux intermédiaires entre ces extrêmes. Je leur ai ensuite demandé ce que signifiait pour eux le fait d’être « auteur ». L’un des hommes présents m’a répondu qu’il préférait être considéré comme « acteur » de violences, parce qu’il n’était pas « que ça ». On me disait : « On n’est pas né “auteur” de violences. Il faut voir les conditions dans lesquelles on est “devenu auteur”. » Derrière cette affirmation, on peut voir des formes de justification.
Il faut que ces hommes prennent conscience des déterminismes dans lesquels ils ont grandi.
Certes, il faut explorer les conditions sociales d’existence, les formes d’isolement que ces personnes ont pu traverser. Mais cela n’excuse pas les actes. Cela signale seulement qu’ils commencent à se plonger dans leur histoire. Ils tentent de donner du sens à ce qu’ils sont aujourd’hui. En sociologie clinique, il y a cette phrase centrale : « L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet. » Il faut que ces hommes prennent conscience des déterminismes dans lesquels ils ont grandi.
Les auteurs de violence naissent dans un contexte global où la domination reste de mise. Et ce qui leur est proposé comme obstacle à leur violence, c’est l’emprisonnement. Or la prison est le lieu de la virilité, où exposer sa masculinité est requis pour pouvoir y résister. Cela pose donc la question des accompagnements qui leur sont disponibles.
Aux modules de « responsabilisation » qui existent en France, vous préférez des groupes de « conscientisation ».
Les programmes mis en place en France reposent parfois sur des modules très verticaux. Le risque est que les hommes qui y participent ne soient pas sujets du dispositif. Dans mes groupes, je voulais accueillir leur subjectivité, sans jugement et avec une écoute bienveillante, pour leur permettre de prendre conscience de qui ils sont.
Un auteur de violences intrafamiliales ne l’est pas à temps plein. C’est quelqu’un qui peut être par moments un bon mari, un bon père.
C’est ainsi que procède la psychologue clinicienne Inès Gauthier. Elle travaille avec des personnes qui ont commis des crimes sexuels, et plus spécifiquement des crimes incestueux. Dans sa pratique, 95 % des personnes qu’elle suit ne récidivent pas. Ça vaut la peine d’essayer. On est dans une société où l’on a tendance à avoir une pensée manichéenne.
Un auteur de violences intrafamiliales ne l’est pas à temps plein. C’est quelqu’un qui peut être par moments un bon mari, un bon père. Il faut donc aller à la rencontre de cette personne-là, sans jugement. C’est cela qui est compliqué.
Et il est tout aussi compliqué d’admettre qu’un bon camarade, un bon ami, un bon mari, un bon père peut, à l’inverse, être aussi un auteur de violences intrafamiliales…
Ou un bon collègue, car les violences sexuelles et sexistes au travail sont aussi un vrai sujet… Reconnaître que son voisin, son père, son frère, son collègue peut commettre des actes de violence vient chambouler toutes les représentations que l’on peut avoir sur ce qu’est un auteur. Il est beaucoup plus simple de le diaboliser.
La gradation des violences est un outil utile pour situer une violence parmi d’autres, sur le plan du droit comme des réactions à avoir par rapport à celle-ci. Pourtant, elle est aussi parfois brandie pour « relativiser » certains gestes. Qu’en pensez-vous ?
La société de la non-violence est nécessaire. Mais il faut reconnaître qu’un coup de poing n’est pas une gifle. La gradation dans la violence existe. Il est toutefois indispensable d’être très clair sur ce point : cette gradation ne doit pas minimiser la première violence, qui peut être une « simple » injure. Les conséquences sur la victime et son entourage sont toujours présentes, quelle que soit la violence.
Il faut éduquer de telle sorte qu’injurier, donner une gifle ou cracher sur quelqu’un soient toujours considérés comme des actes violents.
Il ne faut jamais minimiser l’impact sur les personnes qui la subissent. Au niveau pénal, il est tout à fait compréhensible qu’il y ait une gradation. Mais, dans notre quotidien, cette échelle est-elle pertinente ? Tant qu’on ne reconnaîtra pas l’omniprésence de ces violences et que l’on continuera à comprendre cette problématique comme ne relevant que de l’intime, on refusera d’y faire face. Il faut s’y confronter pleinement, et éduquer de telle sorte qu’injurier, donner une gifle ou cracher sur quelqu’un soient toujours considérés comme des actes violents.
Les révolutions féministes de ces dernières années, et notamment depuis MeToo en octobre 2017, ont permis de rendre visibles ces phénomènes et de solidariser les femmes dans leur combat. Qu’ont-elles provoqué chez les hommes ?
D’abord, à ces femmes, j’ai juste envie de dire bravo. Cette libération de la parole permet de prendre conscience qu’il ne s’agit pas de phénomènes individuels, mais bien d’une problématique systémique. Les critiques que je peux avancer sur ces mouvements de libération de la parole, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’espaces où la parole des hommes peut s’élaborer. Du côté des hommes que j’ai accompagnés, c’est vécu comme de la surpuissance féminine.
Il faut que les mouvements comme MeToo continuent d’exister, tout en essayant d’échapper à cette vision binaire des choses. Les luttes féministes nées dès les années 1970 ont pu extraire du foyer la problématique des violences intrafamiliales pour la déployer comme un fait de société. L’une des conséquences, selon moi, c’est une lecture militante de la situation dans laquelle l’homme est toujours absent. Il est résumé à son statut de fautif.
Il faut que les hommes apprennent à déceler leurs émotions et les signes qui les conduisent à être violents. Il faut qu’ils parviennent à verbaliser.
Or, si on veut vraiment travailler à la prévention, c’est avec les hommes qu’il faut entamer ce travail. Il faut qu’ils prennent conscience que leurs actes sont répréhensibles. Il faut qu’ils apprennent à déceler leurs émotions et les signes qui les conduisent à être violents. Il faut qu’ils parviennent à verbaliser. C’est une démarche qui prend du temps. Et cela requiert une réelle volonté politique pour mettre en place de tels dispositifs.
Justement, les groupes de conscientisation que vous pilotez mettent en avant le rôle de la parole. Certains se livrent, d’autres se taisent ou plaisantent. Pour les hommes, se remettre en question, est-ce déjà une révolution ?
Effectivement, la verbalisation est souvent laborieuse. Parler, cela s’apprend. Parfois, c’est bien plus la violence qui est transmise de génération en génération que la capacité à discerner ses propres actes. Par exemple, lors d’une séance, un des hommes explique qu’il a l’habitude de dormir secrètement dans son garage lorsque sa femme lui demande pourtant de quitter le domicile.
Quand je m’énerve, je me demande si c’est normal ou si c’est parce que j’ai eu un père violent.
Un autre lui conseille alors d’installer une serrure à verrou, qui permet de fermer par un verrou de l’intérieur, mais d’ouvrir avec une clef depuis l’extérieur. « Comme ça, même si ta femme ferme la porte, tu peux rentrer », explique-t-il. Devant tant de machiavélisme, je lui demande comment il a eu cette idée. Il me répond qu’il n’a fait que reproduire ce que son père faisait, et avant lui son grand-père. Souvent, les hommes n’ont pas appris à vivre autrement que par la domination.
La violence s’hérite du côté des femmes victimes – au sein de la famille comme dans l’espace public. Mais cet exemple révèle aussi que des stratégies de domination se transmettent, volontairement ou non, d’homme en homme.
Oui, mais même moi en tant qu’enfant, je peux dire que j’ai hérité d’une part de mon père, qui n’était pas violent tout le temps. Quand le livre est sorti, la première chose qui m’est venue c’était : « Mon pauvre papa ! ».
Il existe toujours des formes de loyauté de l’enfant vis-à-vis de son parent. Dorothée Dussy, qui travaille sur une anthropologie de l’inceste, dit qu’on ne reproduit pas parce qu’on a appris, mais parce qu’on n’a pas eu de limites. Personnellement, je sens ce flou en permanence. Quand je m’énerve, je me demande si c’est normal ou si c’est parce que j’ai eu un père violent. Il faut donner à ces hommes la possibilité d’exprimer d’autres manières d’être.
Pour aller plus loin…

Au Blanc-Mesnil, qui veut déraciner les Tilleuls ?

Cathos intégristes et écoles privées : le véritable « entrisme »

Bétharram : derrière les défaillances de l’État, le silence complice de l’Église