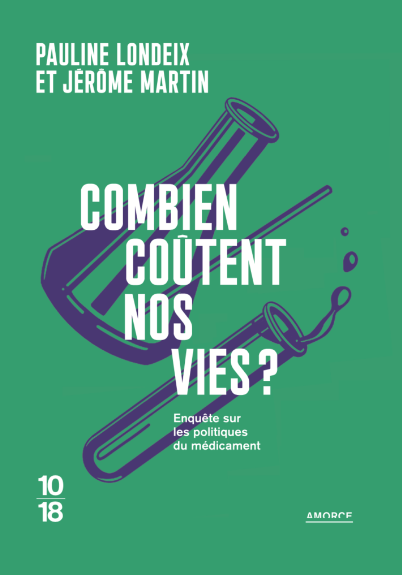« La gauche ne nous semble pas au bon endroit sur les questions de santé »
Anciens militants d’Act Up-Paris, Pauline Londeix et Jérôme Martin ont fondé l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds). Une structure activiste devenue référente sur les questions de santé publique, alors que la pandémie de covid-19 se développait.
dans l’hebdo N° 1748 Acheter ce numéro

© Clémence Demesme – tous droits réservés.
Pauline Londeix est née en 1986, elle a été vice-présidente d’Act Up-Paris en 2008. Elle a ensuite travaillé pour des ONG sur les politiques des médicaments à travers le monde, surtout dans les pays à bas et moyens revenus, mais aussi aux États-Unis ou à Genève, où siège l’Organisation mondiale de la santé. Jérôme Martin, enseignant en banlieue parisienne, né en 1974, a été président d’Act Up-Paris de 2003 à 2005. Il a ensuite milité contre le racisme et pour une laïcité ouverte, opposée à son instrumentalisation par la droite et l’extrême droite. En 2019, ils ont fondé ensemble OTMeds.
Pourquoi avoir créé cet observatoire, OTMeds ?
Pauline Londeix : En 2019, nous avions réussi avec d’autres activistes à obtenir le revirement de la position française à l’Organisation mondiale de la santé [en faveur de l’adoption d’une résolution censée permettre plus de transparence sur les politiques du médicament, la fixation des prix et l’accès des populations aux médicaments génériques, notamment dans les pays du Sud], et in fine emporté le vote du texte [car le revirement français a entraîné un basculement général des autres États, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Allemagne].
Sur le modèle de ce que nous avions appris à Act Up-Paris : en révélant au public et aux médias la position – scandaleuse – du gouvernement français, à la veille des élections européennes. C’est là qu’est née la volonté de créer une structure plus pérenne, qui puisse travailler sur ces questions, mener des enquêtes, produire des données et des textes, intervenir dans le débat public. Nous nous sommes alors retrouvé·es, Jérôme et moi, autour de ce projet.
Jérôme Martin : Après quinze ans à Act Up, je suis passé à autre chose, notamment des activités syndicales dans l’enseignement, antiracistes, sur les questions de laïcité. Mais quand, en 2019, il y a eu cette bataille que vient de décrire Pauline, cela m’a tout de suite rappelé la conférence internationale de Vienne en 2010 sur le sida, où des activistes du Sud étaient venus nous voir en nous disant : c’est très bien de vous battre sur les questions de brevets, de prix et d’accès aux médicaments pour nous, au Sud, mais vous devriez aussi poser la question au Nord.
Nous avons appris des militants du Sud que la question des traitements et du rapport de force avec l’industrie pharmaceutique était systémique.
De fait, cela s’était très peu fait jusqu’alors. Nous avons ainsi appris des militants du Sud que la question des traitements et plus largement du rapport de force avec l’industrie pharmaceutique ne devait pas se limiter à une dimension « humanitaire », mais qu’elle est bien systémique, structurelle.
P. L. : En juin 2019, on a donc créé OTMeds. D’abord pour contraindre la France à appliquer ce texte que nous avions contribué à faire adopter. À peine six mois après, la pandémie de covid a débuté. Une dynamique était déjà enclenchée, avec des rendez-vous obtenus avec le cabinet d’Agnès Buzyn, ministre à l’époque, puis d’autres autorités sanitaires. Et on a bientôt passé beaucoup de temps avec des médias, puisque nous mettions le doigt sur des problématiques centrales de santé publique.
Justement, alors que les questions en matière de santé sont toujours plus vives, notamment avec le contexte géopolitique depuis la guerre en Ukraine, vous avez récemment décidé de suspendre les interviews pour OTMeds. Pourquoi ?
P. L. : Nous sommes ravi·es d’avoir pu contribuer au débat public sur ces questions qui nous semblent fondamentales, vitales. Et nous avons eu de nombreux échanges, riches, avec beaucoup de journalistes, qui ne sont en aucun cas visés par ce communiqué. Mais nous avons eu l’impression, peu à peu, de ne plus être vraiment audibles.
Un exemple : juste après l’invasion russe en Ukraine, nous avons publié une tribune dans Le Monde où nous alertions sur le fait que cette guerre risquait d’avoir des répercussions géopolitiques sur la production de médicaments, puisqu’une grande partie des matières premières pharmaceutiques est produite en Chine, dont nous sommes donc largement dépendants. Or cette inquiétude, que nous portions depuis des années, n’a pas été ou trop peu relevée.
Je me rappelle aussi un échange aux débuts du covid avec Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine [pour la découverte du VIH, NDLR] : je lui disais qu’on avait besoin d’entendre sa parole de grande scientifique dans les médias – alors qu’elle dirigeait le comité en charge d’évaluer les vaccins potentiels –, face à toutes les rumeurs qui circulaient. Elle m’avait répondu : « Pauline, soit je travaille, soit je réponds aux médias… » Je repense souvent à cette phrase.
J. M. : Il faut aussi rappeler que l’on a déjà produit, outre de nombreux entretiens, beaucoup de textes, de tribunes, de recherches, d’enquêtes, qui sont disponibles. Les journalistes ne sont pas sans ressources sur tous ces sujets : on a réalisé un rapport pour le Parlement européen sur la relocalisation de la production ; il y a notre livre (1). Tout cela est disponible et, au lieu de nous répéter, nous préférons produire de nouvelles recherches, enquêtes et données.
Combien coûtent nos vies ? Enquête sur les politiques du médicament, Pauline Londeix, Jérôme Martin, 10/18, coll. « Amorce », 2022.
En outre, nous avons remarqué que bon nombre des médias qui ont été réactifs aux questions de santé publique, récemment, sont situés à droite. Le Figaro a souvent fait de bons articles et on a été très sollicités, ces derniers temps, par des médias comme BFMTV, RMC, L’Express, Le Point. Ce n’est pas négligeable, mais cela dit aussi quelque chose de la gauche sur ces sujets.
Vous venez de cosigner une tribune sur la gauche et la santé publique, vous en aviez publié une autre en novembre, où vous vous adressiez déjà à la gauche avec une certaine véhémence. Que dénoncez-vous ?
J. M. : Cela fait malheureusement un bon moment que la gauche ne nous semble pas au bon endroit sur les questions de santé, notamment depuis les campagnes électorales du printemps 2022. Je reprendrai ici juste quelques anecdotes. Le dernier moment de grâce a été lorsque des candidats de gauche ont signé avec nous une demande à Emmanuel Macron de levée des brevets.
Mais, depuis les élections, même si on n’oublie évidemment pas les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir, on a vu un certain nombre de signes assez douloureux sur ces sujets : la reprise par Fabien Roussel, pour le PCF, du discours des patrons de l’industrie viticole ou de la viande pour contrer les messages de santé publique ou écologistes ; la maladresse, certes, de Sandrine Rousseau pour EELV, qui a parlé de « fin du covid » ; l’abandon des masques dans les réunions de tous les partis…
L’enjeu du covid n’est pas seulement la létalité ou les hospitalisations, il s’inscrit aussi sur le long terme.
Or il y a eu au début de l’été dernier une étude sur une cohorte très importante de personnes qui montrait que les réinfections successives au covid entraînent des problèmes graves pour le cerveau, les poumons, le système immunitaire. L’enjeu du covid n’est donc pas seulement la létalité ou les hospitalisations, il s’inscrit aussi sur le long terme. Quant à La France insoumise, je ne vais pas revenir sur sa position à propos des soignants non vaccinés… Enfin, après une de nos interpellations sur le covid, le PS nous a répondu qu’il était « désormais favorable à la production publique de médicaments ». Pauline leur a demandé : « Mais depuis quand ? » Ils nous ont répondu : « Depuis une semaine » !
Comment travaillez-vous au quotidien ? Avec quelles ressources ?
P. L. : Nous animons surtout un réseau de compétences, de points de vue, en santé publique, pharmacologie, épidémiologie, propriété intellectuelle, avec des chercheurs, des activistes. Je ne citerai que quelques noms de personnes qui nous ont fait bénéficier de leurs connaissances. Je pense à Stéphane Besançon, qui est directeur de l’ONG Santé Diabète. Ou à Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), qui fait le lien entre la situation de l’hôpital public et les politiques pharmaceutiques : d’un côté, on demande aux hôpitaux de faire des économies partout ; de l’autre, les prix des médicaments sont toujours plus élevés.
Je dois encore citer Charlotte Brives, anthropologue des sciences et autrice de Face à l’antibiorésistance. Une écologie politique des microbes (2), qui souligne l’importance d’une production publique pharmaceutique et questionne le rapport entre environnement et santé. Ce sont quelques-unes des personnes qui nous permettent de développer justement le type de regard que nous voulons avoir : en multipliant les angles. Ce qui nous semble être la fonction d’un observatoire.
Amsterdam, 2022. Préface de Bruno Latour.
Vous jouez donc souvent un rôle qui pourrait s’apparenter à celui de lanceur d’alerte. Qu’en est-il notamment des pénuries de médicaments aujourd’hui ?
P. L. : Il faut dire d’abord que les pénuries de médicaments sont structurelles, et en constante augmentation depuis plus de dix ans. Tout le monde le sait, personne ne le conteste dans le milieu du médicament, même si le grand public n’est pas forcément au courant. C’est bel et bien structurel puisque, avant le covid, il y avait déjà plusieurs milliers de pénuries par an.
Avec le covid, il y en a eu davantage, conjoncturelles, mais cette fois plus visibles. D’abord parce que l’Inde a fermé ses frontières aux exportations. Mais aussi parce que la Chine a dû fermer bon nombre de ses usines, leurs travailleurs étant malades. En avril 2020, il y a eu des ruptures de stock de médicaments de réanimation dans les hôpitaux parisiens. On a alors alerté. Avec la guerre en Ukraine, on a redit qu’il allait y avoir des répercussions encore pires.
En septembre dernier, aux États-Unis, il y a eu un début de pénurie très importante d’amoxicilline, antibiotique phare. Et à partir d’octobre, des praticiens hospitaliers nous ont contactés pour nous faire part de leur inquiétude sur des stocks en forte diminution. On n’a pas voulu créer de panique en relayant ainsi l’information. Sans donner les noms des produits, on a contacté des élus, des politiques, pour les prévenir de ce risque de rupture de médicaments essentiels, et espérer qu’ils se mobilisent sur ce sujet, en interrogeant l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le gouvernement, les partis politiques, notamment de gauche. En vain.
Or certains médias ont déjà donné des informations sur les pénuries de médicaments, ce qui a pu entraîner le fait que des personnes se mettent à constituer des stocks. En tout cas, la Direction générale de la santé n’avait pas, elle, encore alerté les professionnels de santé. Et un jeudi, à la mi-novembre 2022, on a une réunion avec l’ANSM et des associations de patients.
J. M. : Lors de cette réunion, nos interlocuteurs ont commencé à nous dire que, pour faire face, il y aurait « l’importation de ces médicaments depuis l’hémisphère Sud ». Après une brève recherche, on a vu que la pénurie touchait aussi les trois pays en capacité de le faire (Brésil, Australie et Afrique du Sud). Ensuite, un de nos interlocuteurs nous a expliqué qu’il faudrait, à un certain moment, « travailler sur les prix des médicaments », car les pénuries sont causées par « des prix pas assez élevés », notamment pour les génériques ! Ce qui est exactement le discours de l’industrie pharmaceutique…
Presque trois semaines plus tard, on a une nouvelle réunion sur les nouvelles mesures face à la pénurie d’amoxicilline pédiatrique. On nous explique comment y faire face : les parents devront prendre un comprimé pour adulte, l’écraser, ajouter de l’eau, prendre une seringue (qui doit donc être prescrite, pour être remboursée) et prélever la quantité nécessaire de produit selon le poids de l’enfant, puis l’administrer par voie orale.
Les pénuries parasitent complètement le travail des soignants, en plus des pertes de chances pour les malades.
Et cerise sur le gâteau, en pleine pénurie, jeter le reste de la préparation, car il serait dangereux de l’utiliser quelques heures plus tard ! Ainsi, dans un contexte de pénurie, on incite les parents à réaliser une préparation pharmaceutique, ce à quoi ils ne sont pas formés, et à jeter un antibiotique dans l’environnement, ce qui signifie pollution et, à terme, résistance à la molécule…
Telle a été la recommandation d’un directeur adjoint de l’ANSM, qui nous a expliqué que ses équipes ont produit un dessin, « encore perfectible », qui n’était « pas destiné » à être diffusé sur papier dans les pharmacies ou chez les praticiens, mais serait disponible sur son site… On voit là le niveau du travail qui est réalisé dans une agence de santé publique.
P. L. : Enfin, on a été alertés sur le fait que d’autres classes thérapeutiques sont concernées. La neurologue Sophie Crozier, que j’ai citée tout à l’heure, nous a expliqué récemment que des alertes existaient sur des médicaments essentiels. Comme ceux que l’on prend juste après les AVC pour éviter des séquelles, ce qui oblige les personnels soignants à jouer sur différents dosages, avec évidemment des risques d’erreurs importants. Ou bien des médicaments contre des cancers qui ne sont plus disponibles, avec des barèmes établis, ce qui fait que l’on choisit entre les personnes les plus malades qui y auront accès. Ou encore des traitements antirejet pour des greffes qui ne sont plus disponibles. De même, pour certains antirétroviraux pour le sida ou certaines classes d’insuline, avec des patients qui ont dû en changer et se rééquilibrer, ce qui est très compliqué…
J. M. : Enfin, le discours du ministre de la Santé, François Braun, est absolument intolérable, puisqu’une étude toute récente d’un syndicat de pharmaciens hospitaliers révèle que 55 % d’entre eux « estiment passer au moins quatre heures par semaine à gérer les pénuries de médicaments et [que] 35 % l’évaluent à plus de six heures par semaine ».
Enfin, 46,3 % des professionnels interrogés estiment que leur métier est « dénaturé par ces pénuries ». Cela signifie que cette situation parasite complètement le travail de ces soignants, en plus des pertes de chances pour les malades. La situation est donc très grave. Et le ministre de la Santé s’est contenté d’expliquer qu’un plan pour pallier cette situation serait présenté… dans six mois.
Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

« Les députés qui voteront pour la loi Duplomb voteront pour le cancer »

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »