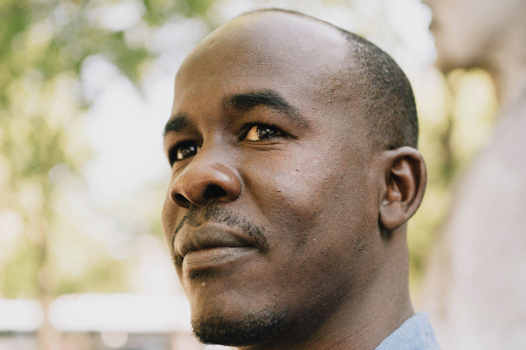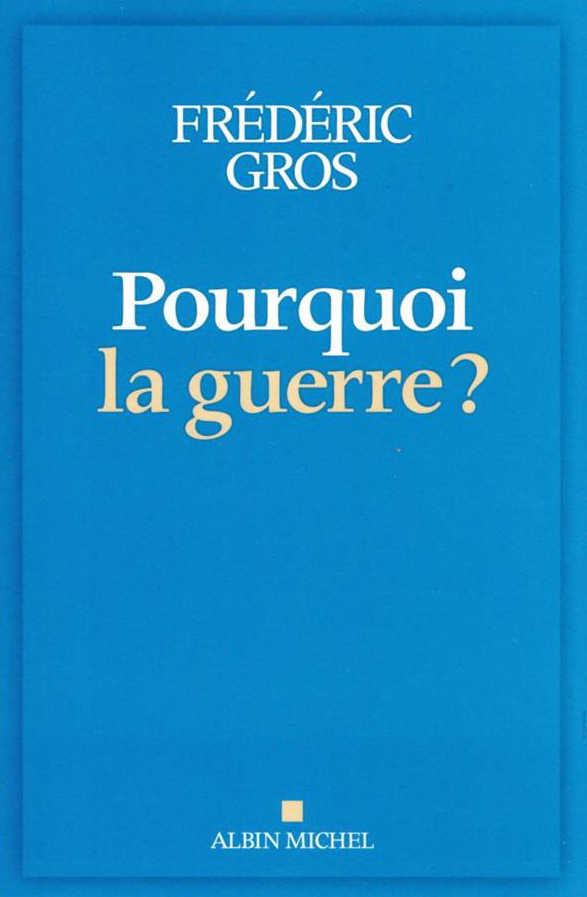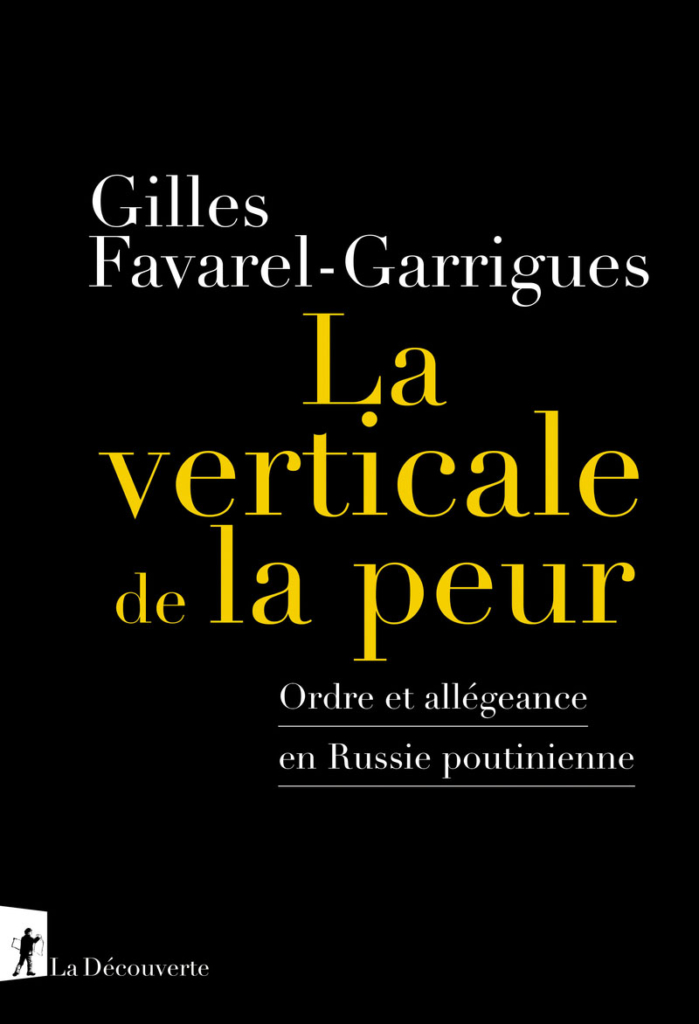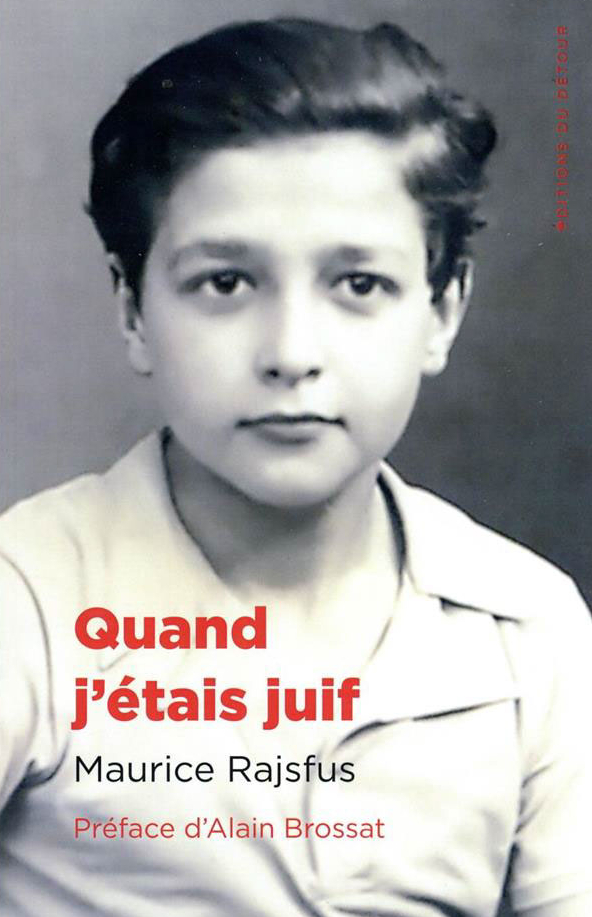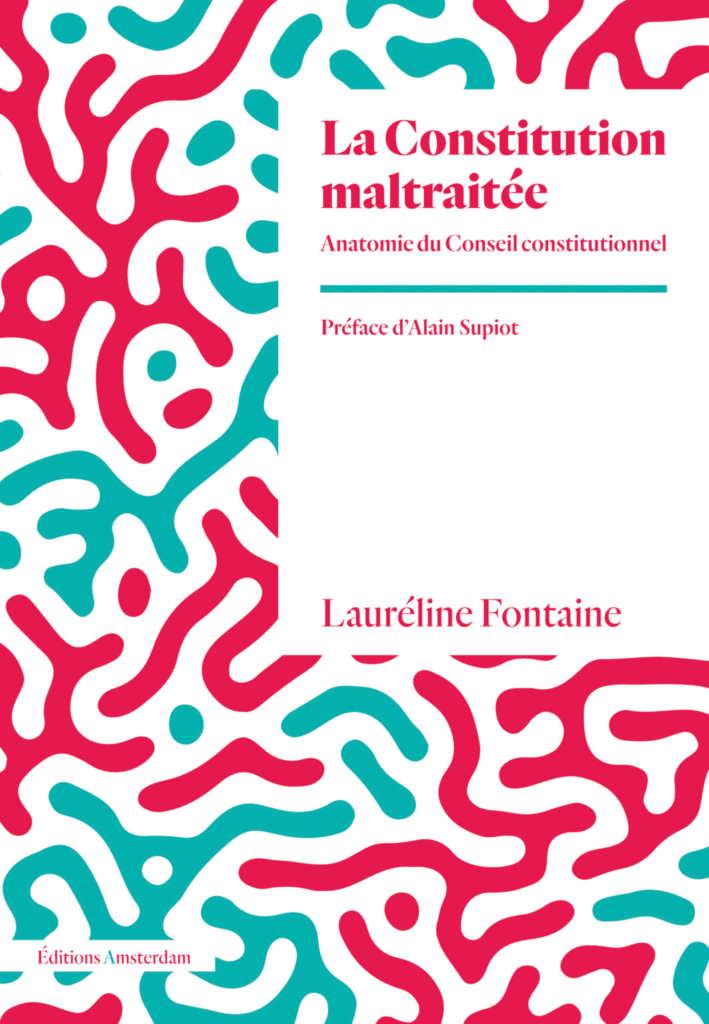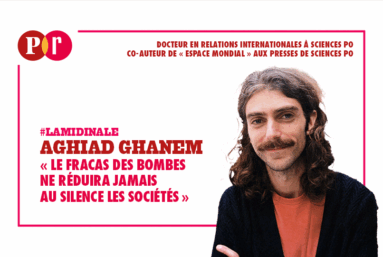La guerre, encore et toujours ?
Le philosophe Frédéric Gros analyse le retour d’un conflit armé « classique » en Europe. En interrogeant un concept qui n’a cessé de se renouveler, de Platon à Machiavel et à Clausewitz, jusqu’aux attentats du 11 septembre 2001.
dans l’hebdo N° 1751 Acheter ce numéro

© Sergey SHESTAK / AFP.
Pourquoi la guerre ? Frédéric Gros, Albin Michel, 162 pages, 18 euros.
La guerre, dans son acception ancienne ou classique, c’est-à-dire l’affrontement de deux nations et leurs armées respectives, était devenue un objet presque marginal en sciences sociales. Ou du moins, depuis 1945, daté. Avec la guerre froide et l’« équilibre de la terreur » (nucléaire), certains chercheurs ont néanmoins continué à en discuter les principes, les mécanismes, mais surtout à commenter l’évolution des différents styles de confrontations violentes.
On devrait relire évidemment Raymond Aron et son essai sur le penseur classique de la guerre : Clausewitz. Mais, depuis Hiroshima et Nuremberg, beaucoup avaient cru pouvoir affirmer la « fin de la guerre » – du moins en Occident –, sinon sa disparition. Un publiciste conservateur (tendance Reagan), Francis Fukuyama, s’est même plu à évoquer la « fin de l’histoire » au lendemain de la chute du mur de Berlin, pour mieux célébrer la « victoire » du capitalisme néolibéral sur le bloc soviétique.
Pourtant, si les guerres classiques entre États ont bien été éclipsées (ou presque) durant plus d’un demi-siècle en Occident, les formes de violences armées n’ont jamais vraiment disparu de la surface du globe.
Mais, pour le riche Nord, il s’agissait ou bien de différends supposés lointains – ethniques, religieux, infra-étatiques – ou bien, avec le développement de certains actes terroristes – notamment à partir du 11 septembre 2001 outre-Atlantique –, de guerres « diffuses ». Celles-ci ont alors fait « s’effondrer les repères stratégiques des décennies précédentes ». Tandis que se développait une « guerre globale contre le terrorisme ».
C’est ce qu’analyse ici le philosophe Frédéric Gros, éminent spécialiste (et éditeur, dans la prestigieuse collection de la Pléiade chez Gallimard) de Michel Foucault, dans une courte mais dense réflexion, qui retrace l’évolution des conflits armés, face à un « ennemi global », « sans identité nationale fixe, sans ancrage territorial ».
Mais, le 24 février 2022, le mot « guerre » s’est soudain rappelé à lui : un État, la Russie, lançait ce jour-là ses troupes, blindés et avions, contre l’un de ses voisins, l’Ukraine, bombardant ses villes, ses infrastructures énergétiques, nucléaires même, et surtout des quartiers entiers peuplés de populations civiles. Les récits des exactions des armées russes d’occupation s’étalent depuis dans les journaux.
L’Europe a donc dû changer, soudain plongée dans un cauchemar qui lui semblait n’appartenir qu’à son passé.
Frédéric Gros rappelle le véritable état de « sidération » qui fut alors le nôtre : « Cette fois, c’est vraiment la guerre ! » Quelque chose de « sérieux » venait de débuter, pour nous aussi, riches Européens ; quelque chose longtemps tenu à distance, du moins de nos imaginaires immédiats, sinon aux portes de nos maisons, à l’orée de notre voisinage.
Désormais, « on n’était plus dans la métaphore, l’analogie, l’image. » Désormais, on parlerait « de ruines et de cadavres », de bombardements, d’obus transperçant des immeubles d’habitations. Et des exécutions de civils les mains liées dans le dos, une balle dans la tête ; des geôles et des chambres de torture, des déportations en bloc, jusqu’aux enfants ukrainiens. La guerre était là. De retour.
Qu’est-ce qu’une guerre juste ?
L’Europe a donc dû changer, soudain plongée dans un cauchemar qui lui semblait n’appartenir qu’à son passé. Les pays neutres, depuis des siècles, aujourd’hui trop proches de l’envahisseur russe, fébriles, se sont empressés de solliciter leur adhésion à l’Otan.
Et les gauches européennes, proclamant depuis longtemps un ardent pacifisme, allemande et italienne en tête, se sont mises à débattre sur l’attitude à adopter face à une invasion armée caractérisée et à son lot de crimes. Des débats qui n’avaient pas été si poussés lors de la précédente guerre sur le continent européen, dans l’ex-Yougoslavie à partir de 1992, de Sarajevo au Kosovo.
En réinvestissant la philosophie afférente à la guerre et en convoquant pour ce faire les plus grands penseurs, de Platon à Marx, de Machiavel à Hobbes ou à Kant, et de Clausewitz à Raymond Aron, Frédéric Gros s’interroge d’abord sur la question qui ne nous quitte pas depuis le début des hostilités dans l’est de l’Europe : qu’est-ce qu’une guerre « juste » ?
À l’heure où la Chine avance ses pions avec un « plan de paix » (non dénué d’arrière-pensées) et quand l’Ukraine pourrait s’essouffler sur le champ de bataille, faisant peut-être douter l’Occident dans son choix de l’armer toujours plus, comment, après le terrible XXe siècle, un conflit armé « classique » en Europe est-il redevenu possible ?
Les livres de la semaine
La Verticale de la peur. Ordre et allégeance en Russie poutinienne, Gilles Favarel-Garrigues, La Découverte, 240 pages, 19,50 euros.
Comment le pouvoir de Poutine tient-il ? Se maintient-il ? Ce sont les questions auxquelles le sociologue Gilles Favarel-Garrigues, éminent spécialiste de la Russie, répond avec brio dans cette enquête menée depuis deux décennies, nourrie de portraits et d’anecdotes saisissantes. Dans cet immense pays, pourtant toujours plus replié sur soi, il montre comment le pouvoir poutinien, dans une « spirale d’autoritarisme », se maintient « à tous les niveaux de la structure sociale » par la menace, dans une « verticale de la peur » et une « surenchère punitive », cimentant l’ordre politique jusqu’aux plus hautes élites par une « insécurité permanente ». Une plongée au plus profond de la société russe, qui éclaire aussi la genèse de la guerre contre l’Ukraine.
Quand j’étais juif, Maurice Rajsfus, préface d’Alain Brossat, éditions du Détour, 224 pages, 20,90 euros
Les Éditions du Détour poursuivent leur salutaire réédition des œuvres complètes du grand historien Maurice Rajsfus, inlassable pourfendeur des violences d’une police française qui obéit toujours « à ses maîtres du moment ». En 1940, à 12 ans, Maurice « découvre » qu’il est juif, ce qui n’était pour lui qu’une lointaine origine familiale, « restée en Pologne ». Dans ce livre bouleversant, il part à la recherche de cette « identité », imposée par Vichy et d’abord par sa police, tatillonne sur le port de l’étoile jaune. Jusqu’à la rafle du Vel’ d’hiv’, à laquelle il échappe par miracle – mais non ses parents. L’introspection d’un « déserteur du judaïsme » qui le mène jusqu’au shtetl de sa mère en Pologne. Sans jamais oublier le « zèle » des flics français.
La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel, Lauréline Fontaine, éditions Amsterdam, 280 pages, 20 euros.
À l’heure où le président Macron dit « attendre » la décision du Conseil constitutionnel sur sa contre-réforme inique du système des retraites, voici un ouvrage qui relativise franchement la supposée indépendance de cette juridiction. La juriste Lauréline Fontaine, dans cet essai très argumenté, braque en effet une « lumière crue » sur la justice constitutionnelle française, montrant que ledit Conseil, dès la nomination de ses « sages », est une « instance essentiellement politique » et ne constitue en rien un réel contre-pouvoir. Et que cette « anomalie démocratique » bien française s’avère « incompatible avec les principes élémentaires de la démocratie et de l’État de droit ». Magistral.
Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine