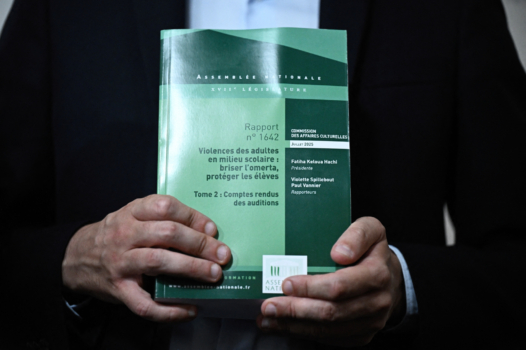Droit d’accueil : quarante ans de reculs
Le projet de loi Darmanin arrive après quatre décennies au cours desquelles la gauche comme la droite ont fait de l’immigration un enjeu sécuritaire, au détriment de l’accueil des migrants.
dans l’hebdo N° 1753 Acheter ce numéro

© Emmanuel DUNAND / AFP.
Dans le même dossier…
Accueil des exilés : riposter face à l’extrême droite « Nous sommes voués à élargir notre vision de l’identité française » À Bélâbre, la haine anti-migrantsQu’avons-nous fait de l’asile ? Que reste-t-il de la France comme terre d’accueil ? Les gouvernements se suivent et se ressemblent, et les ministres de l’Intérieur entendent, tous, marquer leur passage de leur loi « asile et immigration ». Gérald Darmanin n’y échappe pas. Et si sa loi, prévue fin mars, a été reportée, elle promet de durcir plus encore les droits des étrangers.
Comment en est-on arrivé là ? Obligation de quitter le territoire (OQTF) ; possibilité d’expulsion express de ressortissants qui séjournent en France depuis plus de dix ans ; généralisation du juge unique à la Cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA)… Sous le jargon administratif alambiqué du droit des étrangers, réside un « un vaste plan de restrictions des droits au séjour et d’expulsions massives sous fond d’amalgame généralisé entre l’immigration et la délinquance » résume Anna Sibley, juriste au Gisti (Groupe d’information et de soutien aux immigré·es).
Le texte est présenté à l’automne dernier dans un contexte émotionnel particulier. Le meurtre de Lola, 12 ans, par une femme algérienne sous le coup d’une OQTF est exploité dans toute sa moelle par l’extrême droite, mais aussi par la majorité présidentielle.
Avec la mesure qui caractérise habituellement ses prises de parole publiques, Gérald Darmanin explique vouloir rendre « impossible la vie des OQTF en France ». Vantée comme « équilibrée » entre « humanisme et fermeté », sa loi présente un caractère éminemment dangereux et répressif qui n’a jamais fait l’ombre d’un doute pour les associations de solidarité.
« À chaque fois, on a l’impression qu’on a atteint un seuil. Mais il faut reconnaître leur formidable inventivité dans le répressif, dont les trouvailles parviennent même à nous étonner », ironise Jean-François Martini, juriste et également membre du Gisti. Le projet de loi apparaît comme la couche supplémentaire d’un mille-feuille législatif déjà bien fourni.
Si quelques rares avancées ont été rendues possibles au cours des dernières années par des décisions de justice, à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel qui a consacré la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle dans l’affaire Cédric Herrou, on retient surtout les inquiétants reculs contre les droits.
Depuis 1980, sans compter les circulaires, décrets et autres mesures plus discrètement glissées dans des textes portant sur la sécurité ou le travail, ce ne sont pas moins de dix-sept lois majeures qui ont réformé le droit des étrangers et l’asile en France. Dit autrement, l’arsenal législatif s’est doté d’une nouvelle loi en moyenne tous les deux ans. Pourquoi ?
Des mesures toujours plus répressives
« Régulation des flux », « contrôles à la frontière » ou encore « intégration républicaine » sont des éléments de langage récents. Ce n’est qu’à la Libération, avec l’ordonnance du 2 novembre 1945, qu’est octroyée à l’État la responsabilité de cadrer l’immigration, notamment via le travail. Durant les trente années qui suivront, la France se montrera plus accueillante, en raison d’un besoin massif de main-d’œuvre.
Les circulaires Marcellin-Fontanet de 1972 annoncent un tournant en conditionnant le titre de séjour à l’obtention d’un travail et d’un logement. La même année, le Gisti est créé. À la suite d’une mobilisation massive des sans-papiers, les mesures sont annulées trois ans plus tard par le Conseil d’État.
À partir du moment où l’État providence a été vidé de sa substance, on a accusé l’immigration de tous les maux.
Mais le ton est donné : « À partir du moment où l’État providence a été vidé de sa substance, on a accusé l’immigration de tous les maux, explique Marius Roux, juriste en droit des étrangers et membre du collectif Fontenay Diversité. Après, ça a été la course à l’échalote pour savoir qui serait capable de faire une loi pire que la précédente. »
La loi Bonnet de 1980 « relative à la prévention de l’immigration clandestine » est la première à porter atteinte à l’ordonnance de 1945. Le séjour irrégulier devient un motif d’expulsion. « On fait définitivement de l’ensemble des étrangers en France une population asservie et traquée, dont on réduit le nombre à volonté », écrit alors dans une tribune publiée par Le Monde le père André Legouy, militant des droits des étrangers et cofondateur du Gisti, après l’expulsion du journaliste Simon Malley, d’origine égyptienne.
- Loi Bonnet de 1980 : réforme pour la première fois l’ordonnance de 1945 et fait du séjour irrégulier un motif d’expulsion.
- Loi Questiaux de 1981 : pose le principe de rétention dans la perspective d’expulsion.
- Loi du 17 juillet 1984: crée une carte de résident universelle de 10 ans permettant un droit au séjour dissocié de l’occupation d’un emploi.
- Première loi Pasqua de 1986 : durcit l’accès au titre de séjour et rend possible l’expulsion par décision préfectorale sans contrôle judiciaire.
- Loi Joxe de 1989 : abroge partiellement la loi Pasqua. Assure la protection contre l’expulsion des personnes ayant des attaches personnelles et familiales en France. Instaure un recours juridictionnel contre les mesures de reconduite à la frontière.
- Circulaires « Cresson » en 1991 : retire l’accès au travail pour les demandeurs d’asile. durcit les conditions d’obtentions des visas. Sanctionne le travail au noir et clandestin. Place les réfugiés statuaires en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada).
- Loi Quilès de 1992 : donne un statut légal aux zones d’attentes dans les ports et aéroports.
- Loi Pasqua de 1993 : renforce les contrôles aux frontières. Crée les procédures prioritaires pour les demandes infondées. Pénalise le refus d’embarquement. Instaure des mesures de lutte contre les mariages dits « blancs ».
- Loi du 27 décembre 1994 : pour mettre en conformité le droit français avec la convention de Schengen. Création d’un délit pour l’aide aux personnes en situation irrégulière à pénétrer ou séjourner sur le territoire – le « délit de solidarité ».
- Loi Debré de 1997 : permet la confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière et la mémorisation des empreintes digitale des demandeurs de titre de séjour.
- Loi Chevènement, « loi RESEDA » de 1998 : crée de nouvelles voies d’obtention de titres de séjour. Élargit le droit d’asile. Renforce les prestations sociales pour les étrangers.
- Loi Sarkozy de 2003 : veut résoudre la question des « dérives » qui feraient du droit d’asile un vecteur d’immigration irrégulière. Introduit la notion de « pays d’origine sûr ». Crée un fichier d’empreintes digitales et de photos. Instaure le délit de « mariage de complaisance ».
- Loi Sarkozy de 2006 : crée les « obligations de quitter le territoire français » (OQTF). Conditionne l’obtention de la carte de résident au respect du « contrat d’accueil et d’intégration ». Durcissement du regroupement familial.
- Loi Hortefeux de 2007 : place l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Autorise le recours aux tests ADN pour prouver la filiation en cas de regroupement familial. Oblige les parents à faire respecter le « contrat d’accueil et d’intégration » à leurs enfants.
- Loi Besson 2011 : limite l’accès à l’aide juridictionnelle à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les mesures d’éloignement peuvent être placées sous le contrôle d’un juge administratif et plus forcément d’un juge judiciaire.
- Circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 : redéfinit les critères de régularisation des sans-papiers. Les demandeurs doivent attester d’une ancienneté de présence sur le territoire (trois à sept ans en fonction des situations), d’une scolarisation des enfants de trois ans minimum, de deux ans pour les + de 18 ans en étude, et d’une ancienneté dans le travail (huit à trente mois).
- Loi « Valls » du 31 décembre 2012 : crée une mesure privation de liberté remplaçant la garde à vue pour vérification du droit au séjour. Modifie le délit d’aide au séjour irrégulier (« délit de solidarité ») pour exclure les actions « humanitaires et désintéressées ». Cette dénomination reste très floue et permettra les condamnations de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni.
- Circulaires « Valls » du 11 février 2013 et 11 mars 2013 : différentes mesures de « lutte contre le travail illégal » et « contre l’immigration irrégulière ».
- Loi du 29 juillet 2015 : transpose les directives européennes de refonte du droit européen de l’asile publiées de 2011 à 2013 et réforme un dispositif français « à bout de souffle ». Réduit les délais de traitement des demandes d’asile.
- Loi Cazeneuve de 2016 : le contrat « d’accueil et d’intégration » devient « le contrat d’intégration républicaine ». Crée un « passeport talent » pour favoriser l’accueil des exilés diplômés et qualifiés.
- Loi Collomb de 2018 : réduit les délais d’instruction de la demande d’asile de 120 à 90 jours. Simplifie les reconduites à la frontière. Double la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours en Centre de rétention administratif (CRA).
« Avec les alternances politiques, dans les années 1980, on observe un va-et-vient sur les questions migratoires », constate Jean-François Martini. En 1984 est créée la carte de résident universelle, demandée par les militants depuis dix ans. Mais la loi Pasqua de 1986 impose un ensemble de mesures très répressives, sur lesquelles celle de Joxe en 1989 revient partiellement. « Droite ou gauche, les objectifs sont les mêmes : c’est juste une question d’intensité », conclut le juriste.
L’extrême-droitisation de la question migratoire
Ces sauts de puce législatifs se produisent dans un contexte où la voix du FN s’élève de plus en plus dans l’espace public. Aux élections législatives de 1986, Jean-Marie Le Pen est élu député aux côtés de 34 autres cadres du parti. Du jamais vu. « La question de l’immigration a été politisée par Jean-Marie Le Pen à cette époque, explique Anna Sibley. On se disait qu’il valait mieux exposer les idées du FN que les cacher. Aujourd’hui, on peut sérieusement se questionner sur les conséquences de cette stratégie. »
Un questionnement qui traverse également Marius Roux : « À chaque fois, on est allé crescendo dans le mauvais sens. On s’est inquiété de la montée de l’extrême droite dans le débat public, et cela a eu l’effet exactement inverse. » Au fil des réformes, les personnes exilées apparaissent de plus en plus comme des dangers potentiels à contenir hors de nos frontières.
À chaque fois, on est allé crescendo dans le mauvais sens.
À titre d’exemple, la durée d’enfermement en centre de rétention administrative (CRA) n’a fait que s’allonger via les lois Bonnet en 1980, Pasqua en 1993, Debré en 1997, Sarkozy en 2003, Besson en 2011 et Collomb en 2018. On retire une à une leurs libertés aux réfugiés « en les mettant littéralement en quarantaine sociale », expose Gérard Sadik, responsable de la thématique asile à la Cimade. Depuis 1991, les demandeurs d’asile n’ont plus le droit de travailler.
Des expressions naguère prisées de l’extrême droite sont recyclées par les ministres se succédant place Beauvau. Au lendemain de la victoire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen au second tour, Nicolas Sarkozy s’inquiète des « dérives » du droit d’asile qui en feraient « un vecteur d’immigration irrégulière » et entend légiférer à propos des « abus » de « mariages blancs ».
Quinze ans plus tard, deux mois après l’élection d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, s’alarmera face au risque de « l’appel d’air » et de la « spirale ». Il parlera même de « submersion » migratoire.
Parallèlement, certaines promesses jamais tenues deviennent le symbole d’une gauche dépourvue de courage. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, proposé par Mitterrand en 1981, abandonné par Jospin aux portes du Sénat en 2000, repris par Hollande en 2012 puis à nouveau enterré lors de la « crise syrienne » de 2015, en livre un exemple manifeste.
Les contextes changent, les recettes restent
La dernière version, publiée mi-mars, du sondage annuel sur le droit de vote des étrangers réalisé depuis 1994 par La Lettre de la citoyenneté, indique pourtant que 68 % de la population y est favorable. Une part en constante augmentation depuis 2013, alors à 54 %. Malgré cela, il apparaît aujourd’hui presque inconcevable qu’une telle mesure puisse figurer au menu de la loi Darmanin.
Les contextes changent, mais la recette reste la même : à des discours simplistes – « être méchants avec les méchants, gentils avec les gentils » – succède tout un lot de dispositions techniques et complexes qui ajoutent de la maltraitance.
Aujourd’hui en France, personne n’est plus capable d’appliquer le droit des étrangers.
« Aujourd’hui en France, personne n’est plus capable d’appliquer le droit des étrangers, constate Jean-François Martini, il faut un niveau d’hyperspécialisation. Comment un fonctionnaire de préfecture pourrait intégrer une masse aussi dense d’informations ? » Un constat que Marius Roux fait tous les jours : « Dans nos permanences, nous passons notre temps à contester des OQTF. Nous n’avons plus celui d’aider les personnes sur tous les autres volets de la vie », se désole-t-il.
Pire, il n’est pas rare que l’État français se rende responsable de fautes graves : « Des réfugiés ont été renvoyés dans leur pays d’origine. C’est complètement contraire au droit », atteste Gérard Sadik. En octobre dernier, les autorités avaient ordonné des expulsions vers la Syrie, bafouant le droit français, européen et international. Les OQTF n’avaient pu être empêchées que parce que l’ambassade syrienne avait refusé de délivrer un laissez-passer.
Pour aller plus loin…
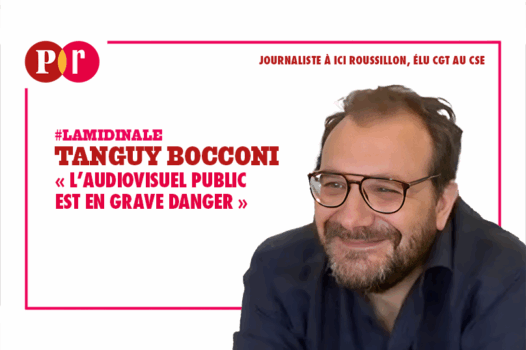
« L’audiovisuel public est en grave danger »

Audiovisuel public : malgré les audiences, une volonté de reprendre la main politiquement

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »