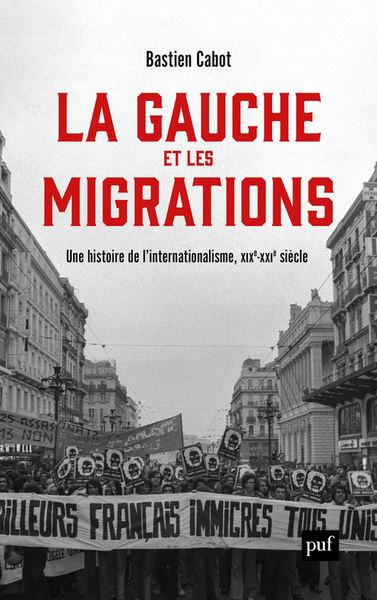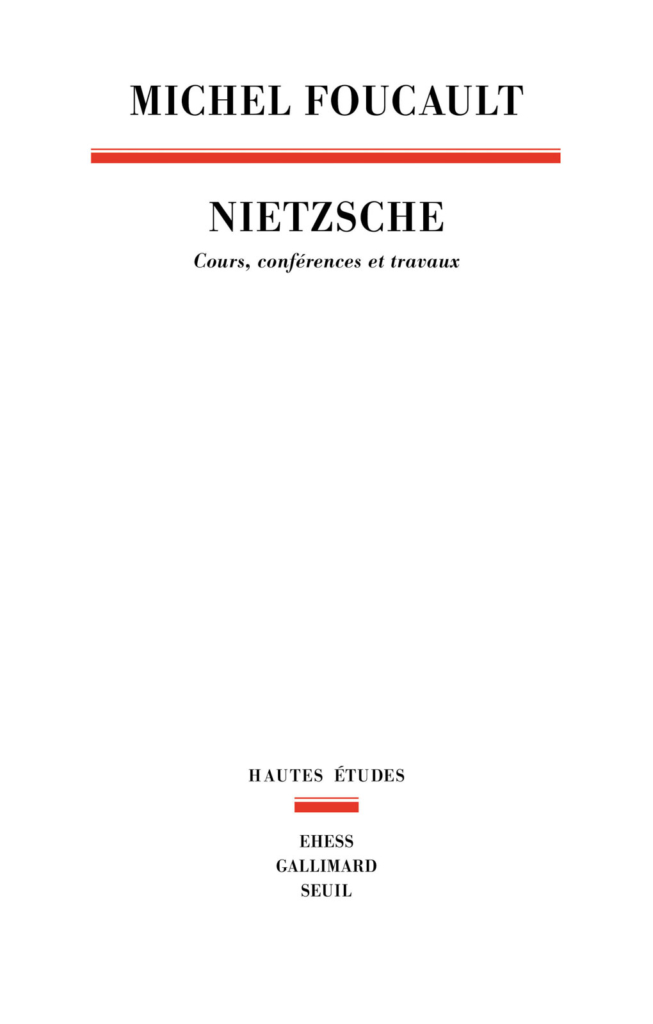Un « sociosolutionnisme » à double tranchant pour l’écologie politique
Pendant du technosolutionnisme, le concept se fraye doucement un chemin sur les réseaux sociaux et dans la vulgarisation scientifique. Simple contre-feu technophile ou mise en garde critique ?
dans l’hebdo N° 1813 Acheter ce numéro

© Photo Josse / Leemage / AFP
Apparaissant aux détours de conversations et de messages sur internet, le sociosolutionnisme est un concept émergent, employé notamment par Rodolphe Meyer, docteur en sciences de l’environnement et créateur de la chaîne YouTube « Le Réveilleur ». Consacrée à la diffusion des savoirs scientifiques sur le changement climatique et les moyens de le limiter, celle-ci est proche de nombreux vulgarisateurs comme Osons causer, Heu?rêka ou encore M. Phi. D’autres variantes de cette notion sont défendues sur le réseau X (ex-Twitter), tel le « solutionnisme culturel », sans percer.
Quand on fait des paris importants sur des leviers de consommation, il faut en avoir conscience.
R. Meyer
Pour Rodolphe Meyer, le concept se veut une réponse à certaines critiques : « Quand on parle de technique, on se voit opposer très rapidement le technosolutionnisme, qui désigne la croyance selon laquelle la technique va tout régler seule. » Ces critiques peuvent vite verser dans un rejet de la moindre contribution de la technique à la lutte contre le changement climatique, au profit de solutions ne reposant que sur des leviers de consommation. « Par exemple, la voiture électrique permet de réduire les émissions. Ce n’est pas merveilleux, mais la solution serait-elle que plus personne n’ait de voiture ? Est-il possible d’en arriver là ? Cela me paraît être un pari très fort. Dans ce cas, on parlerait de sociosolutionnisme. Quand on fait des paris importants sur des leviers de consommation, il faut en avoir conscience. »
Position médiane
Pour autant, l’ambition n’est pas d’opposer deux faisceaux de propositions, les unes techniques, les autres politiques : « J’entends et trouve justifiées certaines critiques portant sur le technosolutionnisme, mais je fais partie de ceux qui estiment contre-productif d’opposer les leviers techniques et les leviers de consommation. » Cette position médiane fait écho aux leviers de réduction des émissions identifiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), qui incluent tant des évolutions de la demande que des évolutions technologiques.
La démarche s’inscrit également dans le sillon de l’éducation populaire : « Je consacre ma vie professionnelle à essayer d’informer, ce qui est déjà une forme de militantisme. Si l’on se met d’accord collectivement, il est possible de réduire nos émissions. Je pense que cette approche politique est efficace car elle a déjà fonctionné pour certains problèmes : les leviers politiques et réglementaires sont extrêmement efficaces. »
Proposé pour nourrir la réflexion, le concept souffre néanmoins d’une récupération au profit de milieux défendant le statu quo politique et le recours aux seules solutions techniques. Sur X, le sociosolutionnisme devient une arme de discrédit de positionnements politiques radicaux. Fataliste, Rodolphe Meyer déplore ces logiques de polarisation tout en reconnaissant son impuissance : « Je ne considère pas que c’est un concept novateur ou incroyable, peut-être même n’est-ce pas le bon terme. Mais je pense que cette réflexion sur les paris sociaux que l’on fait est importante et qu’elle permet de mieux se positionner. »
Différences d’appréhension
Alors que les Soulèvements de la Terre poursuivent un riche processus d’introspection sur les moyens de lutter dans l’ouvrage Premières Secousses (1), le concept de sociosolutionnisme s’inscrit dans un débat déjà ancien : celui sur les frontières du possible.
Premières Secousses, Les Soulèvements de la terre, La Fabrique, 296 pages, 15 euros.
Pour les uns, la démocratie institutionnelle est désarmée, voire complice du désastre écologique, et le combat radical n’est pas un pari, mais une nécessité. S’il est impossible d’espérer un changement dans le système politique actuel, alors la lutte radicale devient le pari le moins hasardeux. En revanche, pour les tenants du sociosolutionnisme, le débat démocratique institutionnalisé reste essentiel et possible – il a même prouvé son efficacité dans de nombreux domaines. Dès lors qu’une remise en cause radicale des modes de vie apparaît improbable, partir de l’existant semble plus prudent, y compris dans un contexte d’urgence.
Pour les tenants du sociosolutionnisme, le débat démocratique institutionnalisé reste essentiel et possible.
Ces différences d’appréhension du réel ne sont pas sans rappeler les anathèmes en « socialisme utopique » prononcés par Karl Marx au XIXe siècle, ou la critique du « gauchisme » par Lénine et la tradition communiste tout au long du XXe siècle, remettant en cause des propositions politiques faisant fi des réalités. Cependant, alors que le changement climatique pèse comme un couvercle et ferme l’horizon, tout pari prend un tour tragique : tâchons de prendre les bons.
Les parutions de la semaine
La gauche et les migrations. Une histoire de l’internationalisme (XIXe-XXIe siècles), Bastien Cabot, PUF, 376 pages, 19 euros.
Dans cette véritable synthèse mondiale du rapport complexe des gauches aux migrations depuis la fin du XVIIIe siècle, l’historien Bastien Cadot analyse les contradictions du mouvement ouvrier entre « modernité socialiste » internationaliste et réalités locales des travailleurs exploités par un patronat qui n’hésite pas à recourir à la main-d’œuvre étrangère pour tirer les salaires vers le bas. Des travailleurs chinois en Californie à la fin du XIXe siècle aux Vietnamiens dans les usines de RDA, sans oublier les mineurs, métallos ou saisonniers immigrés dans les régions françaises, cet ouvrage rigoureux soulève une question épineuse pour la gauche. Où l’histoire est d’une grande actualité.
Quand dire c’est faire, John Langshaw Austin, préfacé et traduit de l’anglais par Bruno Ambroise, Seuil, 264 pages, 23,50 euros.
Un classique. La linguistique moderne, après Jakobson ou Lévi-Strauss, a été profondément marquée par J. L. Austin (1911-1960), avec ce grand livre issu de conférences données à Harvard en 1955. Le Seuil en publie aujourd’hui une nouvelle traduction (cinquante ans après la première), réalisée par l’un des meilleurs spécialistes de la philosophie du langage d’Austin. Respectant autant l’humour de l’auteur que sa subtilité conceptuelle, soulignant « son attention au langage ordinaire pour en déterminer l’efficacité pragmatique », Bruno Ambroise ouvre le lecteur au renouveau de ce texte fondamental : « L’occasion de se saisir d’un enjeu politique en explorant ce qu’accomplit le langage d’un individu parlant. »
Nietzsche. Cours, conférences et travaux, Michel Foucault, dir. Bernard E. Harcourt, Seuil/Gallimard/EHESS, coll. « Hautes études », 424 pages, 28 euros.
En 1984, quelques semaines avant sa mort, Michel Foucault déclarait : « Nietzsche et Heidegger, ça a été le choc philosophique ! » Et le professeur au Collège de France de préciser : « Ce sont les deux auteurs que j’ai le plus lus. […] Je crois que c’est important d’avoir un petit nombre d’auteurs avec lesquels on pense, avec lesquels on travaille, mais sur lesquels on n’écrit pas. » Issus des archives de Foucault à la BNF, ces Cours et travaux sur l’auteur d’Ainsi parla Zarathoustra, inédits, illustrent pourtant le rôle fondamental de la confrontation avec l’œuvre de ce dernier dans la conception de sa « méthode généalogique » et de sa « propre manière de philosopher ». Passionnant !
Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »