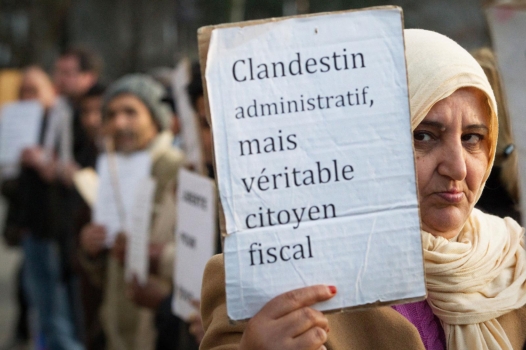Aide à mourir : à l’Assemblée, cinq points de crispation
Les députés ont adopté, mardi 20 mai, l’article 4 sur les conditions d’accès du projet de loi « droit à mourir ». Malgré cette adoption, de réelles divisions persistent sur le fond, avant le vote des député·es prévu mardi 27 mai.

© Richard Stachmann / Unsplash
Le premier volet sur les soins palliatifs du projet de loi sur la fin de vie devrait être voté mardi 27 mai sans difficulté. Le deuxième texte, sur l’aide à mourir, est, lui, vivement débattu depuis vendredi 16 mai. Les principaux opposant·es à droite sont aussi accompagné·es de quelques rares député·es de gauche qui s'inquiètent de potentielles dérives.
Le débat n’est pas nouveau. La commission des Affaires sociales a quasiment repris à l'identique le projet de loi sur la fin de vie de 2024, qui a dû être interrompu avec la dissolution de l’Assemblée nationale. Sur les vingt articles que contient le texte, cinq ont d’ores et déjà été votés depuis le début des discussions.
Mardi 20 mai, tard dans la soirée, les député·es se sont entendu·es à 164 voix pour contre 103 sur les critères d’accès. La personne doit être majeure, française ou résidente en France ; atteinte d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital en phase avancée ou terminale ; confrontée à des souffrances physiques ou psychologiques qui ne peuvent être apaisées d’une autre manière, et apte à manifester sa volonté. Pour autant, les points de crispations persistent. Et pourraient être déterminants lors du vote, mardi 27 mai, clôturant la première lecture de l’hémicycle, avant de passer au Sénat.
Je trouve qu’on est sur un texte de liberté et de choix, et pour moi c'était important de l'avoir jusqu'au bout, jusqu'au geste final.
É. Leboucher Accorder le droit à mourir est-ce soigner ?Euthanasie ou suicide assisté ? Samedi 17 mai, les député·es ont choisi de rétablir l’auto-administration qui avait été retirée du texte. Les patient·es en fin de vie devront alors s’auto-administrer le produit létal sauf s'iels sont dans l’incapacité de le faire. Un amendement que regrette la députée insoumise et corapporteuse du texte, Élise Leboucher, pour qui l’auto-administration pourrait dissuader certaines personnes : « Je trouve qu’on est sur un texte de liberté et de choix, et pour moi c'était important de l'avoir jusqu'au bout, jusqu'au geste final. »
Une manière aussi de « sécuriser » la personne en lui permettant de « savoir que si elle ne pouvait pas le faire, dû à la gravité du geste, il était possible de demander à un médecin, sans remettre en cause sa volonté de mourir ».
Mais ce vote, de 75 voix contre 41, n’a pas permis de rassurer celles et ceux qui souhaitent « protéger les soignants ». La définition du soin est au cœur de la discussion : l’injection d’une solution létale est-elle un acte médical ?
Mardi 20 mai, au perchoir, la députée écologiste de Paris, Danielle Simonnet, a avancé une réponse : « J’aimerais à présent répondre à celles et ceux qui prétendent que les médecins et soignants seraient opposés à une telle évolution. D’après un sondage de l’Ifop réalisé en avril 2025, 74 % des médecins sont favorables à la légalisation de l’aide à mourir et 70 % considèrent que l’aide à mourir est un soin de fin de vie, au même titre que la sédation profonde et continue. » Elle a ajouté que la clause de conscience reste effective et qu’il sera possible pour les médecins de refuser.
Validisme et « notion floues »Les critères d’accès au dispositif notamment en ce qui concerne les termes de « phases avancées et terminales » ont été
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »