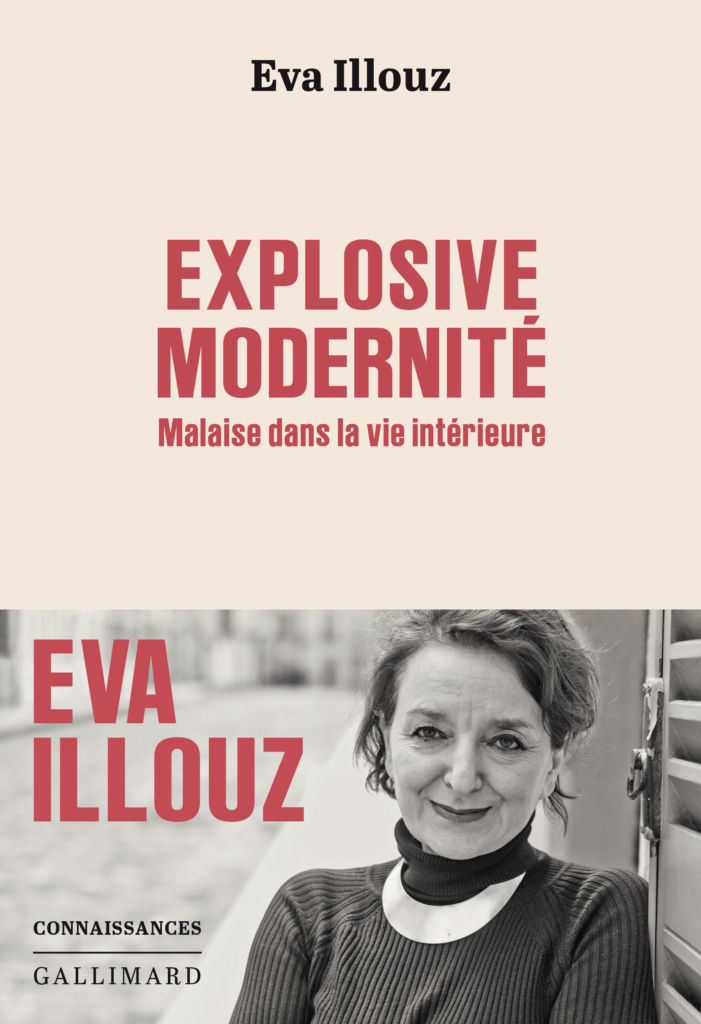Ce sentiment que l’histoire ne sert à rien est insupportable
Face à la violence, à l’injustice ou à l’oubli, la colère peut servir l’émancipation des peuples, mais elle peut se révéler dangereuse si elle provoque de l’impuissance ou pire : du ressentiment.
dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Roman PILIPEY / AFP
Combien de tribunes sont d’abord des cris de colère ? Colère contre ce qui se passe à Gaza, colère contre Poutine, contre Trump. Colère en France contre un plan d’économies injuste jusqu’au sordide, frappant les pauvres et les malades. Colère après les reculs sur l’écologie qui hypothèquent l’avenir de nos enfants. Les motifs ne manquent pas. À tel point que notre rage s’étend peut-être finalement au fond de l’air fascisant de toute une époque.
Il faut pourtant se méfier de cette émotion à double tranchant. Il faut la laisser parler quand elle est appel à la révolte et quand elle s’empare des peuples pour devenir révolution. Mais il arrive qu’elle soit la première manifestation de l’impuissance. J’enrage parce que je ne peux rien faire contre le génocide à Gaza. Mon indignation porte aussi contre ces chefs d’État qui n’en finissent pas de protester hypocritement quand ils auraient les moyens d’agir.
Notre rage s’étend peut-être finalement au fond de l’air fascisant de toute une époque.
Que l’Europe unie décide de sanctionner Israël pour imposer à son gouvernement de se retirer de Gaza, de décoloniser la Cisjordanie et d’admettre la création d’un État palestinien, et la face du Moyen-Orient en serait changée. Trop souvent, j’entends dire par des femmes et des hommes de bonne volonté mais fatigués : « Le Moyen-Orient, j’ai renoncé à y comprendre quelque chose, c’est trop compliqué pour moi. »
C’est fou ce que la fameuse formule de De Gaulle « l’Orient compliqué », sortie de son contexte, a pu faire de tort à la raison. Il faut un certain culot pour oser répondre : « Non, c’est en réalité très simple. » C’est une banale histoire de colonisation, comme tant d’autres qui ont pris fin. Comment admettre que ce conflit soit tombé entre les mains de ce qu’il y a de pire dans la nature humaine : le racisme. Il ne sert à rien d’en vouloir aux suprémacistes juifs. Ils sont ce qu’ils sont, et chaque groupe humain a ses semblables, généralement minoritaires et d’une nuisance limitée.
Mais, ici, on leur a cédé le pouvoir, et ils sont à la tête d’un gouvernement qui peut tranquillement qualifier les Arabes d’animaux et applaudir à leur extermination. Comment en est-on arrivé là ? Comment a-t-on pu tolérer leurs discours sans que ceux qui les professent soient mis au ban de la civilisation ? On connaît la réponse « de mauvaise foi » : l’islamisme, le Hamas, le terrorisme.
À Kyiv comme à Gaza, c’est la même idéologie qui répand le malheur.
C’est comme toujours renverser les liens de cause à effet. Il faut oser remonter le fil de l’histoire, quand le terrorisme était de l’autre côté. Notre colère, en vérité, porte sur ce qu’on appelle la « realpolitik ». C’est paradoxalement la raison qui se retrouve au banc des accusés. Trop de raison. Trop de réalité, comme le disait l’admirable Annie Le Brun. Trop de soumission aux rapports de force, de renoncement à la morale et à la justice que l’on regarde soudain comme « irréalistes » et, pour ainsi dire, comme ridicules. À la haine des uns répond le cynisme des autres.
On éprouve la même colère devant les images qui nous viennent d’Ukraine. Les mêmes immeubles éventrés, la même population apeurée, frappée par l’absurde. « Pourquoi nous ? » À Kyiv comme à Gaza, c’est la même idéologie qui répand le malheur. Un nationalisme qu’incarnent un despote ici, des fanatiques religieux là, qui associent leur pouvoir personnel à la réalisation d’ambitions territoriales sans limites et qui convoquent une mystique pour entraîner le peuple dans leur aventure.
Ce qui nous est insupportable, c’est ce sentiment que l’histoire ne sert à rien. Jamais aucune époque n’a commémoré plus que la nôtre. Et jamais aucune n’a répété les mêmes crimes avec autant d’obstination. Dans son dernier livre tout entier consacré aux émotions, et qui aurait pu contribuer à ce numéro de Politis, Eva Illouz consacre de belles pages à la colère, celle qui naît quand le faible, l’opprimé, le colonisé ne trouve plus aucun recours parce que la justice ne veut pas entendre sa plainte.
Quand l’État fait cause commune avec les puissants pour spolier les pauvres. La logique du capitalisme. La sociologue des émotions cite ce sentiment d’enfermement qui, en 2010, s’est emparé d’un jeune vendeur ambulant tunisien quand la police lui a confisqué son étal. Il a retourné sa colère contre lui et s’est immolé par le feu. Mais le peuple s’est emparé de cette colère pour en faire une révolution.
Eva Illouz observe que la peur est une émotion redoutable qui permet à des politiques de militariser un État.
La sociologue évoque ensuite Michael Kohlhaas, le personnage d’Heinrich von Kleist (1777-1811) à qui un riche propriétaire terrien vole ses chevaux et dont la colère devient irrépressible quand il comprend que les magistrats sont inféodés au propriétaire. Mais, à la différence du jeune Tunisien de 2010, Kohlhaas ne cède pas au désespoir. Il lève une armée de déshérités et organise lui-même la révolte.
Eva Illouz analyse un autre sentiment dominant de l’époque : la peur. Cette peur que la droite sait si bien instrumentaliser contre l’autre, le migrant, l’étranger. La sociologue observe que cette émotion redoutable permet à des politiques de militariser un État. Poutine n’est pas loin. Mais quel est cet État ultra-militarisé où tout le monde, ou presque, est « réserviste » ? Où la peur est manipulée jusqu’à faire croire toujours à une menace existentielle ? Quel est donc ce pays où les milliers de Michael Kohlhaas n’ont aucun recours quand l’armée ou les colons détruisent leurs maisons ou tuent leurs enfants parce qu’ils sont allés chercher un sac de farine ? Voilà la grande énigme du livre d’Eva Illouz.
De ce pays, dont elle est citoyenne, Eva Illouz parle peu, sinon pour affirmer sa légitimité biblique et prendre une distance salutaire avec « les nostalgies restauratrices », qu’elle impute seulement à un « mouvement messianique et sectaire ». Quand elle approche le « sujet » du bout de la plume, ce n’est pas pour comprendre la colère des colonisés, et leurs révoltes, mais pour dénoncer l’aveuglement d’une gauche qui se trompe à propos du Hamas.
Le déni d’Eva Illouz est comme l’éléphant au milieu du salon. La sociologue des émotions oriente sa colère plutôt contre le terroriste Michael Kohlhaas que contre ses spoliateurs. En cela, elle est assez représentative de ce qu’on appelle « le sionisme de gauche ». Elle n’échappe pas au nationalisme qu’elle condamne. La colère mal orientée et la peur sont des périls de notre époque. Ils peuvent produire un Donald Trump ou un Viktor Orbán. Il arrive aussi que la colère, à force d’être exaltée en vain, devienne fatigue, et désespoir. Une expression, belle et terrible, dit tout : « De guerre lasse. » De la colère il ne faut donc pas abuser.
Une analyse au cordeau, et toujours pédagogique, des grandes questions internationales et politiques qui font l’actualité.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Conseil de la paix, Groenland, Europe : ce que Trump fait à l’Otan

Derrière le Groenland, le sort de l’Europe

Le trumpisme, anatomie d’un fascisme moderne