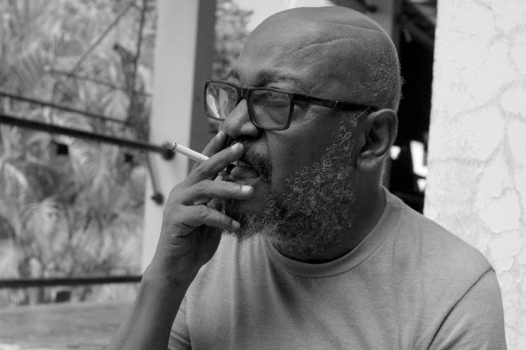Camille Laurens : « L’amour est une question politique »
Dans Ta Promesse, roman formellement impressionnant, l’autrice raconte une relation toxique entre sa narratrice, se croyant engagée dans une véritable idylle, et un homme charmeur et manipulateur. Rencontre avec une écrivaine qui excelle dans la réflexion sur un sentiment essentiel.
dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Francesca Mantovani pour les Éditions Gallimard
Claire Lancel est en passe d’être jugée pour avoir grièvement blessé son compagnon, Gilles. Une issue dramatique à une idylle qui avait pourtant commencé comme dans un rêve. Aux yeux de Claire en tout cas. Gilles lui a cependant demandé de lui faire une promesse : celle de ne jamais écrire sur lui. Or, Claire, écrivaine, est l’autrice de plusieurs romans relevant tous de l’autofiction où elle n’a décrit que ses chagrins, ses ratages amoureux. Elle a accédé volontiers à sa requête : « Depuis le premier jour je ne voyais pas comment cet homme, cette merveille d’homme, pourrait jamais me faire souffrir. L’évidence de l’amour heureux, comment la raconter ? », dit-elle à son avocate.
Le livre a des allures de thriller car, face au tribunal, Claire risque de manquer de preuves factuelles. Il faut donc qu’elle comprenne ce qu’il s’est passé, déconstruise le piège qui s’est refermé sur elle pour préparer sa défense. Mais comment apporter la preuve des agissements d’un manipulateur, d’un « pervers narcissique » qui agit dans la vie comme dans son métier : Gilles est metteur en scène de spectacles de marionnettes ? Les mots sont au cœur de ce roman haletant et leurs différents usages contradictoires : pour charmer, pour leurrer ou pour traquer la vérité. Au bout, il y a la littérature, que Camille Laurens fait ici triompher.
Pourquoi est-ce si important d’écrire sur l’amour comme vous le faites dans plusieurs de vos livres et à nouveau dans Ta Promesse ?
Camille Laurens : Cela me semble important parce que c’est un sentiment qui nous relie entre êtres humains. Sans l’amour, rien ne se produit vraiment. C’est le premier lien à la naissance. Manquer d’amour dès le départ est une catastrophe. C’est pourquoi, contrairement à ce qu’on me renvoie souvent, l’amour est à mes yeux une question politique.
L’intime est forcément mêlé au collectif. Je ne fais pas de césure entre les deux.
Cela signifie que l’amour est une affaire intime et qu’il intervient aussi dans le champ public ?
Oui. L’intime est forcément mêlé au collectif. Je ne fais pas de césure entre les deux. Beaucoup de choses se résoudraient dans l’ordre de la société avec un peu plus d’amour. Je ne parle pas là de la passion amoureuse, bien sûr, mais davantage de l’amour du prochain – comme les religions le professent, et d’ailleurs, étymologiquement, le mot « religion » signifie « ce qui relie » –, de l’amour au sens large, du rapport à l’altérité, de l’empathie. Hélas, on assiste au contraire à un accroissement de l’égocentrisme. Que ce soit dans la sphère intime ou dans la société, il y a de moins en moins de vrais rapports aux autres, de vraies rencontres.
Si l’on considère l’amour des amoureux, pensez-vous que cet amour se transforme à travers le temps ? N’est-il pas aujourd’hui la proie du capitalisme ?
Oui, il a tendance à être transformé en objet de consommation. La rencontre amoureuse est devenue un marché. Et on se quitte aujourd’hui sur les sites de rencontre en invoquant des détails qui ne conviennent pas dans l’apparence, des critères physiques, de la même façon qu’on est déçu par un produit acheté dans un magasin. L’amour est jetable. Cela dit, bien avant la libération sexuelle et sa récupération par le capitalisme, au XIXe siècle par exemple, il y avait le mariage, le poids de la religion, le fait que les femmes étaient au départ davantage objets que sujets du désir amoureux – comme on le voit chez Benjamin Constant : et on ne s’aimait pas forcément davantage…
L’amour est donc une construction historique…
Bien sûr. Tout ce qui relève des liens humains évolue avec l’histoire.
Avec Ta Promesse, vous écrivez sur une forme d’amour très
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

« Viens Élie », l’arbre et la forêt

« Trop tard », l’extrême droite à la sauce Popeye

« Chimère », identités contrariées