L’IA, une nouvelle arme au service du capital
L’intégration de l’intelligence artificielle au monde du travail suscite nombre de prédictions apocalyptiques. Et si elle n’était qu’une forme renouvelée du taylorisme, désormais augmenté par le numérique ?
dans l’hebdo N° 1878 Acheter ce numéro
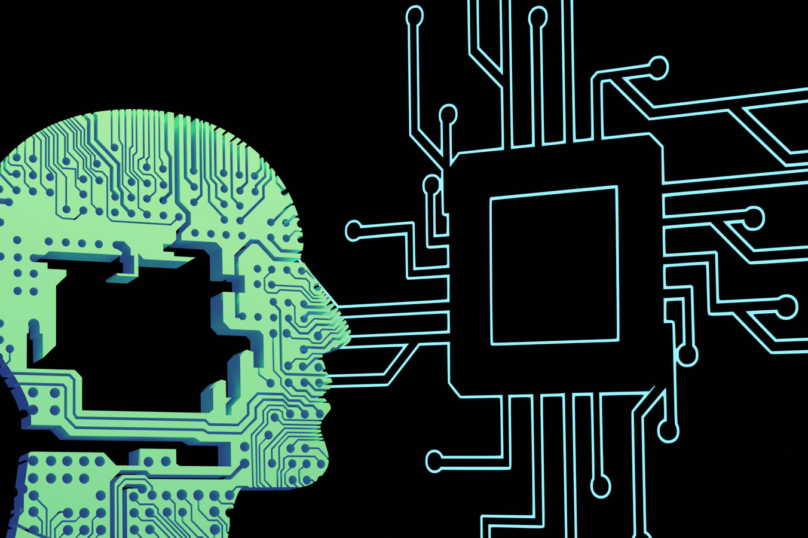
Une révolution ou une rupture anthropologique, voilà ce que représenterait l’avènement de l’intelligence artificielle. Offerte par le progrès technique, guidée par de géniaux entrepreneurs, « influenceurs du numérique » et « capitalistes de la science », promue par les États et les médias, l’IA conduirait à des bouleversements profonds des sociétés, voire à une nouvelle étape dans l’histoire de l’humanité. Une évolution présentée comme « inévitable, désirable et nécessaire » et que le sociologue Juan Sebastián Carbonell s’efforce de déconstruire dans son nouvel essai, Un taylorisme augmenté. Critique de l’intelligence artificielle.
L’auteur veut désenchanter son usage pour mieux politiser les choix technologiques et les extraire de la fatalité.
Déjà auteur d’un ouvrage remarqué, Le Futur du travail (Éditions Amsterdam, 2022), dans lequel il analysait les prédictions sur le chômage technologique de masse et l’émergence d’un précariat en raison des nouvelles technologies, Carbonell s’intéresse ici aux effets de l’IA sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. L’objectif est clair : contre la « pédagogie industrialiste » qui naturalise et légitime l’emploi croissant de l’IA, comme hier l’introduction des machines et de la chaîne devant des ouvriers récalcitrants, l’auteur veut désenchanter son usage pour mieux politiser les choix technologiques et les extraire de la fatalité.
Quelles sont les conséquences réelles de l’IA pour le monde du travail ? Carbonell critique autant les prédictions sur une future montée en qualification des travailleurs pour maîtriser ces nouveaux outils que les mises en garde contre une polarisation des emplois entre les activités répétitives, prétendument remplaçables, et les activités créatrices, qui seraient épargnées. Les études empiriques invalident ces hypothèses, comme elles invalident déjà l’angoisse d’un chômage technologique de masse.
"Dépossession machinique"En revanche, l’IA apparaît comme « un outil de dégradation du travail dans les mains des entreprises ». En définissant le taylorisme comme une simplification, standardisation et parcellisation du travail, renvoyant les travailleurs aux seules tâches d’exécution et les privant de toute œuvre de conception, l’IA perpétue la « dépossession machinique » que Taylor a développée il y a plus d’un siècle et se présente comme un « taylorisme augmenté ».
Que ce soit sur les routes, dans des entrepôts, des hôtels ou encore des hôpitaux, la gestion « algocratique » vise à formaliser les savoirs, à disséquer les tâches et à contrôler toujours plus le travail. Si certaines tâches répétitives peuvent néanmoins être épargnées en raison du coût de l’IA, les activités créatrices sont elles aussi menacées. Carbonell prend l’exemple de la traduction. Ainsi, les textes littéraires sont tout autant concernés par l’IA que les textes techniques. Le traducteur est alors ramené à un travail de post-édition : vérifier ce
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Oleksandra Matviichuk : « Poutine voit l’Ukraine comme un pont vers l’Europe »

L’hystérie, symptôme… des violences masculines

Christiane Taubira : « Face à Trump, la France ne joue pas son rôle de puissance régionale »







