Typhaine D : quand la justice décortique la violence masculine en ligne
Neuf hommes ont été jugés, ce 17 septembre, par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, après une vague de cyberharcèlement subie par l’artiste Typhaine D. Récit.

© Salomé Dionisi
Dans le même dossier…
« Pour lutter contre les cyberviolences, il faut combattre le sexisme hors-ligne » Le cyberharcèlement frappe de plus en plus tôt et surtout les femmesQui aurait pu penser que l’écriture inclusive pouvait mener au tribunal ? Sûrement pas l’artiste Typhaine D. « Au bucher ! Sorcière ! », « Il faut la piquer », « Je déboiterai bien une bonne féministe », « Sale pute de Femen, le seul mot féminin que tu dois connaitre c’est ‘cuisine’ » (sic)… Des messages comme ceux-là, Typhaine D en a reçu des milliers en juillet 2022, après avoir participé à une émission du Crayon.
Le média en ligne avait publié un très court extrait de la vidéo sur les réseaux sociaux – manifestement pour créer la polémique –, dans lequel Typhaine D défendait l’usage de la Féminine universelle, une version de la langue française féminisée, pensée pour sensibiliser à l’usage excessif du masculin « neutre ». Un extrait, et une vague de harcèlement en ligne. Un an après le début des insultes, des incitations au viol et au meurtre, l’artiste a porté plainte contre X, et onze hommes ont été retrouvés.
Évolution de la justice
Les procès comme celui-ci sont encore peu nombreux en France. Les politiques peinent encore à encadrer les dérives des grandes plateformes – en témoigne la dernière commission d’enquête parlementaire sur TikTok –, et la justice a du mal à suivre le rythme des flots de haine en ligne. D’après une étude Ipsos, 70 % des plaintes déposées pour des faits de harcèlement en ligne n’ont donné lieu à aucune poursuite. Pour pouvoir faire comparaître des prévenus, encore faut-il avoir les moyens de les identifier.
86 % des plaintes pour des faits de violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite en France.
Fait encore plus rare : lorsqu’elle arrive au commissariat de son quartier pour porter plainte, Typhaine D est directement reconnue par les officiers. Ils avaient repéré la vague de cyberharcèlement, et s’attendaient à ce qu’elle se présente. « Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à l’enquête parce que j’ai toujours été prise au sérieux, et ça m’émeut beaucoup », déclare la plaignante lors du procès, étonnée d’avoir été prise au sérieux. Et pour cause : 86 % des plaintes pour des faits de violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite en France.
Depuis 2020 aussi, le tribunal de Paris est doté d’un pôle contre la haine en ligne. Cette instance décortique les mécanismes spécifiques aux délits en ligne pour les juger au mieux. C’est son vice-président qui sera procureur dans ce procès.
Des visages derrière les adresses IP
Onze hommes donc, mais seulement six, ce 17 septembre, sur le banc des prévenus. Trois d’entre eux ne se sont pas présentés et seront jugés en leur absence. Deux étaient mineurs au moment des faits, et seront jugés séparément. Les six présents – d’âges, de professions, de régions différentes – se parlent comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Ces hommes, ces « Monsieur-tout-le-monde », sont les visages de la violence masculine en ligne. Le visage de Typhaine D, les accusés le connaissent par cœur. Ils l’ont eux-mêmes partagé ou commenté sur les réseaux sociaux. Elle, les découvre.
Face à un discours clivant, il y a un effet de groupe, on a l’impression que notre responsabilité est diminuée.
Robin K.
Tous sont accusés de harcèlement en ligne à caractère sexiste. Plusieurs d’entre eux, qui avaient formulé des appels au suicide ou au meurtre, sont aussi poursuivis pour provocation publique à commettre un crime. « Quand je disais qu’il fallait la pousser sous un train, c’était du second degré. C’était pas concret, je n’imaginais pas que d’autres pouvaient avoir l’image », se défend Mattéo M., boulanger de 25 ans.
Certains admettent avoir été entraînés dans le flot d’insultes. D’autres rejettent la faute sur les réseaux sociaux, qui leur auraient proposé ces vidéos au hasard. Signe que la justice commence à prendre conscience des mécanismes des violences sexistes, le président et le procureur soulignent le fonctionnement des algorithmes : sur les réseaux sociaux, plus on consomme de contenus sexistes, plus on nous en propose.
Chacun des accusés donne l’impression de s’être senti protégé par l’anonymat que procure internet. « Il y a cet effet de meute sur les réseaux : face à un discours clivant, il y a un effet de groupe, on a l’impression que notre responsabilité est diminuée », reconnaît Robin K., 31 ans. Lui, admet avoir été pris dans une bulle numérique pendant des années, avoir consommé et commenté des contenus sur les réseaux sociaux à longueur de journée, ne minimise pas les faits, et soigne ses traumatismes d’enfance en thérapie depuis un an.
Son avocat souligne cette évolution qui ne transparaît pas chez les autres prévenus : « Plus de trois ans après les faits, il s’est passé des choses dans sa vie. (…) À l’époque, il était bloqué dans une sphère négative. Les sociologues qui travaillent sur le sujet documentent très bien ce phénomène. »
Du sexisme au masculinisme
L’une des circonstances aggravantes des accusations qui pèsent sur les prévenus, c’est le caractère sexiste du harcèlement. Dehors, sur le parvis du tribunal, une petite centaine de militant·es et de personnalités publiques – l’actrice Anna Mouglalis, la députée Sandrine Rousseau, la sénatrice Laurence Rossignol ou encore le fondateur de Mouv’Enfants Arnaud Gallais – sont venu·es, à l’appel des collectifs féministes, soutenir la plaignante. Les réseaux sociaux servent à ça aussi.
À l’intérieur de la salle d’audience, l’ambiance est plutôt à la négation des violences sexistes. « Salope », « sorcière », « demie folle » (sic)… Malgré la dimension misogyne indéniable des insultes utilisées, tous les accusés le martèlent : ils ne sont pas sexistes. « ‘Folle’, ça n’a pas de connotation sexiste. On dira aussi d’un homme qu’il est fou », conteste une avocate de la défense.
Jonathan L., 38 ans, affirme qu’il soutient les femmes : la gestion de la salle de sport dont il est propriétaire, il l’a « même confiée à une femme, qui travaille mieux que certains hommes ». Il se présente comme un amoureux de la littérature, et justifie son commentaire – « Au bucher ! Sorcière ! » – par la défense de langue française, en réaction à l’écriture féministe prônée par Typhaine D. Ses livres de chevet ? Des manuels d’entrepreneurs, la biographie de Jean-Luc Mélenchon, et le dernier livre de Philippe de Villiers.
Allant à rebours des arguments de la défense, le procureur souligne plusieurs fois l’importance de considérer la dimension sexiste des insultes, et demande même au tribunal de l’étendre à certains prévenus qui n’étaient pas concernés par cette circonstance aggravante. Il requiert, pour tous, des peines d’emprisonnement de plusieurs mois assorties d’un sursis, et des amendes allant de 1 000 € à 3 000 €.
À travers l’examen de l’attitude de chacun des prévenus, il semble se dessiner l’échelle du continuum des violences sexistes. L’un d’eux, Tommy P., 40 ans, minimise l’ampleur des féminicides et pointe du doigt le féminisme lors de sa garde à vue : « C’est pas les bonnes femmes qui sont féminicidées », « les Femen devraient faire un tour en prison », « l’hypocrisie est un mot féminin »… Sur les six accusés présents, c’est le seul qui ne formulera pas de remords. Son code pénal à lui : les règles d’utilisation de Facebook, qu’il assure respecter.
Je pense que toutes les femmes ici ont peur que ce monsieur nous tue.
Me De Filippis-Abate
Au cours de sa déposition, on découvre qu’il passe énormément de temps en ligne, à poster des messages sur des groupes Facebook, qu’il vit seul avec sa mère, et qu’il est passionné d’armes à feu. La mouvance masculiniste incel ne sera pas évoquée, mais son ombre plane au-dessus de l’audience. Un frisson parcours la salle. C’est Me De Filippis-Abate, avocate de Typhaine D, qui mettra des mots sur la réaction épidermique de beaucoup de femmes du public après la déposition de Tommy P. : « Je pense que toutes les femmes ici ont peur que ce monsieur nous tue. »
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Du Front national à Jordan Bardella, un système financier opaque

Déconstruire le duel des « deux France »
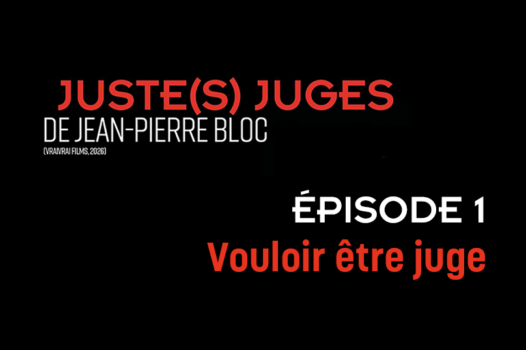
Juste(s) juges – Épisode 1









