Les marchés financiers ne servent pas l’intérêt général
Présentés comme incontournables, les marchés financiers ne financent rien d’utile : ils organisent la spéculation et appellent à l’austérité. Reprendre la main sur l’argent collectif, c’est redonner à la société le pouvoir de décider.

Dans le même dossier…
Comment la Macronie joue avec les marchés pour mieux s’imposer « Il faut instaurer un rapport de force citoyen avec les marchés financiers »Dans le même dossier…
Comment la Macronie joue avec les marchés pour mieux s’imposer « Il faut instaurer un rapport de force citoyen avec les marchés financiers »On les présente comme des arbitres incontournables, parfois comme une menace permanente planant au-dessus des États. Les marchés financiers seraient le juge suprême de nos politiques publiques, conditionnant notre capacité à investir, à emprunter, à assurer des retraites décentes. Mais derrière ce mythe, il y a une réalité beaucoup plus triviale : les marchés financiers ne financent rien d’utile à la collectivité.
Les marchés organisent la destruction de richesses et fragilisent les institutions sociales.
Les bourses et autres institutions financières ne sont pas là pour alimenter l’investissement productif. Elles échangent des titres déjà émis, spéculent sur des actifs, gonflent artificiellement la valeur des actions par le biais de rachats massifs. Leurs gigantesques transactions quotidiennes n’apportent pas un centime d’investissement nouveau. Elles alimentent surtout la concentration du capital et la logique de fusions-acquisitions qui structure depuis quarante ans le capitalisme financier.
Comme le souligne l’économiste Jean-Marie Harribey (nous ne pouvons que trop vous recommander la lecture de son blog et de ses chroniques pour Politis), « pour la production et la satisfaction des besoins collectifs, les marchés financiers ne servent strictement à rien ». Au contraire, ils organisent la destruction de richesses et fragilisent les institutions sociales, comme on le voit avec les fonds de pension qui minent l’esprit solidaire des retraites par répartition.
En France, le discours officiel répète à l’envi que la dette nous rend dépendants des marchés : si nous ne sommes pas « sérieux », alors les investisseurs se détourneront de nous et les taux grimperont. François Bayrou, commissaire au Plan, en a encore fait son refrain, alignant les chiffres pour mieux dramatiser la situation. Emmanuel Macron, lui, en a fait une arme politique, justifiant la réforme des retraites, la casse de l’assurance chômage ou la réduction des budgets publics au nom de la « responsabilité ».
L’État n’est pas un ménage
Mais ce récit oublie une donnée essentielle : c’est parce que les traités européens interdisent aux États d’emprunter directement auprès de leur banque centrale qu’ils sont contraints de passer par les marchés. Ce n’est pas une fatalité économique, c’est une construction politique.
L’État n’est pas un ménage. Contrairement à une famille, il ne rembourse jamais l’intégralité de sa dette : chaque emprunt arrivé à échéance est renouvelé par un autre. Surtout, il lègue aux générations futures non pas seulement des dettes, mais un patrimoine (hôpitaux, écoles, infrastructures) qui pèse plus lourd que l’endettement lui-même. Pourtant, ce qu’on martèle, c’est l’image d’une France « en faillite » à cause de sa dette publique.
La mise en scène de la peur n’est qu’un outil de plus pour imposer une austérité qui n’a rien d’inévitable.
Ce discours n’est pas neutre. Il justifie, en France, des politiques d’austérité qui affaiblissent les services publics, désarment la puissance publique et nourrissent un sentiment de dépossession. Ce sentiment, l’extrême droite s’en empare en prétendant offrir des solutions « souverainistes », alors qu’elle ne fait que recycler la logique néolibérale sous un vernis nationaliste.
Le gouvernement Macron porte une lourde responsabilité dans cette dépossession. En agitant l’épouvantail de la dette, il fabrique du consentement à des politiques injustes, antisociales et profondément impopulaires. François Bayrou joue les prophètes de malheur, mais la mise en scène de la peur n’est qu’un outil de plus pour imposer une austérité qui n’a rien d’inévitable.
Reprendre la main
Pourtant, les solutions existent. La crise du covid l’a montré : quand la survie du système était en jeu, la Banque centrale européenne a massivement soutenu les États, brisant en quelques mois des dogmes présentés comme infranchissables. De la même manière, la création d’un pôle public bancaire, longtemps écartée comme une utopie gauchiste, apparaît désormais comme une nécessité pour reprendre la main sur l’argent collectif.
Comme le rappelle Harribey : « Ce n’est pas l’épargne qui finance les investissements, mais la décision collective de les réaliser. » Autrement dit, la clé est politique, pas comptable. La question est donc moins économique que politique : qui décide de l’usage de notre argent ? Les marchés financiers, au service de la rentabilité des grands groupes ? Ou bien les citoyens, par l’intermédiaire d’institutions publiques capables de financer les investissements nécessaires à la transition écologique et sociale ?
En France, la gauche ne pourra retrouver de crédibilité qu’en affrontant ce cœur du pouvoir. Car il ne s’agit pas seulement de répondre aux marchés : il s’agit de redonner à la société le sentiment qu’elle décide à nouveau de son destin.
L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Bardella, l’œuf et la peur

Plans de licenciements : en finir avec le diktat des multinationales
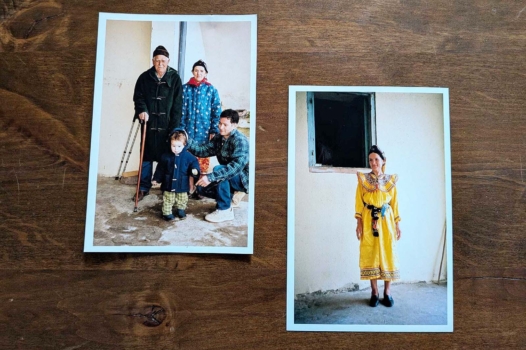
Ma lettre à Nicolas Sarkozy








