Sécurité sociale de l’alimentation : un brin d’utopie et une louche de questions
L’idée d’une Sécurité sociale de l’alimentation pour toute la population française ne cesse de faire des émules. Mais peut-elle réellement passer de l’expérimentation locale à l’échelle nationale ?
dans l’hebdo N° 1882 Acheter ce numéro

© Caissalim Toulouse
Au départ, il y a l’envie un brin utopiste que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine, et des citoyens motivés qui n’ont pas peur de prendre du temps pour des réunions, des formations, des discussions. Puis vient la pratique : l’expérimentation d’une forme de caisse alimentaire, ou Sécurité sociale de l’alimentation (SSA). En Gironde, en Alsace, à Montpellier, Brest, Paris, Marseille, Villeneuve-d’Ascq, Millau… les expérimentations essaiment avec le même espoir : un budget pour l’alimentation de 150 euros par mois et par personne, établi par les citoyens, intégré dans le régime général de la Sécurité sociale au nom de l’universalité.
Pendant trois ans, les citoyens investis ont pris plaisir à faire des réunions de 4 heures tous les 15 jours pour construire un projet solide.
É. GhauthierDans le Vaucluse, le village de Cadenet (4 000 habitants) fait office de pionnier en la matière puisque ses habitants pensent et mangent SSA depuis plus de cinq ans. Pendant le confinement, des acteurs du territoire gambergent sur les enjeux alimentaires. Pour avoir des réponses fiables à leurs questionnements, ils font venir des spécialistes de l’alimentation ou du tirage au sort et créent une miniconvention citoyenne sur l’alimentation. En janvier 2021, le Comité local de l’alimentation de Cadenet (Clac) lance l’expérimentation par la résolution de nombreuses questions : quelle forme de caisse alimentaire ? Comment décider ? Combien d’habitants choisir ? Quels professionnels sont conventionnés ?
« Pendant trois ans, les citoyens investis ont pris plaisir à faire des réunions de 4 heures tous les 15 jours pour construire un projet solide ! Cette culture commune est révolutionnaire », s’exclame Éric Gauthier, salarié de l’association Au maquis, en insistant sur la nécessité d’expérimenter sur le temps long, ce qui est difficilement compatible avec la temporalité des politiques publiques actuelles. En avril 2024, 33 personnes sont tirées au sort parmi les volontaires, dont des adhérents de l’épicerie solidaire du village, et peuvent bénéficier de 150 euros par mois pour acheter des produits locaux et de qualité.
« Ici, on fait une expérimentation de démocratie alimentaire, et non de la sécurité sociale. La mise en place de celle-ci est une question macroéconomique qui a besoin d’un système de cotisation sur le territoire pour lui donner de la puissance. Elle ne sera pas résolue par nos microcosmes locaux », explique Éric Gauthier. Pour lui, l’essentiel réside dans le pouvoir de décision des
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…
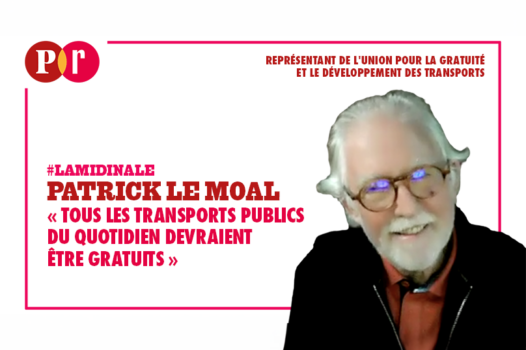
« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux







