L’enfant et les neurosciences
La généralisation des neurosciences en tant qu’argument d’autorité pour trancher des débats sociaux, économiques, politiques, ou autres, se fait le plus souvent sans la moindre prudence élémentaire.
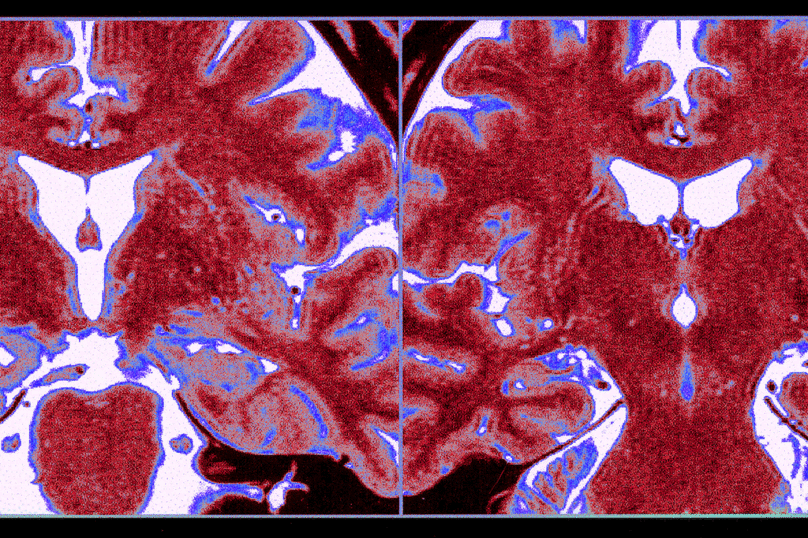
Les neurosciences cognitives ont le vent en poupe : il suffit de constater le relais médiatique dont bénéficient les recherches dans ce domaine, que ce soit sous la forme de vulgarisations destinées à une large audience ou dans des publications plus sérieuses du point de vue scientifique. Par ailleurs, l’engouement pour les créations de start-up spécialisées dans ce domaine, l’importance des financements attribués à certains projets de recherche (comme le milliard d’euros alloués par l’Union européenne au Human Brain Project) sont également le témoin de cet engouement.
Mais qu’en est-il dans le champ de l’enfance ? Au-delà des discours, peut-on réellement constater une révolution au niveau du soin ou des approches pédagogiques ?
En ce qui concerne la recherche fondamentale, il va de soi que ce domaine semble très prolifique et enthousiasmant. La littérature scientifique est en pleine expansion, avec des sujets d’études particulièrement intéressants, concernant la conscience, les émotions, la mémoire, les fonctions attentionnelles, l’intégration perceptive, les processus développementaux, le cerveau social, les neurones miroirs, etc.
Cependant, contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas eu de véritable rupture épistémologique récente. Les sciences cognitives actuelles s’inscrivent effectivement dans la continuité des sciences psychologiques des siècles précédents, certes enrichies de méthodes et de concepts plus originaux ; et surtout de techniques d’investigation plus impressionnantes, qui donnent à penser que l’on peut désormais voir le cerveau en train de fonctionner. Ainsi, les images et cartes cérébrales ont envahi les médias et les représentations collectives, répondant à la conception simpliste qu’un type d’activité cognitive correspondrait à une topographie cérébrale circonscrite.
L’imagerie fonctionnelle fascine, et tend à flatter le fantasme de maîtrise par le visible ; je vois, donc je domine. Cependant, ces études, aussi séduisantes soient-elles, sont finalement très peu reproductibles et l’interprétation des tentatives de cartographie cérébrale peut s’avérer extrêmement complexe, voire décevante. « On aura plusieurs bonnes raisons de ne pas penser que l’image du cerveau du dépressif (…) nous fait « voir » la dépression. (…) L’image, bien loin d’être une source de connaissance, peut même être une source spécifique d’erreur » (Denis Forest, auteur de Neuroscepticisme). Par ailleurs, on oublie souvent que ces images sont réalisées dans des conditions de laboratoire totalement artificielles, incapables de reproduire les conditions de vie réelle des individus et de prendre en compte certaines spécificités. Au contraire, toute singularité est éliminée comme constituant un artefact, du bruit ; il faut donc niveler, réduire, et uniformiser. Évidemment, ces conditions dans l’obtention des « images » seraient à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’extrapoler des résultats. Et c’est là que le bât blesse ; car la généralisation des neurosciences en tant qu’argument d’autorité pour trancher des débats sociaux, économiques, politiques, ou autres, se fait le plus souvent sans la moindre prudence élémentaire.
Pourtant, les neurosciences cognitives ne peuvent avoir une pertinence qu’en articulation avec d’autres champs disciplinaires, susceptibles de qualifier les actes, les pensées ou les enjeux relationnels, de prendre en compte un écosystème humain élargi, et de définir au fond ce qu’on l’on peut comprendre des données extraites en laboratoire. Il faut en effet pouvoir articuler ces résultats bruts avec les conditions extérieures au cerveau qui influencent de façon décisive le fonctionnement cognitif. Ainsi, pour Denis Forest, « l’extension du champ des explications neuroscientifiques dépend pour une part décisive de la fécondité du dialogue des neurosciences avec des disciplines connexes, et non de leur capacité à les éliminer ».
De surcroit, il conviendrait de questionner certains axiomes sous-jacents aux sciences cognitives, lesquelles, en dépit de leur prétention à la neutralité, construisent une conception particulière du fonctionnement psychique humain. En effet, ces approches postulent que la pensée peut se réduire au simple traitement cérébral de l’information, en négligeant les dimensions émotionnelle, corporelle, interactive, sociale, etc., ou en les réduisant à de simples productions de l’activité cérébrale en elle-même. Dans cette perspective, le cerveau ne serait donc qu’une sorte de processeur, intégrant des modules connectés pour produire un signal de sortie à un stimulus perceptif, sensoriel, ou relationnel. Ce type de modélisation peut avoir son intérêt pour aborder certains aspects du fonctionnement cérébral et cognitif, mais parait tout à fait réducteur dès qu’il s’agit de l’extrapoler à la situation d’un être pris dans la complexité d’une situation existentielle réelle.
En termes d’applications concrètes, le discours triomphaliste autour des neurosciences tend à prétendre, depuis plusieurs décennies, que les progrès de ces disciplines vont permettre des évolutions notables quant à la compréhension et au traitement des maladies mentales. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, le bilan est plutôt mitigé, alors même que l’emprise idéologique est massive et que la rhétorique de la promesse continue à infuser dans les esprits. Dans l’imaginaire collectif, la prégnance d’une conception exclusivement neurobiologique des troubles mentaux parait désormais hégémonique, du fait notamment de la diffusion massive du modèle anglo-saxon.
Le fantasme de faire entrer la psychiatrie dans le champ de la médecine biologique reste donc tout à fait dominant, alors même qu’il n’y a aucune véritable avancée concrète dans les pratiques soignantes. François Gonon dénonce ainsi une « bulle spéculative » et rappelle que _« les cibles moléculaires des principales classes de médicaments psychotropes actuellement disponibles ont été définies à partir de médicaments découverts dans les années 1960 ». Par ailleurs, jusqu’à présent, les connaissances neuroscientifiques n’ont jamais permis d’élaborer de nouveaux dispositifs thérapeutiques sur la base d’hypothèses physiopathologiques.
La plupart des traitements pertinents en psychiatrie ont effectivement été découverts de manière fortuite ou à partir d’observations cliniques, sans se baser a priori sur les données extraites des protocoles expérimentaux. Ainsi, les recherches en neurosciences n’ont finalement pas abouti à la création de nouvelles classes de médicaments psychotropes, et les troubles mentaux ne restent définis que par des critères cliniques, sans aucun marqueur spécifique biologique ou d’imagerie. Les prescriptions restent donc très peu spécifiques, se basant uniquement sur des critères d’observation et d’évaluation, cherchant à mettre en évidence des constellations complexes de symptômes. Autant dire que les critères pronostics restent assez aléatoires, et difficilement généralisables… En outre, on ne peut décemment pas revendiquer une amélioration réelle des conditions de prise en charge de patients souffrants de maladies mentales depuis plusieurs décennies, tant sur le plan du soin curatif que de la prévention, en dépit de l’intensité des moyens mobilisés dans les recherches en neuroscience.
En conséquence, ce discours parfois réductionniste et autoritaire, affirmant que la maladie mentale ne pourrait avoir qu’une causalité génétique et neurobiologique, a contribué à mettre de côté les déterminants sociaux de ces troubles, et à empêcher des mesures préventives au niveau collectif. Cependant, les évolutions récentes dans le domaine de la génétique amène de plus en plus à intégrer les effets de l’environnement et les interactions gènes / milieu de vie. L’épigénétique nous conduit effectivement à prendre en considération des facteurs environnementaux susceptibles d’induire des modifications dans l’expression génique. Et dans cette dynamique, l’influence des expériences relationnelles précoces semblent tout à fait déterminantes. François Gonon prend en exemple les facteurs de risque du Trouble Hyperactivité avec Déficit de l’Attention : naissance prématurée, mère adolescente, pauvreté, faible niveau d’éducation des parents. On retrouve là des déterminismes à forte dimension sociale, ce qui explique notamment la prévalence plus élevée de ce type de troubles dans des sociétés plus inégalitaires et induisant davantage de précarité. De façon très pragmatique, il faudrait alors donner la priorité, en termes de programmes de santé publique, à des politiques garantissant un niveau de vie décent à l’ensemble de la population, plutôt qu’à des campagnes de prescription massive de psychotropes à des enfants en plein développement….
Toute recherche sérieuse d’un point de vue épistémologique devrait donc prendre en compte les dimensions socio-économiques, les enjeux relationnels et affectif, le contexte concret de vie, etc. Or, c’est justement ce que les protocoles de recherche cherchent à éliminer de façon systématique. Si l’on néglige cette occultation, on peut en arriver à affirmer que tous les problèmes développementaux ou d’apprentissage des enfants sont déterminés par une causalité strictement génétique et neurologique, sans prendre en compte les dimensions sociales, émotionnelles, familiales, etc… La conséquence d’un tel discours, non fondé scientifiquement, est de « dépolitiser » certains enjeux sanitaires, à travers une forme de médicalisation forcée. Dès lors, les inégalités, les situations d’échec, etc., ne sont plus appréhendées comme résultants en partie de facteurs sociaux, mais uniquement comme la conséquence d’un handicap neurobiologique, à forte composante génétique.
Finalement, cet usage des neurosciences ne contribue pas à proposer des stratégies novatrices, car il tend à entretenir certains stéréotypes éculés, et fonctionne surtout comme « une mécanique de preuve pour des solutions préexistantes » (Stanislas Morel), avec un double discours très efficace. D’un côté, il s’agit de proposer des méthodes universellement applicables, à moyens constants, indépendamment du contexte, comme par exemple certains programmes d’apprentissage de la lecture, censés être plus efficaces pour la totalité des élèves, car basés sur des preuves statistiques et des évaluations d’experts. De l’autre côté, il s’agit de promouvoir une individualisation médicalisée des réponses face aux difficultés spécifiques des élèves, en considérant que les troubles des apprentissages ne sont que l’expression d’un trouble cognitif isolé, à étiologie neurodéveloppementale, sans lien avec l’environnement au sens large.
Au fond, ce type de discours neuroscientifique parait très en phase avec le pilotage de politiques via des indicateurs de performance, mené par des technocrates empreints d’idéologie managériale néo-libérale. « Selon eux, la vraie expertise doit être scientifique et externe, en surplomb. C’est ici qu’on retrouve le courant de « l’evidence based education » (« l’éducation fondée sur la preuve »), issu du monde anglo-saxon, qui prétend pouvoir identifier les « bonnes pratiques » des enseignants à partir de comparaisons observées statistiquement, sans entrer dans une compréhension fine des mécanismes cognitifs et didactiques mettant professeurs et élèves en jeu. » (Philippe Champy). La nomination de Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste, à la tête du Conseil Scientifique de l’Education Nationale, témoigne par exemple d’un véritable changement de paradigme, voire d’une forme d’OPA des neurosciences sur la pédagogie. Pour ce chercheur, enseigner est une science : « Je pense qu’un bon enseignant est un enseignant qui a un bon modèle mental du cerveau des enfants, précisait-il en introduction de sa conférence « Les grands principes de l’apprentissage », tenue en 2012. Nous devons essayer de réfléchir ensemble aux connaissances qui sont indispensables pour qu’un enseignant puisse concevoir le programme éducatif dans un contexte qui va maximiser les modifications mentales, cérébrales, et maximiser la vitesse aussi, la quantité d’apprentissage qu’un enfant peut avoir. »
Outre les questions méthodologiques que de telles affirmations peuvent susciter, il semble essentiel de décrypter également le sens latent de ce genre de revendication. La finalité de la pédagogie scolaire est-elle uniquement de « maximiser » les performances ? De favoriser un traitement automatique, fluide et opérationnel de tâches répétitives, sous-tendu par une optimisation de ses réseaux et connectivités cérébrales ?
Les recherches dans le domaine des neurosciences sont tout à fait passionnantes, et elles mobilisent beaucoup de fantasmes. En tant que pédopsychiatre, il me parait en tout cas essentiel d’être informé des évolutions dans ce champ disciplinaire, au-delà de l’intérêt personnel que je peux y trouver. Cependant, lorsque je m’interroge sur les applications que ces connaissances peuvent voir dans ma pratique clinique, le constat parait finalement très mitigé.
Déjà, beaucoup de recherches viennent finalement démontrer de façon expérimentale des faits empiriques connus de très longue date par les cliniciens. C’est plutôt confortant, mais cela ne fait pas vraiment avancer les choses…
Par ailleurs, au-delà des connaissances scientifiques à proprement parler, les avancées en neurosciences n’amènent pas vraiment à l’émergence d’interventions thérapeutiques inédites. Au mieux, elles valident telle ou telle approche préexistante, sans être dans la capacité de proposer des modalités de soin originales. Il est effectivement important de pouvoir évaluer et confirmer nos pratiques, mais cela ne doit pas entraver la nécessaire créativité clinique et thérapeutique.
Face à un enfant, on a beau connaitre de façon théorique le fonctionnement de son cerveau, ce n’est pas ce qui guidera notre interaction avec lui. Il y a des savoir-faire incorporés qui se construisent dans la pratique, et qui ne peuvent pas simplement découler d’éruditions abstraites. Le sens clinique, l’empathie, les régulations fines de l’interaction, l’interprétation des comportements, la prise en compte des mouvements émotionnels mobilisés, etc. ne peuvent se déployer que dans une situation d’ouverture, impliquant notre sensibilité, nos éprouvés actuels et notre expérience sédimentée ; notre présence charnelle et nos intuitions narratives.
Dans l’après-coup, on pourra éventuellement mobiliser des schémas de compréhension impliquant des modèles cognitifs ou des hypothèses neurobiologiques. Mais cela ne sera qu’un élément parmi d’autres, ayant évidemment une pertinence non négligeable pour proposer des axes thérapeutiques, tout en devant s’articuler avec d’autres types de théorisations et d’approches. C’est la moindre des choses si l’on veut, un tant soit peu, s’approcher de la complexité du vécu d’un enfant, et si on veut pouvoir, d’une façon ou d’une autre, l’aider. Soigner est un processus instable, laborieux, non-linéaire… Il nécessite du temps, du doute, et de multiples sources vives. Penser que des protocoles infaillibles, ou des molécules miraculeuses pourront suffire constitue en soi une résignation, d’autant plus qu’il s’agit déjà d’un mensonge de gestionnaires ou de charlatans. La vulnérabilité et l’espoir se logent certes dans les méandres de nos réseaux neuronaux, mais ne peuvent devenir des puissances régénératrices que dans l’accueil d’un autre…
On peut par ailleurs se questionner davantage encore quand il s’agit d’appliquer la méthodologie des neurosciences dans le domaine de l’enfance.
Par exemple, l’imagerie cérébrale dispose certes d’une bonne résolution spatiale, mais parait tout à fait incapable d’intégrer des processus dynamiques sur de très petites échelles de temps ou sur des durées plus étendues. Or, le fonctionnement cérébral de l’enfant est caractérisé de façon déterminante par sa dimension développementale. Et il s’agit là d’un développement non linéaire, plastique, avec une hétérochronie essentielle dans les domaines cérébraux en déploiement (c’est-à-dire des hétérogénéités temporelles dans la structuration des réseaux neuronaux), des stagnations et des réorganisations permanentes, des effets de seuil, de croissance et d’élagage, des phénomènes de vicariance (c’est-à-dire de substitution d’une fonction ou d’un processus par un autre)… Ainsi, on s’oriente désormais vers un modèle de développement probabiliste et trifactoriel, intégrant à la fois les déterminismes génétiques, les contraintes propres au fonctionnement cérébral, mais surtout la dynamique expérientielle, c’est-à-dire les effets de rencontre, les expériences relationnelles et affectives, etc.
Car ce qui fait la grandeur et la misère de notre humanité est sa condition fondamentalement néotène. De façon simplifiée, cela signifie que le petit d’homme nait inachevé, immature, et complètement dépendant de son environnement d’accueil. Son développement cérébral va alors se poursuivre sur une très longue période en s’étayant sur ses expériences et sur ce qui va s’imprimer en lui du dehors. Le langage, la culture, les schémas cognitifs, les éprouvés corporels et émotionnels… ; tout va prendre forme dans une interaction permanente entre les phénomènes neurodéveloppementaux et le contexte social au sens large. C’est la raison pour laquelle les expériences précoces laissent une empreinte indélébile sur l’organisation du cerveau. Et c’est pourquoi les processus cognitifs les plus élaborés sont toujours la résultante d’interférences extrêmement complexes voire aléatoires entre les déterminismes biologiques et l’imprégnation au sein d’un milieu singulier. Voilà pourquoi nous sommes avant tout des êtres sociaux. La parole, les usages culturels, les enjeux relationnels et affectifs sont profondément inscrits dans nos réseaux neuronaux, et orientent de façon décisive nos perceptions et nos représentations ultérieures. Pour le meilleur et pour le pire…
Voilà aussi pourquoi l’enfance est un domaine tellement complexe et irréductible à des simplifications réductionnistes. En effet, le cerveau d’un enfant constitue déjà nécessairement une forme de reflet, parfois très déformé et transformé, de ses constellations interactives spécifiques, de toutes les expériences relationnelles intériorisées. Dans le même temps, le tempérament propre d’un enfant contribuera aussi à orienter la façon dont les autres investiront le lien avec lui. Ainsi, peuvent se mettre en place des boucles, des schémas répétitifs, sans qu’il soit possible d’en définir l’origine. Cette part inaliénable d’incertitude quant aux causes ouvre finalement un espace de liberté, car elle autorise la possibilité de se raconter, sans cesse, au-delà des destinées biographique ou génétique. Cette part d’ombre peut alors devenir le vecteur des fantasmes, des récits et des rêves…
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de février 2025

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de décembre 2024

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition d’octobre 2024








