5 experts décryptent la loi travail
Les ordonnances sur le travail portent un coup très rude aux protections des salariés et ouvrent une période d’instabilité juridique inédite.
dans l’hebdo N° 1468 Acheter ce numéro

Plus qu’une « loi travail », les ordonnances présentées le 31 août par le Premier ministre, Édouard Philippe, dessinent en réalité trois réformes systémiques : une refonte du syndicalisme ; une modification en profondeur du droit du licenciement et de la justice prud’homale ; et une rupture historique dans la manière dont sont négociées les règles encadrant le travail. Cette attaque coordonnée renforce considérablement les pouvoirs du chef d’entreprise, qui pourra imaginer ses propres règles et les soumettre à ses salariés dans le huis clos des négociations d’entreprise. Tant pis si l’écart entre les droits théoriques des salariés et leur application effective est déjà considérable aujourd’hui, faute de contre-pouvoirs suffisants pour encadrer l’autorité patronale. Emmanuel Macron veut aller beaucoup plus loin dans la contre-révolution libérale, inspirée par des préceptes vieux comme le Medef. La santé, l’équité, le bien-être et le sens du travail réel sont des préoccupations subalternes, des « externalités », qui ne doivent pas entraver la bonne marche économique des entreprises. Les experts que nous avons sollicités, quel que soit leur domaine de compétence, ne cachent pas leur consternation.
Décryptage
La hiérarchie du Code du travail bouleversée
Hormis 11 thèmes listés dans les ordonnances, toutes les règles deviennent par défaut dérogeables à l’échelle de l’entreprise, par accord collectif. Le 13e mois, le montant de bonification des heures de nuit et toutes les règles nouvelles qu’il faudra imaginer à l’avenir – par exemple avec les évolutions technologiques – seront donc négociées à l’échelle de l’entreprise. L’entourage du ministre reconnaît lui-même que l’impact de cette réforme est, pour l’heure, impossible à quantifier. « Nous allons le découvrir au fur et à mesure que les entreprises vont redécouvrir leur marge de manœuvre et de liberté », lâche un collaborateur de Muriel Pénicaud [1]. Elle ouvre surtout une ère d’instabilité juridique.
Josepha Dirringer Juriste
Les ordonnances suivent une tendance forte de ces dernières années à se livrer au bidouillage législatif. Le Législateur ne cherche pas à ce que la règle de droit soit effective, mais à ce qu’elle soit efficace économiquement. Il ajuste la loi croyant vainement en finir de cette manière avec le chômage. Il remodifie des textes déjà modifiés deux ou trois fois durant le dernier quinquennat. Le résultat ? Un millefeuille législatif indigeste qui crée de l’insécurité juridique et un effritement des droits sociaux. Car chaque nouvelle loi fait naître des conflits d’interprétation, qui sont source de contentieux. Dans ces conditions, comment établir des relations de travail sereines ?
Premier exemple, concernant l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Une nouvelle formule apparaît : il faut que la convention d’entreprise « assure des garanties au moins équivalentes » aux accords de branche, dans les 11 thèmes sur lesquels la branche professionnelle reste prioritaire. C’en est fini du principe de faveur selon lequel les accords d’entreprise peuvent être « plus favorables » aux salariés que les accords de branche. Nous avions plus de quarante ans de recul et de jurisprudence pour savoir comment appliquer ce principe fondamental du droit du travail. Demain, qui va définir si l’accord d’entreprise contient des garanties « au moins équivalentes » à celles de l’accord de branche ? Qui dira si avoir une prime ou un jour de congé est une garantie équivalente ? Nous pouvons déjà parier : nous aurons des litiges et les salariés perdront des avantages.
Autre exemple, l’article 3 de la première ordonnance unifie tous les accords « offensifs », ou « de compétitivité » et permet leur adoption en cas de « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » [alors qu’ils étaient réservés aux entreprises en difficultés économiques, NDLR]. Tout accord d’entreprise peut en réalité prétendre avoir été conclu pour satisfaire ces « nécessités ». Rien alors ne protégera plus le travailleur subordonné contre l’arbitraire patronal, car nul, si ce n’est l’employeur, ne peut dire ce qui est rendu nécessaire pour le fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, l’article 4 instaure une prescription de deux mois pour contester la validité des accords collectifs. C’est proprement délirant. Par comparaison, le Code civil prévoit un délai de 5 ans pour demander la nullité d’un contrat ! Passé 2 mois donc, l’accord sera présumé valide même s’il est contraire à l’ordre public ou aux droits fondamentaux, avec des clauses discriminatoires ou attentatoires au droit à la santé, par exemple. Dans un État de droit, on ne peut l’admettre même au nom de la lutte contre le chômage. Nous arrivons avec cet article à un niveau d’effritement du droit du travail extrêmement préoccupant. En réalité, du droit dans son ensemble. Je ne vois pas, d’ailleurs, comment cet article pourra passer sans réserve du Conseil constitutionnel.
Les licenciements facilités
De nombreuses mesures visent à rendre les licenciements plus faciles. Et avec la généralisation du « contrat de chantier » à toutes les branches professionnelles qui le décideront, par accord collectif, les salariés pourront être renvoyés dès que leur mission touchera à son terme. Tout cela pour lever la prétendue « peur d’embaucher », qui bloquerait les chefs d’entreprise. Une idée pourtant battue en brèche par bien des économistes.
Anne Eydoux Économiste, membre des Économistes atterrés
« Derrière l’idée que faciliter les licenciements favoriserait l’embauche, il y a un modèle théorique, dit « insiders-outsiders ». Formulé en 1988 par deux économistes américains, Assar Lindbeck et Dennis Snower, ce modèle impute le chômage et la précarité aux comportements des salariés stables, les « insiders ». Ces derniers auraient obtenu, par l’intermédiaire de leurs syndicats, des protections exorbitantes qui empêcheraient les employeurs de les licencier ou d’embaucher de nouveaux salariés. Pour favoriser l’embauche des outsiders (les chômeurs et les précaires), il faudrait donc inverser le rapport de force, et permettre aux employeurs de licencier plus facilement.
Le raisonnement et les termes de ce modèle théorique sont repris tant par les économistes néolibéraux que par des hommes et des femmes politiques – dont le Président, Emmanuel Macron – pour justifier des réformes. Le modèle est pourtant aux antipodes de la réalité des rapports de force. En France, la montée du chômage depuis la fin des années 1970 a mis les syndicats en position de faiblesse dans les négociations. Cela fait plus de trente ans que sont adoptées des réformes néolibérales du marché du travail, souvent pour satisfaire des demandes patronales portées par le Medef. Ces réformes ont, entre autres, favorisé le développement des emplois temporaires et étendu les possibilités de rupture du contrat de travail.
Aujourd’hui, l’emploi est flexible en France. Le taux d’emplois temporaires (CDD, etc.) y est supérieur à la moyenne européenne, et les employeurs ont à leur disposition de nombreux outils pour rompre un contrat de travail. Une étude publiée par l’Insee montre que seulement la moitié des employeurs déclarent faire face à des freins à l’embauche. Et les freins qu’ils citent sont d’abord l’incertitude économique (le fameux carnet de commandes) et la difficulté à trouver les compétences souhaitées, plus rarement les difficultés à licencier.
Les réformes pour flexibiliser les contrats de travail et faciliter leur rupture ont souvent été engagées au nom de la lutte contre le chômage, pour permettre, comme on dit, aux outsiders (jeunes non qualifiés, etc.) de trouver un emploi. Mais on sait aujourd’hui qu’elles n’ont pas fait montre d’efficacité dans la lutte contre le chômage. En revanche, en favorisant le développement des emplois de courte durée et en facilitant la rupture des contrats de travail à l’initiative des employeurs, elles ont accru la précarité de l’emploi.
Même l’OCDE, qui dès les années 1990 a encouragé ces réformes en disant que la législation protectrice de l’emploi créait des « rigidités » et engendrait du chômage, n’a jamais pu prouver leur efficacité. Dès 2004, ses travaux soulignaient au contraire qu’il n’était pas possible de démontrer que ces réformes avaient une quelconque efficacité contre le chômage. Leurs conclusions n’ont pas varié.
On sait même aujourd’hui qu’en détériorant la qualité de l’emploi ces réformes dégradent la productivité du travail. Et en faisant pression sur les salaires, elles grippent le principal moteur de la croissance européenne. Elles placent les pays d’Europe qui les mettent en œuvre dans une course au moins-disant social dont ils ne peuvent sortir gagnants.
Le syndicalisme encadré
Depuis le 31 août, une formule circule parmi les analystes libéraux, qui ne cachent pas leur joie devant les annonces d’Édouard Philippe et de Muriel Pénicaud : « Cette réforme marque la fin de la lutte des classes [2]_. »_ Seule certitude, les syndicats subissent une attaque sans précédent. Leurs mandats seront limités à 12 ans. Les heures de délégation et le nombre d’élus seront réduits dans le cadre de la future instance unique de représentation du personnel. Des accords pourront être négociés sans eux dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Karel Yon Sociologue
« Les ruptures sont assez impressionnantes en ce qui concerne la place des organisations syndicales. On retrouve des propositions qui viennent satisfaire des revendications très anciennes du Medef. Dans les années 1990, un compromis avait été trouvé entre les organisations syndicales et les employeurs dans les entreprises sans présence syndicale : la mise en place du mandatement. Cela avait pu être un point d’appui pour l’implantation des syndicats. Aujourd’hui, il y a la possibilité de négocier avec des salariés et représentants du personnel non mandatés dans les entreprises de moins de 50 salariés. C’est un contournement très net des organisations syndicales que n’avait pas osé la loi El Khomri.
En ce qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés, un ensemble de mesures diminue le pouvoir des syndicats et les subordonne plus encore à la logique d’entreprise. Je pense évidemment à la fusion des instances représentatives du personnel dans le Comité social et économique (CSE). C’est une revendication historique datant du CNPF, l’ancêtre du Medef – à l’époque du père de Pierre Gattaz. Or s’il existe un comité d’entreprise (CE), des délégués du personnel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), c’est parce que ces instances ont des missions spécifiques. La fusion de ces missions dans une seule instance va créer de la confusion et risque de dissuader les salariés de s’engager, car le rôle d’élu paraîtra plus complexe. D’autant que cette fusion s’opère avec une diminution des heures minimales de délégation garanties aux élus. On passe de 18 à 21 heures par élu dans l’actuelle délégation unique du personnel à 10 ou 16 heures, selon l’effectif de l’entreprise.
Pire, un accord d’entreprise pourra également fusionner délégués syndicaux et CSE dans un conseil d’entreprise qui négociera à la place des syndicats. Cette revendication très ancienne du patronat vise à renforcer chez les salariés le sentiment qu’ils ont plus d’intérêts communs avec leur employeur qu’avec les autres salariés. Certains peuvent dire qu’ils ont sauvé la négociation de branche ; en réalité, avec ce renforcement du corporatisme d’entreprise, les solidarités plus larges sont minées. C’est moins le triomphe du dialogue social que du dumping social.
Il y aura un encadrement accru du recours à l’expertise pour les représentants du personnel, avec l’obligation de leur prise en charge partielle (à hauteur de 20 %) des frais d’expertise. L’argumentaire gouvernemental est donc assez hypocrite : quand on regarde dans les PME, ce n’est pas le dialogue social qui va être promu, mais la restauration du pouvoir absolu de l’employeur face aux salariés – il va, en résumé, leur demander de plébisciter les accords qu’il aura préparés pour eux. Et dans les entreprises plus grandes, là où l’expertise permettait aux représentants des salariés de disposer d’éléments objectifs et de données chiffrées afin de négocier dans de bonnes conditions, les moyens sont rognés.
La notion de « dialogue social » a également remplacé le terme de « négociation collective ». Évoquant un échange d’arguments entre personnes bien élevées autour d’une table, elle nie la violence des relations de travail et disqualifie un aspect essentiel du syndicalisme : la construction de rapports de force par la mobilisation collective des salariés.
Les prud’hommes désarmés
Depuis cinq ans, les prud’hommes ne sont pas sortis indemnes des réformes successives du droit du travail. Mais la dose, cette fois, est particulièrement sévère. Avec le plafonnement des indemnités aux prud’hommes et la réduction de deux à un an du délai de recours pour les salariés licenciés pour motifs personnels, notamment.
Juliane Pinsard Magistrate, membre du Syndicat de la magistrature
« Le plafonnement des dommages et intérêts vient contredire un principe fondamental : la réparation intégrale du préjudice. Le juge ne pourra plus adapter le montant des indemnités à la situation personnelle du salarié et aux conséquences que ce licenciement aura pu avoir sur ses conditions matérielles ou sa situation psychologique. Jusqu’à présent, le barème était facultatif, il servait d’indicateur pour le juge. Si les plafonds sont légèrement plus élevés que cet ancien barème, il s’agissait d’une moyenne et l’on pouvait aller bien au-delà selon la situation personnelle de l’individu. L’argument du gouvernement consiste à dire que le plafonnement évite l’inégalité entre les salariés. Sauf que vous ne trouverez jamais deux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse dans une situation identique. Aujourd’hui, les dommages et intérêts sont différents d’un endroit à un autre, car la situation est différente d’un individu à un autre. De plus, le plafond permet à l’employeur de savoir à l’avance le coût d’un licenciement illégal. Il peut alors le provisionner sur plusieurs mois : il achète un licenciement illégal. Cela ôte toute responsabilité à l’employeur en matière de licenciement.
On le voit d’autant plus lorsque la ministre du Travail indique que « le vice de forme ne l’emportera plus sur le fond » aux prud’hommes. Normalement, le motif de licenciement doit être écrit dans la lettre de licenciement, il fixe le cadre du litige s’il y a une procédure. Là, l’employeur pourra modifier ce motif selon les arguments que lui aura apportés le salarié, c’est particulièrement déloyal. La forme, ce n’est pas pour embêter les gens : la procédure, c’est que qui garantit le fond. Sans procédure et sans règles de forme, on tombe dans l’arbitraire. La souplesse et la simplification des procédures formelles sont en faveur des employeurs au détriment des salariés. S’il y a des vices de forme, avant cela donnait lieu à des dommages et intérêts distincts. Là, tous ces vices de forme sont intégrés dans le préjudice global. S’il est possible de les cumuler, dans la limite du plafond, le juge doit en outre tenir compte de l’indemnité de licenciement versée par l’employeur lorsqu’il fixe les dommages et intérêts versés en réparation du préjudice, afin de les moduler.
Ces textes s’inscrivent dans un processus long qui vise à dissuader les salariés de faire un recours devant les prud’hommes : par exemple, dans l’ancienne loi travail, on a renforcé le formalisme pour saisir les prud’hommes, on doit dorénavant télécharger un formulaire alors qu’avant une déclaration orale au greffe suffisait. Toutes ces petites choses limitent le recours, et limiter le délai, cela va réduire le nombre de recours. On sait que les prud’hommes ont des délais de jugement très longs, les cours d’appel sont surchargées et l’on doit parfois attendre deux, voire trois ans pour une décision. Leur solution, ce n’est pas de diminuer le temps de la procédure, mais de diminuer le nombre de recours. Un an de délai, c’est peu pour un recours : lorsque vous êtes licencié, vous ne pensez pas directement à faire un recours. Ces textes vont à l’encontre des fondements d’un droit destiné originellement à tenter de rétablir un équilibre dans une relation de travail par essence inégale.
Les salariés sans recours ni pouvoir de négociation
Les verrous et les contre-pouvoirs dont disposent les salariés pour faire valoir leurs droits dans leur face-à-face avec l’employeur sont affaiblis, un par un, avec un objectif : faciliter l’adoption des accords d’entreprise qui tirent vers le bas les conditions de travail et de salaire. Référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur, prescription ramenée à deux mois pour les recours contre les accords collectifs, licenciement sans possibilités de recours des salariés qui refusent de signer… En somme, les principaux motifs actuels de contentieux en justice sont rendus inopérants.
Judith Krivine Avocate en droit social, membre du Syndicat des avocats de France
« Les ordonnances sont dans la droite ligne de ce qui a été fait depuis le quinquennat précédent. En allant beaucoup plus loin. Elles privent les salariés de leurs principaux leviers de négociation. D’une part, il va devenir extrêmement difficile de contester la légalité des accords collectifs, car ils seront présumés légaux. C’est au demandeur de prouver qu’il y a une disposition illégale. D’autre part, ils seront désormais prescrits au bout de deux mois. Or, 9 fois sur 10, c’est lors de l’application de l’accord dans le temps qu’on s’aperçoit qu’il y a un problème sur telle ou telle clause. C’est d’autant plus grave que, désormais, les signataires pourront être des salariés ne disposant d’aucun accompagnement syndical ou juridique. L’accord, qui souvent pourra primer le contrat de travail, sera rédigé par l’employeur, et lorsque les salariés s’apercevront qu’il est contraire à la loi, il sera trop tard pour le contester. Un autre élément grave, c’est d’apprécier le motif économique du licenciement dans le secteur d’activité, au niveau national. Les grands groupes vont s’en donner à cœur joie, lorsqu’une filiale française est moins rentable – même si ses bénéfices sont « remontés » dans une autre filiale située dans un pays fiscalement plus intéressant.
Par ailleurs, le plafonnement des indemnités aux prud’hommes rendra souvent les recours inintéressants pour les salariés en cas de licenciement. Les recours deviennent donc soit impossibles, soit inutiles.
Au sein même de l’entreprise, la fusion des instances représentatives du personnel privera les salariés d’une partie de leurs droits et de leurs moyens. Notamment parce que plusieurs expertises devront être financées à 20 % par le nouveau « Conseil social et économique ». Cela signifie qu’un CSE devra faire des choix, entre solliciter le travail d’un expert économique, d’un expert santé-sécurité-conditions de travail ou d’un avocat. Or nous avons besoin des uns des autres pour travailler correctement sur les dossiers, et les chefs d’entreprise, eux, ne se gênent pas pour faire appel à de nombreux experts.
Par ailleurs, alors que le budget de fonctionnement et les activités sociales du CE [comme les chèques-vacances et les billets de cinéma, par exemple, NDLR] étaient séparés depuis toujours, les ordonnances prévoient qu’on puisse utiliser l’un pour financer les autres. Les élus, pour des raisons électorales par exemple, pourraient privilégier les activités sociales sur le fonctionnement du CSE (expertises, avocats, etc.). Toute la démarche vise en définitive à étouffer financièrement les instances représentatives du personnel.
Ce que nous craignons, c’est que lorsque les salariés comprendront qu’ils n’ont plus de droits ni de possibilités de recours judiciaire, ce soit la violence qui vienne régir les litiges.
[1] À lire sur Politis.fr : « Accords d’entreprise : le gouvernement ignore la portée de sa propre réforme ».
[2] Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation&Arguments, BFM Business, 4 septembre.
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes

« Pour battre l’extrême droite, le réalisme, c’est encore et toujours se battre pour l’union »
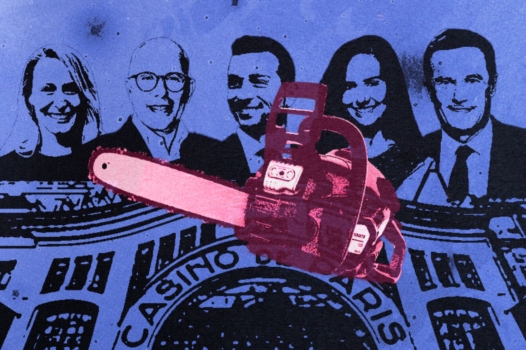
Immigration, wokisme, dépenses publiques… Les obsessions de l’extrême droite au Sommet des libertés







