« L’abstention est le fait de mécanismes sociologiques »
Pour Antoine Jardin, spécialiste des quartiers populaires, aller chercher les classes populaires éloignées du vote est une gageure.
dans l’hebdo N° 1474 Acheter ce numéro
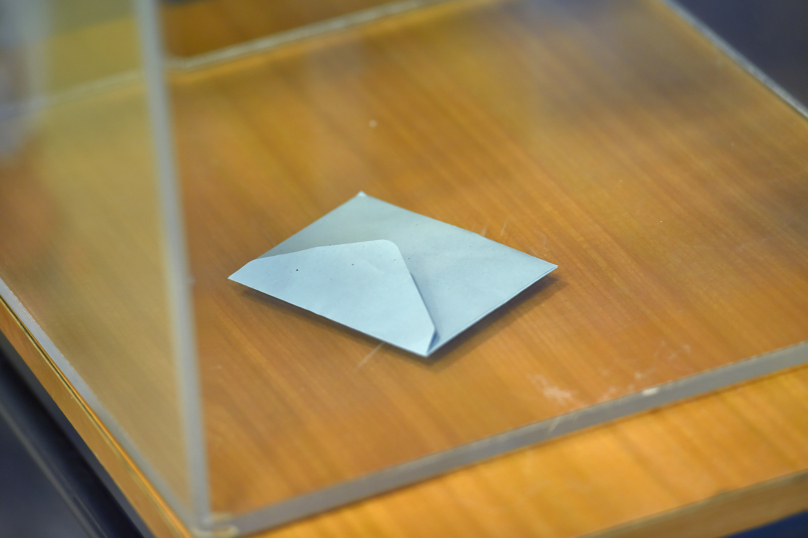
Alors que le vote populaire était orienté à gauche jusque dans les années 1960-1970, il s’est depuis banalisé. En cause, la diversification des profils au sein des classes populaires, le délitement des solidarités et une crise profonde de leur représentation par un système partisan à bout de souffle.
Qui sont les « classes populaires » aujourd’hui ?
Antoine Jardin : Ce qu’on appelle « classe populaire » est un ensemble très hétéroclite. Depuis le choc pétrolier de 1973, des mondes populaires divers se sont développés en dehors du monde ouvrier « traditionnel » : on y trouve pêle-mêle des employés peu qualifiés du secteur des services (par exemple, dans les entreprises de nettoyage), mais aussi des personnes sans emploi ou qui ne sont pas à la recherche d’un emploi… Et d’ailleurs, au sein même du monde ouvrier traditionnel, il y a des différences importantes : ce n’est pas la même chose d’être manœuvre ou ouvrier de l’imprimerie.
Qu’est-ce qui vous autorise à mettre tous ces mondes dans une même galaxie dénommée « classe populaire » ?
Leur grande caractéristique commune, c’est d’être dans une position d’infériorité par rapport au contrôle des ressources essentielles – ressources financières (ce que l’Insee appelle les dépenses arbitrables), accès au logement, à la santé, aux niveaux d’éducation les plus élevés… Autre point commun : tous ces individus sont dans une marginalisation économique durable et qui se transmet la plupart du temps d’une génération à l’autre. Je pense par exemple à ces descendants de famille ouvrière qui peuvent changer de type de travail mais se trouver eux-mêmes employés dans des conditions précaires.
Quelle différence faites-vous avec les petites classes moyennes, et notamment les « déclassés » ?
La notion de classe moyenne est très compliquée à appréhender. Et d’ailleurs, les conditions de vie de la classe moyenne sont en réalité beaucoup moins confortables que ce qu’on imagine : la famille propriétaire d’un pavillon et de deux voitures n’est pas représentative de la classe moyenne « moyenne », mais de sa frange supérieure. Certes, depuis la crise de 2008, les épisodes de précarité touchent et fragilisent de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires qualifiées. Les inégalités à l’intérieur des différents groupes sociaux (parmi les cadres, parmi les ouvriers) ont augmenté. Néanmoins, toutes les trajectoires à mobilité descendante ne vous amènent pas dans les milieux populaires. Ne serait-ce que parce qu’on peut avoir peu de revenu, mais un patrimoine important.
Le vote populaire a-t-il toujours été majoritairement de gauche ?
Jusqu’au milieu des années 1960-1970, le vote ouvrier était plus orienté à gauche que les autres : environ deux tiers des ouvriers votaient pour des partis de gauche – ce qui laisse quand même un tiers d’ouvriers qui leur préféraient un vote gaulliste ou catholique. Ensuite, peu à peu, on a observé une banalisation de ce vote : aujourd’hui, les ouvriers votent ni plus ni moins à gauche que les autres groupes sociaux. Cette banalisation est d’abord due à la tertiarisation de l’emploi ouvrier, qui a fracturé les collectifs de travail – quand on est en contact avec des clients, qu’on est chauffeur, ou livreur, ou à temps partiel, on n’est plus ensemble derrière la machine… Ensuite, la diversification des profils au sein des classes populaires fait que toutes ses composantes ne se reconnaissent pas dans les formes anciennes de la solidarité du monde ouvrier, et qu’elles n’ont donc pas les mêmes réflexes politiques.
Que voulez-vous dire ?
On constate qu’il y a un ancien monde ouvrier qui reste structuré politiquement par un vote ancré à gauche. Mais il y a aussi, dans les « nouveaux » mondes populaires, et notamment chez les jeunes, un ancrage du vote d’extrême droite depuis le milieu des années 1990, qui est alimenté par le rejet de l’immigration. Cela s’explique : ces jeunes ouvriers n’ont pas connu les collectifs de travail et les solidarités qu’ont connus leurs parents ; d’autre part, ils ont grandi avec un FN toujours très haut, et qui donc, est apparu comme une offre politique légitime. Ce sont donc les nouvelles générations ouvrières, qui n’ont jamais développé de lien particulier avec la gauche, qui se reconnaissent aujourd’hui dans le vote FN. Mais, contrairement à ce que la communication du FN proclame, le vote FN est largement moindre que l’abstention et le non-vote – dû notamment à une mauvaise inscription sur les listes électorales. Le sociologue Patrick Lehingue [1] a ainsi montré que, dans le nord de la France, aux dernières régionales [où le score du FN a été historiquement haut, NDLR], seul 1 ouvrier inscrit sur 6 avait voté FN, et pratiquement 4 ouvriers sur 7 n’avaient pas voté du tout.
Lors de sa dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a dit vouloir aller chercher ces abstentionnistes, voire ces nouvelles générations d’ouvriers séduits par le discours FN. A-t-il réussi ?
Cette mise en scène de la lutte front contre front n’est pas nouvelle : déjà en 2012, Mélenchon était allé affronter Marine Le Pen à Hénin-Beaumont aux législatives. Or c’est intéressant parce que cela ne « colle » pas du tout avec la construction historique du Parti de gauche (PG) et du noyau dur de la France insoumise. Quand Mélenchon a quitté le PS, en 2009, il a entraîné dans son sillage des gens issus des classes moyennes et moyennes supérieures, du secteur public, très à gauche, qui avaient un fort capital scolaire et qui pouvaient discuter pendant des heures de la politique de la Banque centrale européenne. De la même manière, la proportion des ouvriers chez les candidats de la France insoumise aux dernières législatives n’a été que de 1,2 % – à titre de comparaison, il y a environ 11 % de candidats ouvriers à Lutte ouvrière et au NPA, qui sont les seuls groupes politiques d’envergure nationale où demeure une présence ouvrière forte. Cela n’a rien d’étonnant car la question de la participation au pouvoir institutionnel des représentants des classes populaires a longtemps fait débat – au début du XXe siècle encore, la SFIO se demande s’il faut participer, ou non, au pouvoir.
Cette histoire a pesé sur l’histoire du rapport des classes populaires à la participation politique et les a conduites à rester longtemps à la marge des institutions politiques. Aujourd’hui, les succès électoraux de la France insoumise ne sont a priori pas de nature à démocratiser leur accès à ces groupes sociaux peu représentés.
L’électorat de la France insoumise est-il davantage le reflet de la classe ouvrière ?
Venant majoritairement des classes supérieures, le mouvement a du mal à être en phase avec l’électorat populaire, c’est pourquoi, pour l’instant, il n’y a pas de transformation structurelle de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et, d’ailleurs, on a vu que très peu d’électeurs sont passés du FN à la France insoumise pendant la présidentielle. On ne peut pas dire que la France insoumise a capté les suffrages des électeurs du FN parmi les classes populaires ni que celles-ci aient fait une entrée particulièrement forte dans le jeu politique. Malgré la volonté de Mélenchon, aller chercher le vote populaire est toujours plus facile à dire qu’à faire, même en adoptant les thèses du « populisme de gauche » chères à Chantal Mouffe. En vérité, la France insoumise a plutôt intérêt à continuer à aller grappiller des morceaux de l’électorat socialiste : c’est là qu’elle a une marge de progression, davantage que chez les abstentionnistes « systématiques », qui sont éloignés durablement du comportement de vote.
Pourquoi est-il si difficile de les mobiliser ?
C’est une question ancienne : y a-t-il une crise du sentiment civique dans les classes populaires ? Les gens sont-ils devenus méfiants ? Ce que la recherche a mis au jour ces quinze dernières années, c’est que le problème est moins à aller chercher chez les électeurs que dans l’absence de cadres de mobilisation. Il n’y a pas de crise de la volonté de participation démocratique des milieux populaires, mais une crise de la représentation par un système partisan à bout de souffle.
C’est-à-dire ?
Contrairement aux idées reçues, l’abstentionnisme des classes populaires n’est en général pas le fait de raisons politiques. Souvent, les gens disent ne pas voter parce qu’ils « les détestent tous », mais en réalité, c’est bien plutôt la marginalisation sociale qui conduit à l’abstention. Le peu de participation associative, le peu de participation syndicale, le peu de participation au monde du travail, le faible contact avec d’autres groupes sociaux du fait d’une faible mobilité géographique… Ce sont ces mécanismes sociologiques lourds qui pèsent le plus dans l’abstentionnisme, pas les questions idéologiques ! Et d’ailleurs, l’abstention n’est qu’une partie du problème : j’ai déjà fait des enquêtes dans des quartiers où 40 % de la population est étrangère et n’a donc pas le droit de vote, et où parmi les 60 % restant, la moitié des gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous voyez bien que la base électorale ne reflète que très partiellement la population totale du quartier !
La France insoumise a lancé l’opération des « caravanes insoumises » pour aider les gens à s’inscrire sur les listes électorales…
Certes, mais c’est une présence en pointillé : peu de sympathisants de la France insoumise habitent véritablement les quartiers populaires. Cela rend dès lors leur mobilisation beaucoup plus difficile. Si vous pensez aux cités HLM de La Courneuve dans les années 1960, la vie sociale était structurée autour des organisations du monde ouvrier et cela conditionnait la façon dont la politique entrait dans la vie des gens. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Alors autour de quoi les quartiers populaires sont-ils aujourd’hui structurés ?
Une des hypothèses, c’est qu’une partie du lien au politique s’est transposée dans une identité sociale à support religieux : l’islam ou le christianisme évangélique pourraient influencer les normes du comportement, les manières de vivre, de manger, de s’habiller, de se marier… Comment une identité sociale fondée sur le religieux pourrait-elle se répercuter sur le système politique français ? La question est largement ouverte. Ce qu’on sait néanmoins, c’est qu’en matière de choix politiques (quand il y en a), le fait d’être musulman ou non va être moins déterminant que d’être descendant d’immigrés, et que, toutes choses égales par ailleurs, cela vous amène plutôt vers la gauche car il y a un vécu de discrimination.
[1] In Les Classes populaires et le FN, éditions du Croquant, 2017.
Antoine Jardin Sociologue au centre d’études européennes de Sciences Po. Il a soutenu en 2014 une thèse sur les dynamiques électorales dans les quartiers populaires, notamment en banlieue parisienne.
À lire aussi dans ce dossier :
• Classes populaires : Le nouveau « graal » de la gauche
Pour aller plus loin…

Pour renflouer les caisses, François Bayrou choisit les poches des Français

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre







