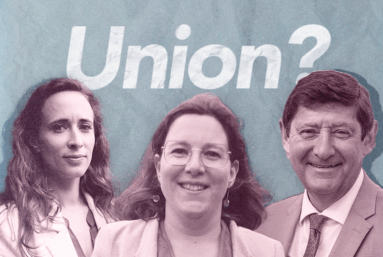Proche-Orient : Contradictions américaines
En quelques jours, l’administration Obama vient de prendre deux décisions importantes : soutenir les rebelles modérés en Syrie et augmenter son aide au régime autoritaire égyptien.
dans l’hebdo N° 1310 Acheter ce numéro

Dans sa récente autobiographie, Hillary Clinton (voir Politis n° 1309) a relaté un dialogue difficile avec Barack Obama à propos d’une aide éventuelle et directe aux rebelles syriens modérés. L’ancienne secrétaire d’État, qui était favorable à cette aide, avouait n’avoir pas réussi à persuader le Président américain. Les arguments ont-ils fait leur chemin, ou bien Barack Obama a-t-il considéré que la nouvelle situation, notamment les avancées des jihadistes de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), nécessitait un changement de stratégie ? Toujours est-il qu’il vient de donner son feu vert à une aide aux rebelles. Mais il aura fallu attendre le pire. Trois ans de guerre civile, plus de 160 000 morts et l’expansion jihadiste en Syrie et en Irak, pour que le Président américain demande au Congrès d’autoriser un budget de 500 millions de dollars pour « entraîner et équiper » l’opposition modérée.
Le soutien américain était jusqu’alors composé d’une aide financière restreinte et d’un programme secret d’entraînement militaire en Jordanie. L’utilisation d’armes chimiques sur la population en août 2013 n’avait pas suffi à convaincre de la nécessité d’une aide ciblée. Il aura fallu pour cela la progression spectaculaire de l’EIIL, qui vient de proclamer un « califat islamique » à l’ouest de la Syrie et à l’est et au nord de l’Irak. La décision américaine doit être replacée dans une perspective plus large. En effet, les 500 millions prévus s’inscrivent dans une « enveloppe » de 1,5 milliard de dollars consacrée à une « Initiative de stabilisation régionale » pour aider l’opposition et les pays voisins (Jordanie, Liban, Turquie, Irak) à faire face aux conséquences du conflit, notamment à l’arrivée massive de réfugiés et la menace terroriste. Cette aide risque d’être faible face à la puissance des groupes jihadistes, dont les deux principaux, EIIL et Al-Nosra, adoubé par Al-Qaïda. Elle risque surtout d’être tardive alors que les rebelles doivent faire face aux coups conjugués d’EEIL et du régime syrien, lequel a jusqu’ici épargné le courant le plus violent des jihadistes. Presque au même moment, les États-Unis viennent de décider d’accroître leur aide à l’Égypte. Décision surprenante alors que le pays bascule dans une dictature pire peut-être que celle de Moubarak. En dépit des atteintes aux droits de l’homme, Washington maintient cyniquement son alliance militaire, et son aide financière. Les États-Unis débloquent 572 millions de dollars et s’apprêtent à livrer dix hélicoptères Apache au moment même où le secrétaire d’État, John Kerry, fait part de son « inquiétude », voire de son « effroi », devant le bilan des droits de l’homme en Égypte. Les États-Unis, qui n’ont jamais accepté de caractériser la destitution du Président élu Mohamed Morsi par le général al-Sissi comme un coup d’État, s’inquiètent d’autant plus que la répression ne se limite plus aux Frères musulmans condamnés à mort par centaines. Trois journalistes d’Al-Jazeera viennent ainsi d’écoper de peines de sept à dix ans de prison, tout comme vingt-quatre jeunes militants progressistes arrêtés pour avoir manifesté contre une loi restreignant ce droit fondamental. L’inquiétude de Washington ne va pas en tout cas jusqu’à remettre en cause l’aide apportée à une dictature.
Autre incohérence américaine, le soutien apporté au gouvernement irakien du Premier ministre chiite al-Maliki. Celui-ci est pourtant tenu pour largement responsable, par sa politique sectaire à l’égard des sunnites, de l’audience rencontrée par les jihadistes au sein de cette communauté. Une solution politique passe sans aucun doute par la mise à l’écart de ce personnage désormais encombrant pour tout le monde. Au total, s’il faut chercher une cohérence à la politique américaine dans cette région du monde, c’est sans doute encore et toujours la gestion des intérêts d’Israël. L’État hébreu est évidemment très satisfait de la répression qui s’abat sur les Frères musulmans égyptiens, alliés naturels du Hamas, et sur la reprise en main du pays par un nouveau dictateur. L’intérêt israélien est plus difficile à cerner dans le chaos syrien. Les États-Unis et Israël se sont longtemps accommodés du clan Assad. Puis, ils l’ont « lâché » quand les premières abominations ont été connues. Les motivations de l’aide américaine aux rebelles ont finalement peut-être plus à voir avec la situation irakienne. Il s’agit moins d’aider les rebelles contre Bachar al-Assad que contre EEIL, qui menace le régime irakien. C’est peut-être le calcul que l’on fait à Washington.
Pour aller plus loin…

Au Chili, un espoir pour la gauche

Contre la guerre, aux États-Unis : « Nous ne voulons plus de morts, plus de victimes »
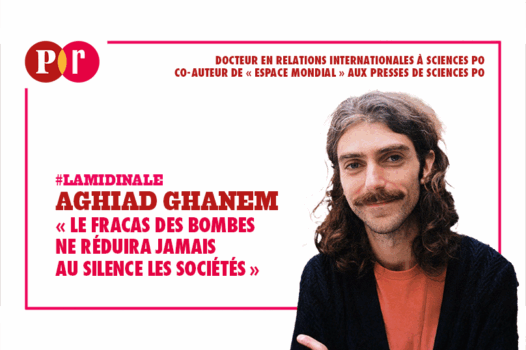
« Le fracas des bombes ne réduira jamais au silence les sociétés »