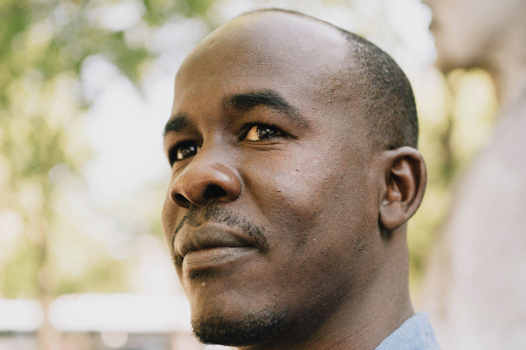« Les politiques pénales utilisent la criminalité pour justifier leur existence »
En remettant en lumière des textes fondateurs sur l’abolitionnisme pénal, Gwenola Ricordeau interroge les concepts de crime, de peine ou même de victime.
dans l’hebdo N° 1654 Acheter ce numéro

© SEBASTIEN BOZON/AFP
Gwenola Ricordeau (1) milite pour l’abolition du système pénal – c’est-à-dire des tribunaux, de la police et de la prison. Avec Crimes et Peines. Penser l’abolitionnisme pénal, elle propose un retour historique sur un mouvement peu visible en publiant trois textes majeurs et inédits en français de la « première vague » abolitionniste : « À qui appartiennent les conflits ? » de Nils Christie, « La Criminologie critique et le concept de crime » de Louk Hulsman et « Deux types de victimes : répondre à leurs besoins » de Ruth Morris – écrits entre 1977 et 1998 et traduits par Lydia Amarouche et Pauline Picot.
Qu’est-ce qui rend nécessaire, selon vous, l’abolition du système pénal ? Et pourquoi ne serait-il pas « réformable » ?
Gwenola Ricordeau : Nous savons que le système pénal crée plus de préjudices qu’il n’en répare et qu’il ne répond pas bien aux différents besoins, notamment ceux des victimes. Par ailleurs, ses coûts sociaux sont exorbitants. Non seulement le système pénal impacte la vie des personnes qui sont judiciarisées, mais il affecte aussi la vie de leurs communautés, sans pour autant garantir la sécurité. On le voit bien avec les violences faites aux femmes. Pourtant, le système pénal entretient l’illusion de son caractère réformable – en dépit de la réalité de ses nombreux effets indésirables, sur lesquels il existe un large consensus. Par exemple, certaines populations sont surreprésentées parmi les personnes criminalisées. Les abolitionnistes considèrent qu’il ne s’agit pas de dysfonctionnements, mais que le système pénal répond en réalité parfaitement à ce qui lui est demandé : garantir le fonctionnement du système capitaliste, du racisme systémique et du patriarcat.
Vous dites que les textes de la « première vague » abolitionniste que vous présentez se sont heurtés « aux durcissements des politiques pénales » et « au formidable développement de “l’industrie de la punition” ». Il semble pourtant que l’abolitionnisme pénal se soit renouvelé, notamment dans le sillage de l’assassinat de George Floyd (2) ?
Les mobilisations qui ont suivi le meurtre de George Floyd aux États-Unis ont donné une certaine visibilité aux idées et aux luttes abolitionnistes, y compris en France. En réalité, ce mouvement a été précédé par une « seconde vague », qui a permis de renouveler les analyses en incluant davantage les problématiques de genre et de race. Par exemple, il y a eu la création de Critical Resistance au début des années 2000, une organisation abolitionniste cofondée par Angela Davis. Dans les années 1970, les réflexions abolitionnistes étaient surtout formulées par des juristes, des criminologues et des hommes blancs. Mais, à partir des années 2000 aux États-Unis, l’abolitionnisme a été davantage porté par des femmes, des Africaines-Américaines et des militant·es. C’est notamment le cas des mouvements pour l’abolition de la police, qui est l’une des facettes de l’abolitionnisme pénal. À Minneapolis, par exemple, la ville où a été tué George Floyd, le MPD 150 lutte depuis des années pour l’abolition de la police.
Le système pénal répond parfaitement à ce qui lui est demandé : garantir le fonctionnement du système capitaliste, du racisme systémique et du patriarcat.
Certains mouvements abolitionnistes ont adopté une stratégie par étapes qui vise à définancer, à désarmer et à démanteler la police. Par exemple, à Oakland, une coalition de treize organisations constituées de personnes qui appartiennent à des minorités raciales a récemment obtenu une réduction de 50 % du budget alloué aux forces de police.
Pour mieux comprendre les principes de l’abolitionnisme pénal, pouvez-vous nous expliquer ce que fait la peine (de justice) à la société ?
On peut d’abord regarder les effets de la peine au niveau individuel et les fonctions qu’elle est censée remplir. La punition rend-elle une personne meilleure ? Empêche-t-elle la commission de nouvelles infractions ? L’idée même que la peine, la police ou la prison fassent peur est démentie par le fait que des individus commettent des crimes malgré tout. Les effets dissuasifs et rééducatifs de la peine fonctionnent assez mal.
On peut aussi réfléchir aux effets collectifs des peines. Qu’est-ce que ça fait à la société d’enfermer certains individus ? Malgré le principe de l’individualité de la peine, l’incarcération affecte les proches et produit des effets sur les communautés. Si on prend l’exemple de la criminalisation des usages et de la vente de produits stupéfiants, on voit bien que le système pénal judiciarise les jeunes issus de l’immigration, des quartiers populaires et de l’histoire coloniale. Il y a une population particulière qui est affectée par l’existence même du système pénal.
Le texte de Louk Hulsman invite justement à repenser le concept de crime, qui n’aurait pas de « réalité ontologique ». L’abolitionnisme pénal estime également que les crimes les plus graves (destruction de l’environnement, patriarcat, capitalisme, racisme) ont un caractère systémique, mais ne sont pas reconnus comme tels…
Il s’agit, à mon sens, d’un texte extrêmement important pour l’abolitionnisme pénal. Louk Hulsman explique en effet que le crime est une catégorie qui a d’abord le défaut d’être définie par l’État. Or la définition des infractions ne correspond pas toujours aux préjudices vécus et expérimentés par les individus. Faire le lien avec la question des crimes à caractère systémique est intéressant puisqu’en effet ils échappent complètement au système pénal. Avec les infractions pénales, on a donc des catégories qui fonctionnent mal, qui homogénéisent et ne rendent pas compte de l’expérience des individus.
L’idée que la peine, la police ou la prison fassent peur est démentie par le fait que des individus commettent des crimes malgré tout.
Des catégories qui, selon Nils Christie, serviraient « l’industrie de la punition », le « grand danger » de nos sociétés modernes…
Nils Christie soutient en effet que les politiques pénales entretiennent l’illusion qu’elles servent à régler le problème de la criminalité alors qu’en réalité elles utilisent la criminalité pour justifier leur existence. Il n’y a donc pas de vases communicants entre le crime et les politiques pénales.
Selon vous, nous disposons toutes et tous de compétences qui nous permettent de répondre à des « situations-problèmes ». Pour reprendre l’une des questions posées par votre ouvrage, « comment éviter le recours au système pénal » ?
Il faut d’abord réfléchir aux manières dont on règle les conflits avec les personnes qui nous sont chères, car c’est avec elles que nous faisons davantage preuve d’imagination. Les gens ont généralement moins de scrupules à recourir au système pénal si c’est une personne inconnue qui leur a volé leur voiture ou les a agressés. On peut se demander ce qu’on peut faire, comment faire, si on peut solliciter un tiers dans certaines situations, et puis on peut développer des savoir-faire en construisant des communautés et des liens sociaux plus forts qui permettent, entre autres, plus de ressources en cas de conflit ou de préjudice. Dans certains ateliers abolitionnistes, on réfléchit à ça et on prend conscience des ressources dont on dispose et de celles dont on manque, de ce dont on aurait besoin pour ne pas recourir à la police, par exemple. Évidemment, si vous entendez aujourd’hui des violences conjugales dans l’appartement voisin, peut-être que votre seule ressource est d’appeler la police. L’abolitionnisme pénal ne consiste pas à dire « on n’appelle pas la police, point barre », mais de construire des ressources collectives pour éviter de recourir à la police ou au système pénal. Ça ne s’improvise pas au moment de la commission d’un préjudice.
Tout cela se heurte cependant à l’organisation capitaliste de nos modes de vie. Elle rend difficile de trouver du temps pour aller parler à ses voisin·es et réfléchir collectivement à ce que nous ferions en cas de « situations-problèmes », selon l’expression de Louk Hulsman. L’organisation capitaliste fonctionne sur la professionnalisation et l’« expropriation des conflits », comme le dit Nils Christie.
Pour répondre aux besoins des victimes, et pas seulement celles de violences interpersonnelles, il fallait également répondre aux besoins des victimes d’injustices systémiques.
Quand des numéros verts sont mis en place pour signaler des violences contre les femmes, les enfants, etc., ça ne prend que quelques minutes d’y recourir. Alors que construire une communauté, tisser des liens localement pour réfléchir à comment prévenir des violences à caractère sexuel sur des enfants, par exemple, ça prend énormément de temps.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi la professionnalisation du système pénal est un obstacle aux processus de résolution des conflits ?
Dans « À qui appartiennent les conflits ? », Nils Christie fait en effet cette proposition analytique extrêmement forte en disant que le système pénal dépossède les victimes, les auteurs, mais aussi l’ensemble de la société, de la « richesse, des conflits ». Il s’agit d’une expression importante qui envisage les conflits comme des opportunités, alors même que nous sommes encouragé·es à les voir comme des choses néfastes. Évidemment, il ne s’agit pas de nier les préjudices subis par les individus, mais de les considérer comme des biens que l’on ne pourrait pas donner, ni accepter d’en être dépossédés.
En quoi la justice pénale se désintéresse-t-elle des besoins des victimes ?
Ruth Morris a longtemps travaillé sur ce sujet. Elle distingue deux types de victimes : celles d’injustices systémiques et celles de violences interpersonnelles. Dans les deux cas, elle définit cinq besoins : obtenir des réponses à leurs questions, voir leur préjudice reconnu, être en sécurité, pouvoir donner un sens à ce qu’elles ont subi et obtenir réparation. D’après elle, le système pénal ne répond pas à ces besoins. Ruth Morris s’est donc intéressée au développement de la justice restaurative, dont elle était contemporaine. Mais elle en est revenue et a formulé plusieurs critiques. Avec l’idée qu’il fallait dépasser le système pénal, elle a ensuite formalisé les contours de la justice transformative. Elle considérait en effet que, pour répondre aux besoins des victimes, et pas seulement celles de violences interpersonnelles, il fallait également répondre aux besoins des victimes d’injustices systémiques. Et pour elle, la seule façon de faire cela, c’est de transformer les structures sociales, donc la société.
Quelle différence avec la justice restaurative, et pourquoi la justice transformative vous paraît-elle préférable ?
La justice restaurative a été mise en place à partir des années1990 dans de nombreux pays occidentaux, mais elle est surtout arrivée en France à partir de 2014, avec la loi Taubira [relative à l’individualisation des peines]. Elle consiste notamment à organiser des rencontres entre victimes et auteur·es du préjudice. En gros, il s’agit de permettre à la justice pénale de ne pas être uniquement une justice de type rétributive, donc pas seulement fondée sur la punition, et de mettre en place des formes de réparation, de restauration du lien social, d’insertion des auteur·es au sein d’une communauté. Ruth Morris et d’autres abolitionnistes ont notamment critiqué le fait que cela reste des politiques pénales qui « humanisent » le système pénal et tentent de répondre a ses « dysfonctionnements ». En réaction, ils et elles ont donc pensé la mise en place de procédures transformatives, qui s’expérimentent au sein de communautés qui, souvent, ne peuvent pas recourir au système pénal. Comme la justice réparative, la justice transformative implique l’auteur·e, la victime et leurs communautés, mais elle vise aussi à transformer ces dernières.
Quelles seraient les limites potentielles de l’abolitionnisme pénal ?
D’abord, une question se pose : comment se met-on d’accord collectivement dans la définition des préjudices, en prenant en compte toutes nos subjectivités ? Le deuxième aspect problématique est celui de la preuve du préjudice ou des besoins d’enquête. Comment fait-on pour ne pas être que dans du déclaratif ? S’il y a un meurtre mais qu’on n’en connaît pas l’auteur·e, comment établir les faits et donc répondre aux besoins de la communauté sans que l’investigation revienne à recréer une police ?
La mise en place de procédures de justice transformative peut se heurter à la difficulté à établir les faits et les préjudices commis. Toutefois, cette question peut sembler beaucoup plus insurmontable qu’elle ne l’est réellement, car le système pénal décourage les auteur·es d’admettre la vérité des faits. D’autres façons de procéder, qui n’impliquent pas le recours à la punition, peuvent donc encourager la manifestation de la vérité.
(1) Gwenola Ricordeau s’intéresse aux approches critiques du système pénal et a notamment travaillé sur les proches de personnes incarcérées, la sexualité et le genre en prison. En 2019, elle publiait Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux), une approche féministe de l’abolitonnisme pénal.
(2) Le 25 mai 2020, George Floyd, un homme noir, était asphyxié par un policier à Minneapolis, en pleine rue. Cet homicide a provoqué de nombreuses manifestations contre la police.
Gwenola Ricordeau Professeure assistante en justice criminelle à la California State University de Chico (États-Unis).
Crimes et Peines. Penser l’abolitionnisme pénal Gwenola Ricordeau, éd. Grévis, 200 p., 12 euros.
Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine