Le premier confinement, une « expérience d’obéissance de masse »
Trois ans après le premier confinement, les sociologues Théo Boulakia et Nicolas Mariot dressent, dans L’Attestation, le bilan d’une période de fortes restrictions de libertés. Si policiers et gendarmes ont contrôlé tout le monde, les quartiers populaires ont été largement surverbalisés, et les femmes ont souffert de la privation d’espace public.
dans l’hebdo N° 1778 Acheter ce numéro
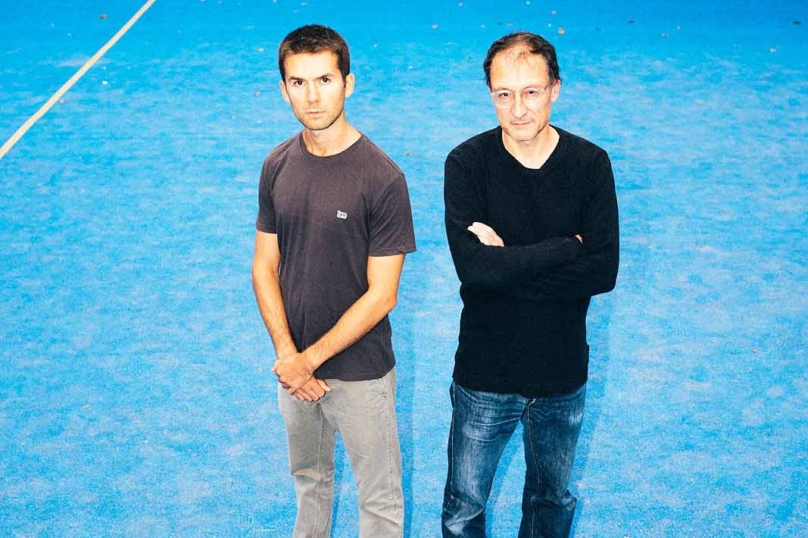
© Maxime Sirvins
Théo Boulakia est normalien, doctorant en sociologie au Centre Maurice-Halbwachs de l’École normale supérieure. L’Attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020, est son premier ouvrage. Nicolas Mariot est historien et sociologue, directeur de recherche au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS, EHESS et université Paris-I-Panthéon Sorbonne). Il est l’auteur de nombreux autres ouvrages de socio-histoire et de sociologie.
L’Attestion, Théo Boulakia et Nicolas Mariot, Anamosa, 400 pages, 25 euros.
Cette enquête sociologique est fondée sur des analyses quantitatives. Celles-ci s’appuient notamment sur la base de données La vie en confinement (Vico), issue d’un long questionnaire rempli par 16 000 personnes durant la période du premier confinement. Sources et données ici.
Le premier confinement français commence le 17 mars 2020. Plus de trois ans après, très peu de personnes en parlent. Pourquoi avez-vous jugé important de revenir sur cette période que beaucoup aimeraient oublier ?
Nicolas Mariot : Je ne pense pas que tout le monde voudrait l’oublier. Dans les relations amicales, et mêmes professionnelles, cette période revient souvent, car elle nous a énormément marqués. En revanche, ce qui nous a frappés, c’est l’absence d’enquête, de réflexion médiatique, politique, scientifique sur ce premier confinement. Non pas du point de vue sanitaire, mais du point de vue des libertés publiques. C’est la raison principale de notre enquête sociologique : proposer un bilan d’une politique qui a conduit à ces privations de libertés.
Justement, le discours public a eu tendance à naturaliser le confinement à la française. C’était comme une évidence : il n’y avait pas d’autre solution. Vous démontrez l’inverse en préambule de votre livre.
N. M. : Beaucoup d’autres pays en Europe ont fait différemment. Était-il indispensable de boucler tout le monde ? Nous disons que non, pour différentes raisons, la principale étant que l’enfermement total n’a pas eu d’impact sur l’arrêt de la maladie. Ce n’est pas nous qui le disons, mais de nombreuses études épidémiologiques de premier plan. Malgré tout, n’importe quel homme politique nous rappellerait l’incertitude du moment, notre méconnaissance de la maladie à l’instant t. C’est vrai, mais la question demeure : pourquoi, chez nous, a été fait le choix de l’ordre et de l’enfermement total, alors qu’ailleurs – en Allemagne, en Hollande, au Danemark –, on a fait autrement ?
Théo Boulakia : La France faisait partie d’un tout petit groupe de pays qui avaient mis en place un système de surveillance de masse d’un type assez particulier. Bien sûr, dans des pays comme la Chine, la surveillance de masse était bien plus équipée, beaucoup plus dystopique. Mais la France s’est inscrite parmi les nations où ce qui était surveillé n’était pas le statut sanitaire des gens, mais le motif de leur sortie.
Comment, alors, expliquer ce choix, dans un moment de crise et d’incertitude majeure ?
T. B. : On montre que la sévérité des enfermements est très liée à l’habitude de traiter les problèmes sociaux d’un point de vue policier, sécuritaire, en temps ordinaire. Elle est aussi inversement proportionnelle au respect des droits humains, tel qu’il peut être approché par différents indicateurs.
N. M. : C’est notre conclusion : « L’enfermement est moins le produit de bonnes intentions que de vieilles habitudes. » Au Danemark, il y a 190 policiers pour 100 000 habitants, en France 320.
Il en va régulièrement ainsi pour les restrictions des libertés publiques : on revient rarement en arrière.
Les mesures de restriction étaient coercitives, mais c’était pour sauver des vies, non ?
T. B. : Il y a deux questions : celle des « bonnes intentions », dont on vient de parler, et celle de l’efficacité du dispositif. Il ne fait aucun doute que le paquet de mesures consistant à interdire les rassemblements, inciter au télétravail, fermer un grand nombre d’institutions et de commerces, limiter les déplacements internes et les voyages internationaux, etc. a permis de faire baisser la contamination et donc de sauver des vies. La question qui reste est : était-il utile, en plus de tout cela, d’interdire aux gens de sortir de chez eux, sauf pour les « besoins essentiels » ? Tous les travaux existants convergent pour indiquer que non. Très concrètement, des pays comme le Danemark ou le Japon, qui n’ont pris aucune mesure d’enfermement, ont compté moins de morts en 2020 que les années précédentes. À l’inverse, des pays avec des mesures d’enfermement particulièrement dures, comme l’Espagne ou le Pérou, ont connu un excès de mortalité très important par rapport aux années précédentes.
La France a décidé d’enfermer sa population en mettant en place une « attestation dérogatoire ». Qu’est-ce que cela dit du rapport entre l’État et ses administrés ?
T. B. : Cela pointe la transformation de tous les problèmes publics en problèmes de police. Ainsi, les politiques publiques ne sont pas guidées par leur adéquation à un but, mais par leur capacité à être contrôlées. Dans le cadre du covid, ce qui fait sens d’un point de vue sanitaire, c’est de restreindre au maximum les contacts. Or la forme contrôlable de cette restriction des contacts, c’est le contrôle des sorties.
N. M. : Nous écrivons quelque chose qui résume cette idée, à propos des décès dans les Ehpad : « Prévenir ces morts nécessitait une autre politique que le déploiement de la police dans l’espace public. » La réponse qui est tombée sous le sens pour notre gouvernement, afin de répondre à cette situation, a été : police, surveillance, interdictions. On aurait pu attendre d’autres mesures de sa part.
Les politiques publiques ne sont pas guidées par leur adéquation à un but, mais par leur capacité à être contrôlées.
T. B. : Il faut rappeler qu’en France, comme en Espagne, la moitié des morts du premier confinement se sont produites dans les Ehpad. Pendant ce temps, policiers et gendarmes contrôlaient le contenu des sacs de courses et survolaient les montagnes en hélicoptère.
N. M. : Il est étonnant, dans ce cadre-là, d’avoir interdit d’aller dans des lieux où, justement, les contacts étaient peu probables : parcs, montagnes, littoraux. En même temps, on pouvait continuer d’aller se serrer dans les supermarchés, sur les trottoirs, dans le métro : personne parmi les élites gouvernantes du pays ne s’est dit que c’était une aberration.
T. B. : On a supprimé tous les espaces récréatifs. Certains préfets, à l’époque, le disaient même explicitement : « Le confinement, ce n’est pas les vacances ! »
Vous démontrez justement que cette politique nationale va être suivie par les pouvoirs publics locaux, qui vont même surenchérir avec de nombreux arrêtés préfectoraux et municipaux instaurant des mesures encore plus coercitives. Comment expliquer cette convergence ?
N. M. : C’est en cela que cette période est tout à fait étonnante, très différente des confinements ultérieurs qui, pour le coup, ont été contestés. À part une pétition demandant le retour des promenades au grand air, qui a dû recueillir 75 000 signatures, il n’y a pas, ou peu, eu d’oppositions. Tout le monde s’est aligné sur la politique gouvernementale et sa sévérité. C’est pour ça que nous parlons d’« union sacrée » : cette période ressemble au mois d’août 1914. Chacun, en partie sous l’effet de la sidération, s’est mis en rang et a suivi le gouvernement, quelles que soient ses décisions.
Peut-on faire un parallèle entre ces arrêtés locaux toujours plus absurdes et, au printemps dernier, la généralisation des arrêtés d’interdiction de manifestation ? Le confinement a-t-il permis une pratique plus décomplexée de cet outil ?
T. B. : Tout à fait. On le remarque à propos de plusieurs autres outils de contrôle et de surveillance. Les drones, par exemple. Le confinement a été un moment inaugural pour leur déploiement sur tout le territoire national, avec une dynamique de désinhibition. Ainsi, il n’est pas étonnant que Nice, la ville comptant le plus de policiers municipaux et de caméras de vidéosurveillance, soit une de celles qui ont pris les mesures les plus dures, avec beaucoup de verbalisations.
N. M. : Prenons un autre exemple : l’amende de l’infraction de quatrième catégorie, de 135 euros, a été instaurée pendant le confinement. Avant, elle s’élevait à 38 euros. Or on n’est pas revenu sur ce montant et, récemment, ces amendes ont été distribuées lors de manifestations contre la réforme des retraites finalement interdites par les préfectures. Il en va régulièrement ainsi pour les restrictions des libertés publiques : on revient rarement en arrière.
Une des grandes nouveautés du confinement a été l’extension des contrôles d’identité. Or plusieurs études ont montré la prédominance, en temps ordinaire, du contrôle de certaines populations, sur la base de biais racistes ou xénophobes. Ce schéma s’est-il reproduit pendant le confinement ?
T. B. : Oui. C’est là qu’il faut distinguer contrôle et verbalisation. Policiers et gendarmes ont contrôlé tout le monde, sans distinction. C’est la grande nouveauté par rapport aux contrôles d’identité ordinaires. Mais si tout le monde a été contrôlé, tout le monde n’a pas été verbalisé. Nous montrons que les quartiers populaires ont été largement surverbalisés pendant le confinement. Les biais raciaux n’intervenaient plus sur le contrôle, mais sur la question de la bonne foi.
L’attestation était bien plus un outil de surveillance que de responsabilisation.
N. M. : Au tout début, le gouvernement a fait passer l’attestation comme un outil qui reposait sur notre propre responsabilité. Or ce n’est pas ce qui s’est passé. Très souvent, notre propre bonne foi pouvait être remise en cause par les contrôleurs, et ce caractère pervers et étrange a marqué les gens. Cela montre qu’il s’agit bien plus d’un outil de surveillance et de contrôle que d’un outil de responsabilisation. Il est probable que ces interdictions laisseront des traces durables dans une partie de la population à l’égard de l’État, même si elles restent difficiles à mesurer aujourd’hui.
C’est un moment où il y a eu très peu de contestations, en tout cas de contestations visibles. Les Français ont-ils obéi massivement durant cette période ?
N. M. : Oui, les gens, dans une grande majorité, ont obéi. Pour des raisons différentes, éloignées les unes des autres, mais il y a eu une obéissance généralisée qui tient beaucoup au fait que, pendant cette période, tous les corps intermédiaires au sens très large – les groupes amicaux, associatifs, syndicaux – se sont effondrés. Même si on a vu apparaître des formes de désobéissance cachée, il était très difficile de construire un mouvement collectif dans une situation de face-à-face avec l’État.
Vous montrez aussi que les femmes, durant la période, sont moins sorties que les hommes. Vous parlez du confinement comme d’une période d’enfermement des femmes. Pourquoi ?
T. B. : Pendant le confinement, les femmes sortent et désobéissent moins que les hommes. Cet enfermement des femmes est très lié à ce qu’est devenu l’espace public durant cette période : un espace désert, catégorisé publiquement comme dangereux, où les repères et les routines étaient complètement détruits. En temps normal, les femmes sortent moins que les hommes et ont un rapport à l’espace public plus inconfortable, moins familier. Les sociologues et géographes spécialistes du sujet expliquent que les hommes occupent l’espace, et que les femmes s’y occupent : il faut toujours qu’elles aient l’air de faire quelque chose. Contre l’inquiètement ordinaire, les femmes créent de la familiarité, via des routines, des habitudes. Or, du jour au lendemain, il n’y a plus eu de familiarité : toutes les routines sur lesquelles elles s’appuyaient pour rendre le dehors moins inquiétant avaient disparu. L’inquiètement de l’espace public a eu un effet démultiplié pour elles.
Même la gauche, pourtant habituée à parler des libertés publiques, a peu discuté cette question.
N. M. : Il y a aussi la question des violences domestiques au sein des foyers. Dans notre enquête, nous donnons des exemples sidérants. Certaines femmes nous ont dit que le confinement a été une divine surprise pour leur mari, leur donnant un moyen de les boucler à la maison. Contrairement à l’ordinaire, il avait une « bonne raison » de le faire, une raison « légitime ».
Ces questions ont été peu abordées dans le débat public, sur le moment. Les médias ont-ils joué leur rôle ?
N. M. : Pendant cette période, il y a eu des critiques sanitaires, comme sur la gestion des masques chirurgicaux. Mais, sur la question des libertés, les médias ont eu un rôle d’accompagnement des pouvoirs publics. Même la gauche, pourtant habituée à parler des libertés publiques, a peu discuté cette question.
T. B. : Personne n’est allé voir ce que ces mesures signifiaient très concrètement, en termes d’absurdité bureaucratique, de dispositif de surveillance quotidien. Donc le débat est resté à un niveau surélevé, a porté sur des valeurs morales : les jeunes contre les vieux, la liberté contre la sécurité. Le concret n’a pas été abordé, y compris par des gens qui étaient sensibles à ces questions.
Pour aller plus loin…

Tour de France : Franck Ferrand, commentateur réac’ toujours en selle

La CGT et le Tour de France : quand sport et luttes se marient bien

« Ils parlent d’échange de migrants comme si les personnes étaient des objets »








