« Le roman est un fil tendu entre la poésie et la philosophie »
Dans Eve Melville, cantique, Justine Bo fait le portrait d’une femme qui se bat pour sauver la maison dans laquelle habitait son arrière-grand-père, esclave. Un chant qui réveille les stigmates de l’histoire des États-Unis.
dans l’hebdo N° 1796 Acheter ce numéro

© Alexandre LE MOUROUX
Eve Melville, cantique / Justine Bo / Grasset, 216 pages, 20 euros.
Et si l’histoire des États-Unis était une histoire de l’oppression ? Dans Eve Melville, cantique, Justine Bo fait le portrait de l’arrière-petite-fille de Solomon Melville, un homme né esclave dans l’État de Géorgie. Un matin, la maison voisine de celle qui appartenait à son arrière-grand-père a été repeinte en noir. Des promoteurs veulent la racheter. Eve Melville ne s’y résout pas. Pour elle, il faut se battre contre ce monde qui veut modifier le paysage dans lequel elle a vécu. Contre le capitalisme qui a remplacé l’oppression esclavagiste.
Le septième roman de Justine Bo ressemble à un chant. L’autrice livre une œuvre politique portée par une voix sensible et poétique. Inspiré de ce qu’elle a vécu aux États-Unis – elle a étudié le cinéma documentaire à New York et est restée quelques années dans le pays –, ce texte lui a demandé sept années d’écriture. En toile de fond, l’élection de Donald Trump en 2016. Tous les personnages voient ce moment comme un effondrement. Justine Bo aussi.
Quelle est la genèse de votre livre ?
Justine Bo : C’est une scène que j’ai vécue. Un matin, je me suis réveillée et j’ai vu une maison peinte en noire à Brooklyn, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, où j’habitais. Dans ce coin gentrifié, très tranquille, où toutes les maisons sont en briques rouges, quelqu’un a recouvert de noir la façade d’une maison sans que son propriétaire le veuille. C’était un geste symbolique : on isole esthétiquement une maison du quartier, une brèche s’ouvre. Tout le voisinage a vu cet acte comme une sorte d’avertissement. Je me suis dit que cette scène pouvait inspirer un texte. J’en ai immédiatement eu une lecture fictionnelle et poétique.
Vous écrivez un portrait très sensible d’Eve Melville, cette femme hantée par l’histoire de son arrière-grand-père, Solomon Melville, un homme né esclave qui a travaillé dans les plantations d’indigo à Palo Alto, en Géorgie, avant de fuir et de s’installer en homme libre à Brooklyn.
Cette maison dont la façade a été repeinte en noir est la demeure voisine de celle de la narratrice, une brownstone qui appartenait à Solomon Melville. Après cet acte, Eve Melville devient un personnage en colère. Elle entre en révolte, au sens camusien. Elle se bat pour que cette maison redevienne comme avant. Elle se bat contre les promoteurs qui veulent s’emparer de ce quartier. Elle se bat pour être reconnue par l’administration en tant que propriétaire de la maison qui appartenait à son arrière-grand-père. C’est son seul héritage et on veut le lui enlever. C’est comme si le système de domination qu’avait connu Solomon était toujours là.
Je ne crois pas à l’existence d’une frontière entre réalité et fiction.
Mais ce personnage est aussi complexe. D’un côté, Eve Melville est très présente : elle parle au mégaphone pour alerter le quartier et hurle aux promoteurs de partir. Elle est toujours en mouvement. De l’autre, elle ne dit rien sur elle, comme si elle voulait s’effacer en partie. Elle n’arrête pas de répéter qu’elle est « imparfaite » et porte tellement de stigmates : son histoire familiale mais aussi son homosexualité, d’où découle, selon elle, le fait de ne pas avoir d’enfant.
Ce personnage est inspiré de la femme qui était la propriétaire de la maison dans laquelle je vivais à Brooklyn. Elle était l’arrière-petite-fille d’un homme né esclave devenu policier à Brooklyn, comme Solomon Melville. Elle était héritière d’une histoire lourde à porter. Et, surtout, elle racontait sa vie en choisissant ses propres mots. Pour évoquer le sida, elle parlait d’un « bug », ce qui, en anglais, renvoie à la notion de problème, de dysfonctionnement, mais aussi à un petit insecte. Dans le roman, j’utilise le mot « parasite ». Sa langue, c’est aussi ce qui m’a touchée chez elle.
Pourquoi mêler la fiction et le réel ?
Je ne crois pas à l’existence d’une frontière entre réalité et fiction. Selon moi, la fiction commence dès que l’on veut raconter le réel par le langage. Donc les personnages de ce texte sont inspirés de personnes ayant existé. Par exemple, Peter Stephenson, le peintre, est une référence au photographe Peter Hujar, un contemporain de Robert Mapplethorpe. C’est un artiste qui m’a toujours intriguée, car la maladie est entrée par effraction dans son œuvre. Le réel passe au tamis de ma fiction. Par ailleurs, j’ai un intérêt pour l’histoire. Avant d’écrire sur ce livre, je me suis documentée sur l’histoire de l’esclavage. Au sein de mon corpus de travail, une source a été très importante : le Federal Writers’ Project.
Après la crise américaine des années 1930, le gouvernement américain passe commande auprès de certains écrivains pour recueillir des témoignages d’anciens esclaves et de descendants d’esclaves. Même si cette démarche est problématique dans la mesure où elle visait à conforter la mythologie qui soutient que les États du Nord auraient « libéré » les esclaves américains, elle m’a donné accès à une source importante d’information sur la vie quotidienne des esclaves. Il y a des anecdotes très précises. Ces documents m’ont permis d’aller plus loin que les analyses historiques sur l’oppression esclavagiste. La grande histoire était individualisée. Cette force des détails raconte la cruauté des plantations et illustre le projet d’anéantissement qu’est l’esclavagisme.
Quels sont les rapports des personnages à leur identité ?
Ce qui rassemble mes personnages, c’est qu’ils refusent de se définir. Pour eux, l’identité est une notion figée qui ne renvoie à rien. C’est une coquille vide. Ils sont dans le mouvement. Eve Melville est héritière de l’histoire de Solomon Melville, un homme qui ne devait pas se retrouver esclave aux États-Unis. La narratrice, Eden Borde, est une Française qui est arrivée à Brooklyn. Mais mes personnages sont renvoyés à leur identité supposée. Le personnage de Saul Cicero n’est pas considéré comme mexicain par les Mexicains de Brooklyn et il n’est pas non plus considéré comme américain par les Américains. Tous mes personnages sont en conflit avec l’idée de l’identité.
Votre écriture pourrait être qualifiée de prose poétique. Vous jouez sur les répétitions, des voix se mélangent, le rythme ressemble à celui d’un chant. Comment avez-vous travaillé ce texte ?
J’ai beaucoup lu Antonin Artaud, Henri Michaux, Maurice Blanchot et Georges Bataille. La poésie est ma première nourriture littéraire. Selon moi, le roman est un fil tendu entre la poésie et la philosophie. Raconter une histoire, ce n’est pas intéressant. Sur la question de l’esclavage, il est possible d’écrire un livre d’un millier de pages. Mais, plutôt que m’intéresser à des enjeux scénaristiques, je préfère écrire des motifs, comme cette maison repeinte soudainement en noir.
Mon enjeu d’écriture, c’est de faire vivre une langue.
Ce qui m’importe surtout, c’est d’écrire la manière dont mes personnages traversent des espaces, ce qu’ils sont vraiment, ce qu’ils ressentent. Avec une voix plus poétique, l’histoire transpire par les mots. Mon enjeu d’écriture, c’est de faire vivre une langue. Je voulais installer une sorte de scansion, un cantique, un chant que pourraient porter mes personnages. La voix poétique, c’est ce qui me préoccupe d’abord. Le reste devient presque anecdotique. La question n’est donc plus quelle histoire le lecteur est en train d’apprendre mais comment il la ressent.
En toile de fond de votre roman, vous racontez la vie politique états-unienne. Pourquoi vos personnages sont-ils autant traversés par l’élection de Donald Trump en 2016 ?
J’ai suivi des études de science politique. Je me suis toujours intéressée à la philosophie politique et aux grandes idées qui devraient dicter le débat, même si ce n’est pas ce qui semble intéresser nos dirigeants. Mais je me souviens surtout de la peur que j’ai ressentie le jour de l’élection de Donald Trump en 2016. C’était le fascisme. Il était inévitable que ce sentiment de peur soit présent dans le livre. Et les débuts de sa politique ont montré qu’il reconstruisait l’oppression que les États-Unis avaient déjà connue. En 2017, Trump signe le « Muslim ban » qui interdit aux réfugiés et aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis. Entre l’esclavagisme et sa politique, le motif cyclique de la domination d’un système reprenait.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
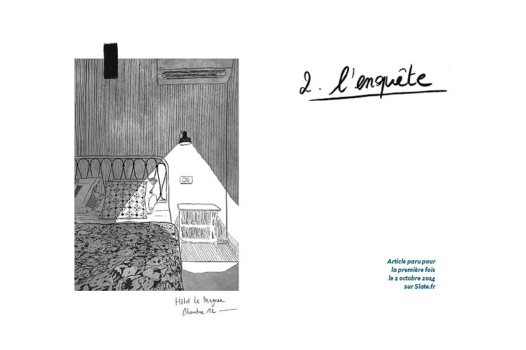
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération








