Mort de Rémi Fraisse : la CEDH condamne la France
Plus de dix ans après la mort de Rémi Fraisse, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’État français avait violé le droit à la vie en raison d’un encadrement insuffisant du maintien de l’ordre. Une décision inédite qui rappelle la nécessité d’une réforme en profondeur des pratiques policières.

© Maxime Sirvins
Le 24 octobre 2014, Rémi Fraisse était tué par l’explosion d’une grenade offensive lors d’une manifestation contre le barrage de Sivens (Tarn). Dans une décision rendue ce jeudi 27 février, la Cour a reconnu que l’intervention des forces de l’ordre violait l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la vie. Elle condamne ainsi la France pour un usage disproportionné de la force.
Une condamnation pour défaut de protection des manifestants
Dans sa décision, la CEDH établit qu’il y a bien eu violation dudit article dans son volet matériel, pointant notamment l’absence de garanties suffisantes pour encadrer l’usage d’une force potentiellement meurtrière. Elle souligne que le cadre juridique et administratif alors en vigueur présentait des lacunes importantes et que des défaillances dans la préparation et la conduite des opérations ont contribué à la mort de Rémi Fraisse. Le recours aux grenades offensives OF-F1, particulièrement dangereuses, sans dispositif de contrôle efficace de leur usage, constitue une faute grave de l’État.
C’est apparemment la première fois que la France est condamnée pour l’usage d’armes dans une opération de maintien de l’ordre.
Me Dujardin
Claire Dujardin, avocate de la sœur, de la mère et de la grand-mère de Rémi Fraisse, estime que cette décision constitue une véritable victoire. Selon elle, la CEDH reconnaît clairement que l’encadrement du maintien de l’ordre en France, à l’époque des faits, était insuffisant. « C’est apparemment la première fois que la France est condamnée pour l’usage d’armes dans une opération de maintien de l’ordre. Habituellement, elle l’est pour des opérations de police impliquant des armes à feu dans le cadre d’interpellations. »
Elle souligne également l’importance du rappel fait à l’État français par la Cour : la doctrine de maintien de l’ordre doit être revue. « Contrairement à ce qu’affirment les ministres de l’Intérieur successifs, tout ne va pas bien en matière de maintien de l’ordre en France. Cette condamnation montre que des améliorations sont nécessaires pour éviter de nouveaux drames. »
Toutefois, la Cour a estimé qu’il n’y a pas eu de violation dans son volet procédural, ce qui signifie qu’elle juge que l’enquête menée par les autorités françaises respectait les exigences d’impartialité et d’approfondissement. Les juges notent néanmoins que l’absence de reconstitution et la conduite des investigations par des gendarmes ont suscité des doutes sur l’objectivité de l’enquête, sans pour autant conclure à une violation formelle.
Une faute structurelle dans la gestion du maintien de l’ordre
Le 25 octobre 2014, alors que des affrontements éclataient entre manifestants et forces de l’ordre sur le site du barrage de Sivens, Rémi Fraisse, jeune botaniste de 21 ans, décédait après l’explosion d’une grenade offensive lancée par un gendarme. À l’époque, une information judiciaire avait été ouverte pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », avant d’être requalifiée en « homicide involontaire ».
Malgré la mobilisation de la famille, l’enquête s’est conclue en janvier 2018 par un non-lieu, confirmé en appel et en cassation. Ce sentiment d’injustice a conduit les proches de Rémi Fraisse à saisir la CEDH en 2021, espérant obtenir une reconnaissance officielle du manquement de l’État. Selon Me Dujardin, cette décision est essentielle pour les proches de Rémi Fraisse et les militants de Sivens, qui, dix ans après, voient enfin une reconnaissance des manquements de l’État. « Cet arrêt va probablement être utilisé dans d’autres affaires pour renforcer les critiques contre les pratiques actuelles du maintien de l’ordre. »
L’État français devra verser des indemnités aux proches de Rémi Fraisse : entre 5 600 et 16 000 euros pour chacun des requérants, ainsi que des frais de justice. Cette décision, bien qu’importante sur le plan juridique, ne remet pas en cause l’absence de responsabilité pénale des forces de l’ordre impliquées. En 2021, la justice administrative avait reconnu la « responsabilité sans faute » de l’État, en le condamnant à indemniser la famille sans reconnaître de faute dans la gestion du maintien de l’ordre. La CEDH va plus loin en établissant une faute structurelle dans la gestion de l’intervention policière.
Un précédent pour l’avenir ?
Il faut espérer que la France entende ce que dit la Cour et adapte son maintien de l’ordre.
Cette condamnation établit un précédent en matière de maintien de l’ordre en France. La CEDH rappelle ainsi que l’usage de la force par l’État doit être strictement encadré et justifié, en particulier lorsque des armes potentiellement létales sont employées. Claire Dujardin rappelle que, si Sivens a marqué un tournant en matière de répression des mouvements écologistes – sans oublier l’affaire Vital Michalon, mort en 1977 dans les mêmes circonstances –, les violences policières n’ont pas cessé depuis : « Il y a eu d’autres blessés graves, et à Sainte-Soline, un militant a failli mourir. Il faut espérer que la France entende ce que dit la Cour et adapte son maintien de l’ordre. »
Plus de dix ans après Sivens, la mort de Rémi Fraisse reste un symbole, mais le dossier juridique peut enfin se fermer. Dans les manifestations, le slogan « On n’oublie pas ! On ne pardonne pas » continuera, lui, de résonner.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…
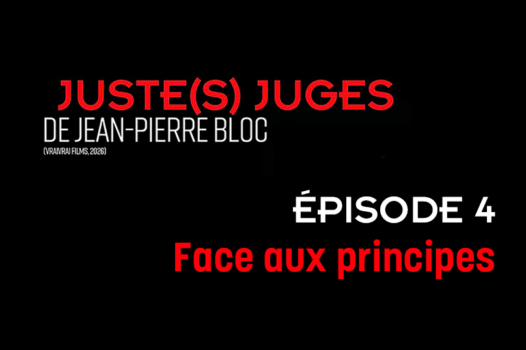
Juste(s) juges – Épisode 4

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition

Extrême droite armée, police peu réactive… Après la mort de Quentin Deranque, des faits et des questions









