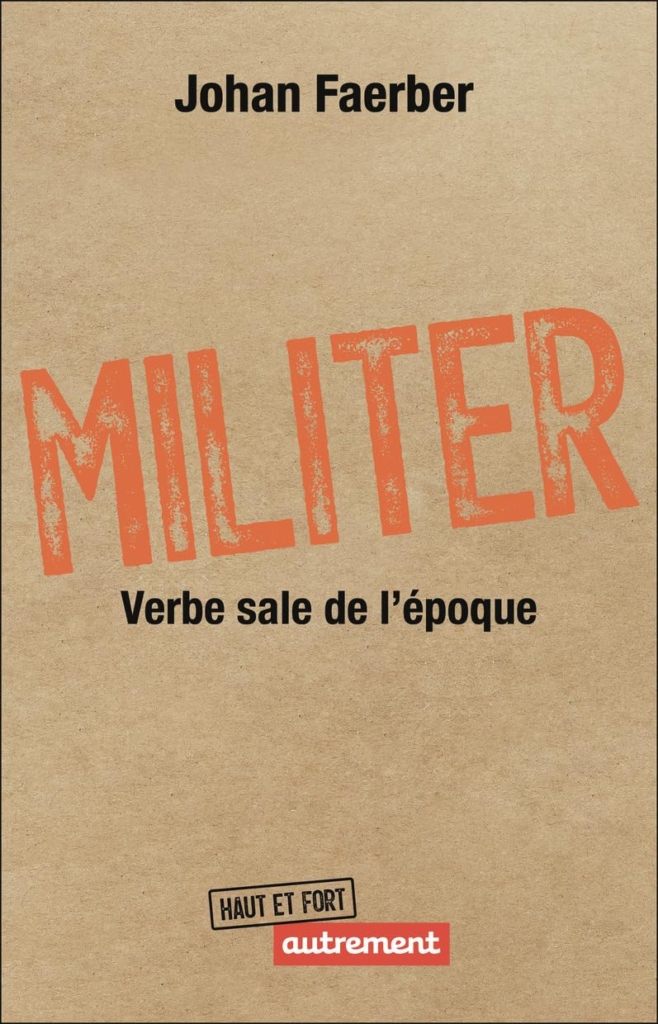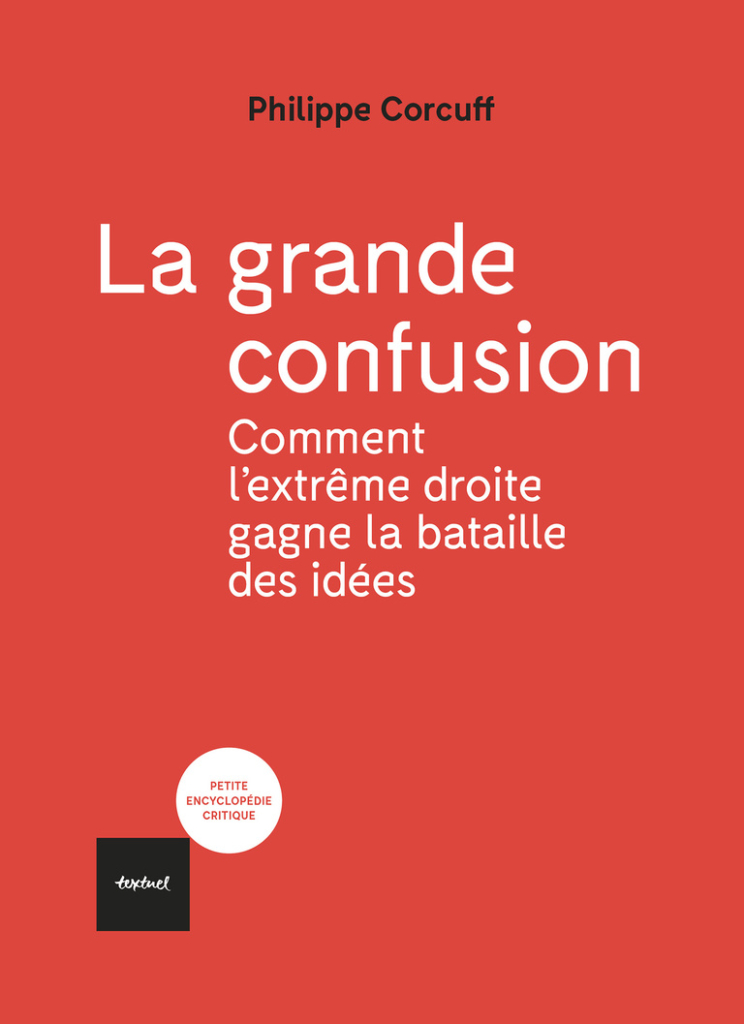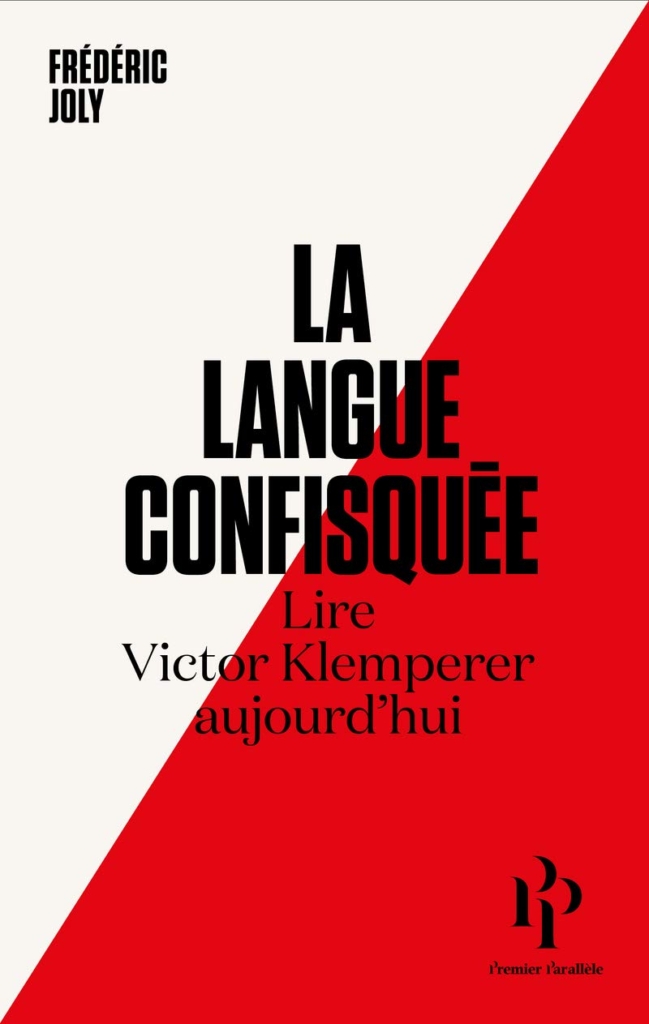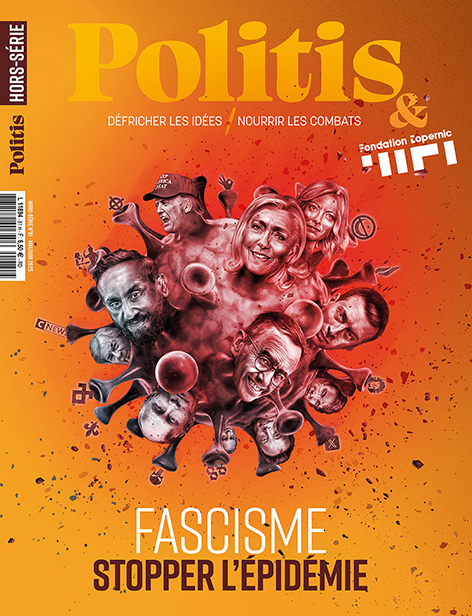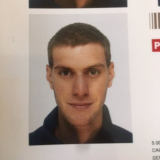Dire tout et n’importe quoi : ce que la montée du fascisme fait à la langue
Partout, dans un monde qui se brunit, les pouvoirs en place n’hésitent plus à utiliser des termes pour leur faire dire l’inverse de leur sens. Mots et idées qui appartenaient à l’extrême droite s’instillent dans le langage, rendant plus difficile la possibilité de nommer la réalité.

Dans le même dossier…
« Les identitaires font le travail métapolitique du Rassemblement national » Refuser la criminalisation de l’antifascisme sans crier au péril fasciste à chaque provocationImaginez. Un des plus éminents chercheurs français sur le nazisme invité d’un média de gauche pour devoir expliquer que non, Hitler n’était ni de gauche ni communiste. Le tout, en 2025. Une mauvaise blague ? Pas vraiment. Johann Chapoutot a, en effet, dû rappeler ces faits élémentaires chez nos confrères de L’Humanité, après qu’Elon Musk, homme fort du nouveau pouvoir trumpiste aux États-Unis, a validé les dires d’une candidate de l’AfD, parti d’extrême droite allemande, affirmant sans sourciller qu’Adolf Hitler était communiste.
L’exemple allégorise un fait politique de plus en plus observé : celui de profondément détourner le sens de mots, de concepts. Le fascisme devient alors de gauche. Le dictateur, un démocrate. Et réciproquement. Militer, un crime. « Aujourd’hui, le terme ‘militant’ est devenu un outil de criminalisation, observe Johan Faerber, docteur en littérature et récent auteur de Militer, verbe sale de l’époque (Autrement, 2024). Alors que, depuis la Révolution, le verbe militer a toujours été du côté de la démocratie. » Le chercheur cite, par exemple, le terme d’écoterroristes utilisé par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, pour qualifier des militants écologistes.
Le 6 mai, lors du meeting de soutien à l’organisation antifasciste la Jeune Garde et au collectif Urgence Palestine, menacés de dissolution par Bruno Retailleau, Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac, s’insurgeait : « Les écologistes seraient des écoterroristes, les révoltés des quartiers ou des territoires ultramarins, des émeutiers, les soutiens au peuple palestinien feraient l’apologie du terrorisme, les féministes seraient des féminazies, les antifascistes des fascistes, et les syndicalistes des preneurs d’otages. »
Triangulation
Il y a une stratégie d’infiltration du langage par l’extrême droite.
J. Faerber
« Il ne faut pas penser que cela est une stratégie globale, réalisée en claire conscience, car cela ne correspond pas au jeu politicien », estime Philippe Corcuff. Pour l’auteur de La Grande Confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées (Textuel, 2021), l’usage de cette méthode répond avant tout à « des coups tactiques » de court terme.
Pour Olivier Mannoni, auteur de l’ouvrage Coulée brune. Comment le fascisme inonde notre langue (Eloise d’Ormesson, 2024), ce qui a permis aux termes d’extrême droite de se diffuser, c’est la « triangulation ». « C’est-à-dire le fait de reprendre leurs idées, leur vocabulaire, et se les approprier. C’est ce que Sarkozy a fait face au FN. » Exemple : la création du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale. Ou encore, sa volonté de « nettoyer » les banlieues « au Kärcher », exprimée en tant que ministre de l’Intérieur, après la mort de Sidi-Ahmed Hammache, enfant de 11 ans, tué par une balle perdue après un règlement de comptes en juin 2005 (1).
Article corrigé le 9 mai 2025.
« Il y a une stratégie d’infiltration du langage par l’extrême droite, qui essaie de créer une 5e colonne dans le langage », estime Johan Faerber. « Et quand un média dominant reprend un terme d’extrême droite, il l’installe dans la population, ce qui permet de banaliser des termes d’une extrême violence. Ceci dit, on n’articulerait pas aussi facilement des termes aussi dégueulasses qu’ ”un OQTF” pour désigner une personne, si une partie de la population n’avait pas le désir d’accéder au fascisme », ajoute-t-il.
Ce que le fascisme fait à la langue
Si les mots et concepts d’extrême droite se diffusent en France, accompagnant la montée du racisme et du fascisme, l’offensive linguistique se durcit lorsque l’extrême droite arrive au pouvoir. En Russie, le mot « guerre » a été interdit pour désigner l’invasion russe de 2022 en Ukraine. Ceux qui nommaient la réalité au lieu d’employer l’expression « opération spéciale » risquaient ainsi la prison. En Russie et au Bélarus, le mot « fasciste », faisant écho à ceux qu’ils ont combattus pendant la Seconde Guerre mondiale (« Grande guerre patriotique ») est désormais utilisé pour désigner leurs adversaires. Comprendre l’Ukraine (qu’ils entendent « dénazifier ») et plus globalement l’Europe.
De l’autre côté de l’Atlantique – où du Pacifique, selon par où on passe – Donald Trump et ses soutiens, Elon Musk en tête, s’inspirent de cet usage des mots. Dès 2015, lors de la première campagne de Donald Trump, Olivier Mannoni, qui s’attelait alors à la traduction de Mein Kampf, a été frappé « des ressemblances ahurissantes dans l’utilisation de la confusion dans les discours ». Lors de la campagne de 2023, Donald Trump promet d’éliminer « les communistes, les marxistes, les fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine ».
Dans un autre discours, il parle des « migrants qui empoisonnent le sang de notre pays ». Des mots suivis des faits, comme le souligne le chercheur. « Dès le début de son deuxième mandat, il a fait déporter des gens. Il a parlé de son projet de conquête du Groenland, du Canada, du Panama. Il a évoqué son projet de déporter 2 millions de personnes à Gaza pour en faire un camp de vacances, ce qui est un projet de crime contre l’humanité. » Un projet de déportation qui n’a pas été nommé comme tel, aux États-Unis comme en France, où les médias ont étudié la faisabilité du projet.
Aux États-Unis, l’offensive idéologique et linguistique s’est traduite par l’interdiction pure et simple de certains termes. Un exemple : l’agence de santé publique n’a plus le droit d’utiliser les termes « transgenre », « LGBT » ou encore « identité de genre ». L’aboutissement de toute une stratégie autour d’un novlangue du pouvoir trumpiste où Volodymyr Zelensky se transforme en « dictateur » et où des dépenses tout à fait légales de l’administration fédérale sont qualifiées de « fraudes massives ». « Aux États-Unis, on a observé une série d’idéologues proches du pouvoir actuel qui ont eu la volonté d’aller sur le terrain de la bataille culturelle avec l’idée que le marxisme culturel dominait les campus états-uniens », poursuit Philippe Corcuff.
Donald Trump mène une cette bataille culturelle sur le plan des mots et des concepts.
Désormais au pouvoir, Donald Trump mène donc cette bataille culturelle contre les campus universitaires aussi sur le plan des mots et des concepts. Ainsi, une liste de 100 mots a été envoyée à la National Science Foundation, l’institution qui supervise la recherche scientifique américaine. Chaque projet scientifique en cours comportant l’un d’eux doit être réévalué, et possiblement annulé, si le contenu est jugé inadapté. Des termes très génériques des sciences humaines et sociales comme « historiquement », « socioculturel » ou « socio-économique » en font par exemple partie.
Couper la langue aux fascistes
La façon dont le fascisme s’installe par la langue, de façon plus ou moins insidieuse, a été décrite par ceux qui l’ont vécue avant nous. Dans Reconnaître le fascisme (1995), l’écrivain et intellectuel italien Umberto Eco identifiait 14 points constitutifs du fascisme primitif. Il évoquait le novlangue et « le lexique pauvre et une syntaxe élémentaire » des manuels nazis ou fascistes « afin de limiter les instruments de raisonnement complexe et critique ». Il prévenait : « Nous devons être prêts à identifier d’autres formes de novlangue, même lorsqu’elles prennent l’aspect innocent d’un populaire talk-show. »
Avant lui, le linguiste Viktor Klemperer avait décrit les changements sémantiques brutaux à l’œuvre dans l’Allemagne nazie. Sans comparer la période que nous vivons à celle vécue par Klemperer, Frédéric Joly, auteur d’un essai sur Klemperer, intitulé La Langue confisquée soulignait auprès de La Croix la pertinence de ses analyses : « Il nous montre avec quelle facilité la langue commune peut être pervertie et à quel point nous pouvons ne pas en avoir conscience quand nous restons aveugles à cet enjeu. »
Pour Johan Faerber, « les changements sémantiques s’accélèrent et accompagnent l’augmentation de la violence physique ». Certains débats sémantiques permettent ainsi d’éluder des questions politiques. « Quand on se demande après l’assassinat d’Aboubakar Cissé s’il faut dire acte anti-musulman ou islamophobe, c’est une façon de ne pas parler de cet assassinat en lui-même, qui devrait être une affaire Dreyfus. C’est la même chose pour le génocide à Gaza », poursuit Johan Faerber.
Comment alors enrayer la mécanique du langage qui permet en transformant la réalité de légitimer des violences politiques, notamment racistes ? Pour sortir de la sidération que crée la « délexicalisation » de la langue, Johan Faerber propose de se réapproprier le langage en réinvestissant le terme « militer ». « Je propose de s’aider de trois autres mots. “Décoloniser” la langue, “désarmer” pour stopper la machine et “démissionner”. C’est-à-dire de ne pas céder à la tentation de débattre de n’importe quoi avec n’importe qui. Car la folie conquérante séduira toujours plus que la rationalité. » À bon entendeur…
À retrouver en kiosque, sur notre boutique et notre site, le hors-série de Politis : « Fascisme, stopper l’épidémie ».
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Sale arab » : dans les casernes de pompiers, des syndicats face à un racisme « décomplexé »

En Haute-Savoie, des pompiers volontaires sanctionnés après avoir dénoncé du harcèlement

Déconstruire le duel des « deux France »