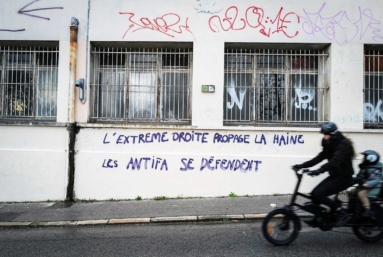Punir plutôt que réparer : la dérive carcérale
Surpopulation endémique, explosion des courtes peines, recul des droits et suppression des dispositifs de réinsertion : la politique pénitentiaire française s’enfonce dans une logique répressive. Face à cette spirale punitive assumée, les alertes se multiplient.
dans l’hebdo N° 1861 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
En Guyane, Darmanin offre le retour des bagnes à la galaxie Bolloré « Il y a en France une passion d’enfermer » Darmanin, ministre hyperactif cherche voix pour l’Élysée Prisons : à droite, la surenchère répressiveLoin d’une justice orientée vers la réinsertion, le gouvernement actuel, porté notamment par Gérald Darmanin, aujourd’hui ministre de la Justice, semble consacrer une logique de punition, d’enfermement et de restriction des droits des détenus. Surpopulation chronique, retour des peines courtes fermes, suppression de droits civiques, attaques contre les activités de réinsertion et criminalisation des plus précaires : l’institution carcérale devient le révélateur d’une politique de plus en plus décomplexée.
Pour Jean-Claude Mas, directeur de l’Observatoire international des prisons (OIP), il est question d’« une surenchère qui agit sur tous les leviers pour punir, punir, punir ». Fondée en 1995, l’association se bat pour la défense des droits et de la dignité des personnes détenues.
La surpopulation relève d’un choix politique.
J-C. Mas
La densité carcérale atteint un niveau historique. En avril 2025, la France franchissait la barre des 82 000 détenus pour environ 62 000 places théoriques. Plus d’un quart des détenus sont en détention provisoire, d’après les données du ministère de la Justice. Le taux d’occupation moyen atteint 133 %, et certaines maisons d’arrêt enregistrent des pics supérieurs à 200 %. Rien qu’en un an, le nombre de détenus a augmenté de plus de 7 %.
Cette inflation carcérale n’est pas le fruit du hasard. Selon Jean-Claude Mas, « la surpopulation relève d’un choix politique, la source principale en reste la surincarcération ». La prison reste la peine de référence. « On estime ne pas avoir assez puni tant qu’il n’y a pas eu incarcération, sans se demander si cette peine est proportionnée, ni quel impact elle a sur les personnes détenues et leurs proches », précise le directeur de l’OIP.
En avril, les députés ont adopté en première lecture un texte pour la suppression de l’aménagement obligatoire des peines inférieures à six mois, précisément pour permettre leur exécution en maison d’arrêt. Le texte rétablit aussi la possibilité d’infliger des peines de prison ferme de moins d’un mois. « On est dans une surenchère punitive », dénonce Jean-Claude Mas. Cette mesure est critiquée par les associations, qui rappellent que l’enfermement, même pour quelques semaines ou mois, accentue les ruptures sociales, affectives et professionnelles.
Une dégradation des conditions de vie
La surpopulation a des conséquences concrètes : cellules partagées à trois, voire quatre, matelas au sol, violences accrues, tensions entre codétenus, accès aux soins et aux activités limité, hygiène dégradée. La Défenseure des droits, Claire Hédon, et l’Observatoire international des prisons ont dénoncé les conditions actuelles de détention. Dans un communiqué publié en novembre 2024, la Défenseure des droits explique que cette surpopulation « conduit à des conditions de détention indignes, dans toutes leurs dimensions : infestations de rongeurs, de cafards et de punaises de lit, sanitaires et installations électriques parfois vétustes et détériorés, ‘promenades’ limitées à une heure par jour ».
La situation de surpopulation carcérale est la cause d’atteintes massives aux droits des personnes détenues.
Défenseure des droits
Elle considère que « la situation de surpopulation carcérale est la cause d’atteintes massives aux droits des personnes détenues et qu’il est urgent d’y mettre un terme ». La France a d’ailleurs été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en raison de cette situation et de ces manquements. D’après l’OIP, ces quinze dernières années, cinquante-trois « établissements pénitentiaires français ont été considérés comme exposant les personnes détenues à des traitements inhumains ou dégradants par la justice française et/ou par la Cour européenne des droits de l’homme ».
Une crise systémique
Les salariés, eux aussi, sont en grande souffrance. Les syndicats pénitentiaires, après les attaques coordonnées de la mi-avril, ont tiré le signal d’alarme sur leurs conditions de travail et la dégradation de la sécurité. Plusieurs établissements et domiciles d’employés ont été la cible de tirs, d’incendies ou de menaces. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a évoqué « 65 faits en France dans trente et quelque départements ».
Quelques jours après les premières attaques, Gérald Darmanin, garde des Sceaux depuis moins de quatre mois, a annoncé la création de nouvelles prisons pour un total de 3 000 places, loin des 20 000 manquantes. Mais le ministère cherche avant tout les économies, en prévoyant des prisons en préfabriqué.
Depuis fin 2018, le gouvernement vise la création de 15 000 places supplémentaires d’ici à 2027, grâce à son « plan 15 000 ». L’ex-ministre de la Justice, Didier Migaud, a indiqué fin 2024 que ce plan avait pris du retard. Seulement 4 500 places ont été créées à ce jour. Le coût budgétaire du programme, initialement évalué à 4,5 milliards d’euros, avait été révisé à 5,4 milliards en juin 2022. Depuis 1990, plus de 25 000 places ont été créées, tandis que le nombre de détenus a, lui, augmenté de 30 000. « Plus on construit de places, plus on enferme », commente Jean-Claude Mas.
Dans la continuité, Gérald Darmanin a proposé en avril 2025 de faire payer aux détenus une « taxe d’incarcération », ravivant un vieux dispositif abandonné en 2003. « C’est une annonce qui participe à une surenchère punitive, qui devient très préoccupante, explique le directeur de l’OIP. On se demande où on va s’arrêter. » Un mois avant, le Sénat a adopté une loi supprimant le vote par correspondance pour les détenus lors des scrutins municipaux et législatifs. Une « atteinte au droit de vote des détenus » dénoncée par plusieurs sénateurs de gauche, dont Guy Benarroche (Les Écologistes).
Cette démagogie passe à côté des enjeux de la réinsertion.
J-C. Mas
En parallèle, les activités dites « ludiques » ont été suspendues dans plusieurs établissements par instruction ministérielle. Des cours de yoga ou même des ateliers d’écriture ont été supprimés. Darmanin a ordonné cet arrêt le 17 février dernier, peu après que des détenus ont pu bénéficier de soins pour le visage offerts par une école. « Il est hors de question d’avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui m’ont choqué profondément », s’était offusqué le ministre.
Plusieurs organisations ont saisi le Conseil d’État, estimant que ces activités participaient à la préparation à la réinsertion et à l’équilibre psychologique des détenus. « C’est incompréhensible de supprimer de telles activités et de durcir des conditions de détention qui vont, in fine, contribuer potentiellement à la récidive, rappelle Jean-Claude Mas. On marche un peu sur la tête puisque, dans l’état actuel des choses, 50 % des personnes récidivent cinq ans après. Cette démagogie passe à côté des enjeux de la réinsertion. »
« La situation est dramatique »
Symbole de cette logique répressive : l’autodissolution du Genepi, association étudiante historique engagée dans la réinsertion par l’action culturelle, en 2021. « Nous refusons de faire perdurer une association qui n’a pas été pensée comme un outil de lutte contre l’enfermement et n’a jamais servi l’intérêt des prisonnier·ères », avait communiqué l’association à l’époque. L’administration pénitentiaire lui reprochait son ton trop critique et son indépendance de parole.
Nos actions de sensibilisation fonctionnent. Donc, oui, il y a de l’espoir.
J-C. Mas
Dès 2018, l’État lui avait retiré l’agrément et les subventions (50 000 euros par an), entravant gravement ses capacités d’action. Depuis, des anciens du Genepi ont lancé le projet Rebond pour tenter de reprendre le flambeau. Du côté de l’OIP, qui existe depuis trente ans, il est important de s’entourer d’alliés. « On mène des actions collectives avec des acteurs associatifs et syndicaux, explique son directeur. Donc, on arrive à animer ou à porter des luttes collectives. » Face à un modèle de plus en plus punitif, les « conséquences sont dévastatrices ».
Jean-Claude Mas dénonce « un positionnement politique démagogique et populiste qui fait que tout est bloqué alors que la situation est dramatique ». Pas question de baisser les bras pour autant. « On connaît des victoires, notamment via notre permanence d’accès aux droits. On aide des personnes détenues, parfois en lien avec des avocats. On obtient des décisions de justice. Nos actions de sensibilisation fonctionnent. Donc, oui, il y a de l’espoir. »
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Enquête, extrême droite, impacts politiques après la mort de Quentin Deranque : posez vos questions

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition
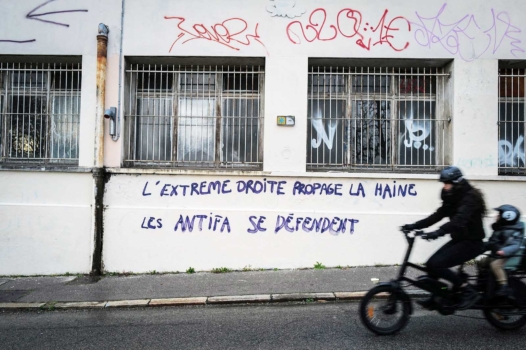
« Les groupes antifascistes se sont toujours constitués en réaction à la violence de l’extrême droite »