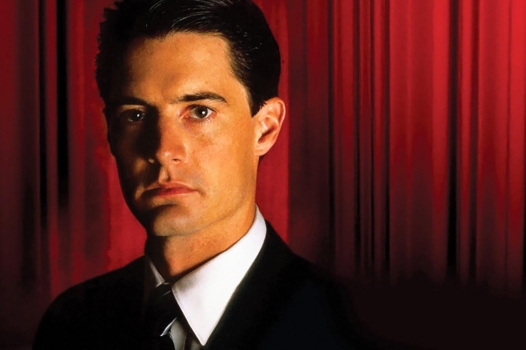Frères Dardenne : « Il fallait beaucoup de douceur dans les mouvements de caméra »
Les frères Dardenne se renouvellent avec Jeunes mères, présenté en compétition à Cannes et sortant en salles simultanément.

© JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA MAG via AFP
Jean-Pierre et Luc Dardenne sont de retour en compétition à Cannes, après Tori et Lokita (2022). Si les frères cinéastes restent fidèles à une thématique bien ancrée dans la réalité, les jeunes mères, la plupart encore adolescentes, et notamment les relations qu’elles entretiennent ou non avec leurs propres mères, ils signent un film de facture nouvelle et tourné vers l’espoir. Rencontre.
À chacun de vos films correspond une forme particulière. Le filmage des nuques et des dos pour Rosetta ou Le Fils, l’ellipse pour Le Silence de Lorna, le road-movie pour Deux jours, une nuit… Dans Jeunes Mères, la figure de style récurrente est le panoramique, qui accompagne les héroïnes dans leurs mouvements.
Luc Dardenne : Nous avons surtout utilisé le panoramique pour les rencontres, par exemple entre Jessica et sa mère, Jessica passant par ailleurs une grande partie du film à la chercher ou à la suivre. Dans les chambres des bébés aussi. Quand la caméra passe du visage de Julie et qu’on descend sur le bébé qui dort. Quand Perla prend dans ses bras le petit, on accompagne lentement ses gestes. Ce qui nous a guidés, c’est qu’il fallait beaucoup de douceur dans les mouvements de caméra. La caméra prend davantage le temps que dans nos films précédents. Nous filmons quelque chose de fragile, de délicat, qui est le lien entre une jeune femme et son enfant, ou qui est l’enfant lui-même dont il faut prendre soin…
Nous avions l’idée que chacune des jeunes mères trouve une porte de sortie, même si cela reste précaire.
L.D.Jean-Pierre Dardenne : Je ne me souviens pas que nous nous soyons dit : pour ce film, nous allons faire des panoramiques. Quand nous écrivions le scénario et au moment des répétitions, nous avions le sentiment que nous allions filmer la fragilité de la vie, et cette fragilité devait être vivante. D’où les panoramiques et les plans fixes. En outre, nous n’avons jamais filmé autant de bébés. Il y en a dans presque tous les plans. La place des bébés est un véritable enjeu de mise en scène. En outre, dans les cadres où une fille est seule avec son bébé, il y a souvent de la place pour la personne qu’elle cherche et qu’elle rencontre parfois.
L. D. : Nous avions la volonté d’être simples. Nous nous sommes rendu compte que nous compliquions trop à l’écriture. Nous avons donc fait machine arrière par rapport à la construction de plans trop élaborés.
Vous avez par le passé parlé de la crainte de vous répéter. Or, Jeunes Mères écarte totalement ce risque. Où, avec ce film, avez-vous le sentiment de vous être le plus renouvelés ?
L. D. : À l’origine, nous avions une histoire à deux personnages : une jeune mère, le personnage principal, vivait dans une maison maternelle – nous n’en avions pas encore visité, nous ne savions pas exactement ce qu’il s’y passait, ce qu’il s’y disait. Cette jeune fille rencontrait un garçon qui, lui, bénéficiait d’un appartement de semi-autonomie
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil