« Collision », choc frontal
Le journaliste Paul Gasnier signe un premier ouvrage sur les dynamiques de la délinquance, son traitement médiatique et un récit intime sur le deuil.
dans l’hebdo N° 1877 Acheter ce numéro

© Francesca Mantovani / Gallimard
Ce n’est ni tout à fait un récit autobiographique ni seulement une enquête socio-journalistique, mais un récit à la croisée de ces approches. À 21 ans, l’auteur, devenu journaliste, perd sa mère à la suite d’une collision entre elle, qui circule à vélo, et un jeune motard de 18 ans en roue arrière sur son motocross. Treize ans plus tard, et alors que ce genre de fait divers fait les choux gras de l’extrême droite, dont il est devenu un fin connaisseur, Paul Gasnier cherche à comprendre les dynamiques sociales qui œuvrent à produire ces drames, loin des stéréotypes faciles et des raccourcis racoleurs.
À travers l’histoire familiale et l’enfance de Saïd, à l’origine de l’accident, une trajectoire se dessine, tout comme, en parallèle, celle de la mère de l’auteur, la jeune rebelle née dans une famille plus traditionnelle. Des dynamiques qui sont comme le fruit de leur époque. L’un et l’autre, chacun à leur manière, sont des « clichés », mêlant facteurs sociaux et un libre arbitre souvent influencé par les pairs et les histoires personnelles.
« [Tout le monde] mène une existence qui raconte quelque chose, et que, la société produisant ses propres dérives, une vie comme celle de Saïd nous raconte », croit l’auteur. Dès lors, la collision était-elle inévitable ? Au gré des entretiens avec les travailleurs sociaux qui ont côtoyé Saïd, de son avocat, du juge et même de sa sœur, la responsabilité apparaît si ce n’est partagée, du moins remise en perspective, à rebours du traitement médiatique mainstream.
Surtout, l’auteur réhumanise, sans complaisance cependant, un archétype, figure désormais honnie : celle de l’enfant d’immigré devenu délinquant multirécidiviste, peu soucieux des institutions. Difficile en effet de ne pas se laisser aller aux conclusions toutes faites que
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

« Trop tard », l’extrême droite à la sauce Popeye

« Chimère », identités contrariées
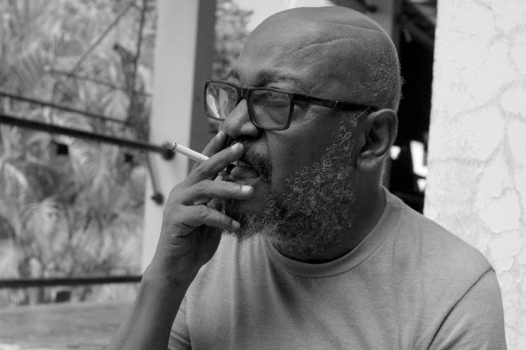
« Bréviaire des anonymes » : possédé par ceux qui n’ont rien







