Nadav Lapid : « Face au feu, le film choisit de sauter à l’intérieur de l’incendie »
Par l’intermédiaire de son protagoniste, un musicien aussi clownesque que corrompu, Nadav Lapid offre, dans son cinquième long métrage, Oui, un portrait de son pays, Israël, carnavalesque et cinglant, qui n’exclut pourtant pas une certaine beauté.
dans l’hebdo N° 1879 Acheter ce numéro

© Les films du losange
Un musicien sans succès et dénué de morale, dénommé Y, va accepter de composer un nouvel hymne pour son pays, Israël, louant la destruction de Gaza et des Gazaouis. Le pitch de Oui, le cinquième long métrage de Nadav Lapid, dit tout de la corruption du personnage, mais peu de la richesse du film, qu’il s’agisse de l’intensité des comédiens (Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis), de l’énergie de la mise en scène ou de la pluralité des sens qu’il charrie. À Cannes, où il n’a mystérieusement pas figuré en compétition mais a été présenté à la Quinzaine des cinéastes, nous avions fait une première approche critique de Oui. En voici une deuxième, au gré d’un entretien avec son réalisateur.
Le protagoniste du Genou d’Ahed, votre précédent film, et celui de Oui sont très différents et même opposés : l’un est furieux contre son pays, le second est un individu qui se dit sans morale. Cependant, les deux se nomment Y. Et le premier a sa mère qui est en train de mourir d’un cancer, tandis que le second s’adresse à sa mère morte. Comment êtes-vous passé de l’un à l’autre film ?
Israël est pionnier quand il s’agit de pénétrer dans l’enfer du monde. Cet état funeste du monde convoque des réponses totales et extrêmes, que ce soit le oui ou le non. Il est juste de mettre en relation ces deux films et leurs deux protagonistes qui sont en opposition totale par rapport à tout et pourtant complémentaires. Le Y du Genou, strict et sérieux, et le Y de Oui, clown sans aucune opinion, ludique et profondément corrompu. Mais, finalement, les deux sont d’abord la conséquence d’une réalité identique. Dans ce sens-là, le oui est la conséquence de l’échec du non du précédent film.
Qu’est-ce que cela veut dire être bon dans un monde mauvais, être ouvert à un monde qui contamine ?
À la fin du Genou, une jeune femme dit à Y : « Sois bon, sois bon ! », et Y pleure. En pleurant, il se débarrasse de ses masques de la colère et du non permanent, et il s’ouvre. On pourrait espérer pour lui une rédemption. Mais il termine dans la soumission. Car qu’est-ce que cela veut dire être bon dans un monde mauvais, être ouvert à un monde qui contamine ? Si tu dis oui à tout, tu deviens comme l’a dit Nietzsche « humain, trop humain ». Comme Y de Oui : il n’y a pas un seul défaut qu’il n’a pas réussi à attraper. Les deux Y font aussi face à une désapprobation céleste sous la forme de leur mère respective, qui vient d’un Israël imaginaire.
Un Israël idéal ?
Oui. Si je le dis en termes politiques : la gauche, minoritaire, en Israël est divisée en deux parties de taille différente. La plus grosse partie vit dans un fantasme du passé qui croit à une sorte de dégradation morale ; l’autre partie, beaucoup plus petite, à laquelle je me sens appartenir politiquement et mentalement, rejette cette nostalgie parce qu’elle est fausse et parce qu’un cinéaste doit faire avec le présent.
Y est sans morale mais pas sans conscience, puisqu’il a conscience de désobéir à sa mère, qui, dit-il, « était écœurée par les larmes de l’occupant » ?
Oui, cette conscience l’accompagne comme une ombre. Ce qui ne l’empêche pas de se corrompre. Mais il a une forme de lucidité. Reprenons la comparaison des deux films. Dans le Genou d’Ahed, Y désire brandir le drapeau de tous les non. Mais se révélera finalement incapable de contrer tout le monde. Quelque chose, malgré lui, l’empêche d’être une figure héroïque. Y de Oui en est l’opposé. Il a pris la décision d’accepter tout : il n’y a pas d’hésitation ou de dilemme chez lui. Mais lui non plus n’est pas capable d’aller jusqu’au bout de la compromission. Quelque chose chez lui l’en empêche : c’est cette conscience et ce côté ludique. Pour être 100 % facho, il faut se libérer du jeu, de cette petite distance ironique qui ne permet pas d’adhérer complètement.
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

« The Mastermind », Apocalypse now
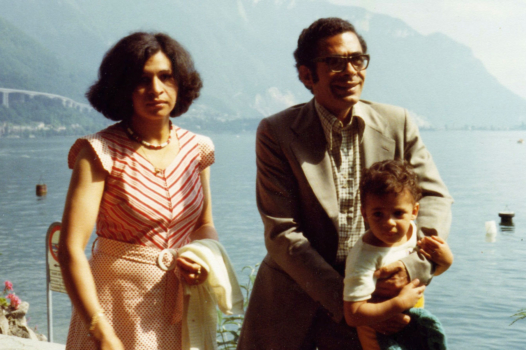
« Me tourner vers mon arabité, c’est recouvrer mon intégrité »

« Promis le ciel », une nécessaire sororité







