Dominik Moll : « Il y a en France une tradition de la police répressive »
Dans Dossier 137, Dominik Moll met en scène une enquêtrice de l’IGPN travaillant sur des violences commises par des policiers sur des gilets jaunes. Rencontre.
dans l’hebdo N° 1889 Acheter ce numéro

© Fanny De Gouville
Après La Nuit du 12, grand succès ayant reçu une pluie de césars, Dominik Moll revient avec Dossier 137, un film dont les protagonistes sont à nouveau des policiers, mais sur un registre plus politique. Le commandant Stéphanie Bertrand, de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), remarquablement interprétée par Léa Drucker, enquête sur des violences commises par des flics sur un garçon qui manifestait avec les gilets jaunes. Un film prenant, qui traite avec une grande honnêteté son sujet, considérant les motivations et les contraintes de tous ses personnages, mais qui prend position. Impeccable.
Pourquoi vous êtes-vous tourné vers le travail de l’IGPN plutôt que de faire un film sur les gilets jaunes ?
Depuis longtemps, l’IGPN éveillait ma curiosité. Sur la police judiciaire, il existe des tonnes de films et de romans, alors que sur l’IGPN il n’y avait rien ou presque. On sait que ses membres sont mal aimés par la police et par une partie des médias qui leur reproche d’être juges et parties. Je me demandais comment, dans cette position inconfortable, ils arrivent à faire, bien ou mal, leur travail.
Davantage que les affaires de corruption, qui restent au sein de la police, je me suis intéressé aux affaires de maintien de l’ordre et de violences policières traitées par l’IGPN parce que ça touche au rapport police-citoyens. Quand j’ai commencé à y réfléchir, nous étions en plein dans les manifestations contre la réforme des retraites de 2023. Mais ce qui m’a donné envie de revenir aux gilets jaunes, ça a été de me rendre compte que ce mouvement, qui a pris tout le monde de cours et ébranlé le pouvoir, a comme été effacé par le covid. C’est comme si un grand coup d’éponge avait été passé : on ne parlait plus des gilets jaunes alors que rien n’avait été réglé.
Vous avez fait un stage d’observation dans un service de l’IGPN. Qu’en avez-vous appris ?
Si je n’avais pas pu faire ce stage, je ne suis pas sûr que je me serais lancé dans ce film. Il me fallait cette vision de l’intérieur. Les échanges que j’ai eus avec les enquêtrices et les enquêteurs de l’IGPN étaient indispensables pour comprendre leur travail. Et pour comprendre qu’il est clair pour eux que les policiers compromis dans les affaires de corruption déshonorent la police. Alors que, dans les affaires de maintien de l’ordre, ils se mettent plus facilement à la place de leurs collègues. Un des enquêteurs dit dans le film : on envoie les flics en première ligne et quand ça se passe mal ce sont eux qui sont pointés du doigt.
Ce n’est pas faux. Par exemple, à propos de l’emploi de la grenade GLI-F4, particulièrement dangereuse : la responsabilité individuelle du CRS qui blesse quelqu’un peut être engagée – on se demandera s’il a agi dans le cadre de la nécessité, de la proportionnalité, etc. Mais la responsabilité des donneurs d’ordre, c’est-à-dire celle de la hiérarchie, qu’elle soit policière ou politique, elle, n’est jamais mise en cause. Cela ne signifie pas que l’IGPN couvre ces affaires. Ses membres enquêtent sérieusement – du moins pour ce que j’en ai vu. Mais on perçoit que c’est plus compliqué dans leur tête.
Il existe une forme de réflexe très partagé dans la police qui consiste à se sentir comme une forteresse assiégée.
Léa Drucker a aussi souhaité rencontrer des enquêtrices de l’IGPN. Elle les a interrogées sur leurs émotions quand elles sont face à un policier arrogant ou, au contraire, en désarroi parce que conscient d’avoir fait une bêtise, ou devant une famille de victime qui vient porter plainte. Elles ont répondu qu’il fallait qu’elles mettent un
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Frederick Wiseman, le documentaire comme œuvre d’art

« Marty Supreme », au service de lui-même
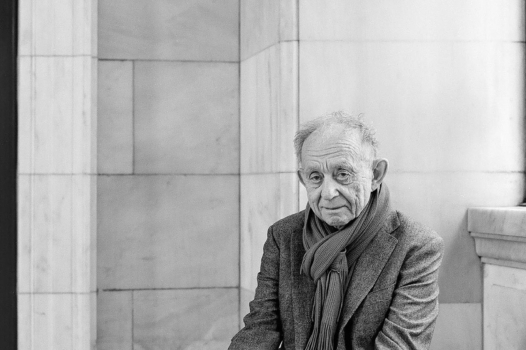
Frederick Wiseman ou l’œil de vérité







