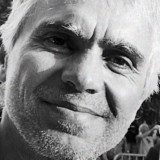Amériques : La voie des femmes autochtones
Plusieurs nominations de femmes issues des Premières Nations à des postes clés montrent un changement de paradigme.
dans l’hebdo N° 1662 Acheter ce numéro

© Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Le Chili nous gratifie de beaux messages d’espoir. Il y a deux ans, la rue avait arraché la promesse de la rédaction d’une nouvelle constitution. Et l’élection des constituant·es, au printemps, a confirmé cette révolution en marche : on redoutait une récupération par la vieille classe politique, ce sont les citoyens indépendants qui ont balayé les partis. Et ils ont élu Elisa Loncón à la présidence de l’Assemblée constituante, figure de l’ethnie mapuche, intraitable défenseuse du droit des minorités autochtones et de la nature.
Lire > « Transformer le Chili en un pays plurinational »_
Deux jours plus tard, Mary Simon, Inuite du Nunavik, était nommée gouverneure générale du Canada par le Premier ministre, en pleine crise des fosses communes d’enfants autochtones.
Lire > Canada : un pas vers la réconciliation avec les Autochtones
Il y a une vingtaine d’années, on voyait le rouleau compresseur de la mondialisation accélérer une inéluctable dissolution des minorités autochtones d’Amérique dans les sociétés dominantes. Et puis il y a eu la rébellion bolivienne, présidée de 2006 à 2019 par le paysan aymara Evo Morales, la poussée des mouvements indigènes en Équateur, où le Cañari Yaku Pérez a frôlé l’accession au second tour de la présidentielle en février dernier.
Ce sont maintenant des femmes qui tracent la voie. À commencer par Deb Haaland, ministre dans le cabinet de Joe Biden, une première pour une femme autochtone. Issue de la tribu Laguna Pueblo, elle est en charge de l’exploitation des ressources naturelles et des terres publiques. Son parcours, marqué par la précarité et l’alcoolisme, est une parabole sur le renversement d’une histoire qui voyait l’époque « achever le travail » inauguré par les premiers massacres d’Amérindiens il y a cinq cents ans.
Lire aussi > Tarcila Rivera Zea : « Les nominations de femmes autochtones sont de vrais progrès »
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Clémence Guetté : « La sortie de l’Otan est nécessaire »

Rome-Tunis-Alger, super gardiens de la forteresse Europe

Au Soudan, le peuple pris au piège de la guerre