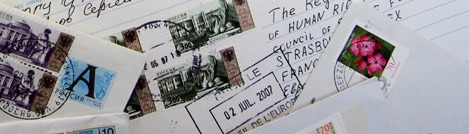Courrier des lecteurs Politis 1016
dans l’hebdo N° 1016 Acheter ce numéro
À propos du Caucase une lettre de Bernard Dréano
L’édito du n° 1015 de Politis (28 août) présente les États-Unis comme deus ex machina de la crise géorgienne, et Mikheïl Saakachvili, instrument de « la main de Washington » jouant « le même rôle que feu Milosevic au Kosovo ». Cette interprétation ne correspond que très partiellement à la réalité et risque d’empêcher de comprendre les mécanismes du conflit et les conditions de sa résolution.
Bien entendu, les États-Unis mènent une politique impérialiste hostile à la Russie, et l’administration Bush considère la Géorgie comme un pion stratégique vis-à-vis du Nord (Russie), mais aussi du Sud (Iran-Irak). Les Américains et les Européens veulent contrôler la production du gaz et du pétrole de l’Asie centrale et de la Caspienne, et son acheminement hors du contrôle russe. Les allégations de Vladimir Poutine concernant une provocation visant « à favoriser l’un des candidats à l’élection américaine » ont peut-être un fondement…
Mais Poutine cherche surtout à exonérer la Russie de sa responsabilité, hier comme aujourd’hui. Le bourreau des Tchétchènes n’est le sauveur des petits peuples du Caucase que quand ça l’arrange. Il ne parle pas d’ailleurs d’autodétermination de l’Ossétie du Nord… Surtout, l’État russe porte une énorme responsabilité dans les origines de ce conflit, quand, en 1991-1993, pendant la guerre civile en Géorgie, les forces armées russes ont soutenu (et même porté à bout de bras) les séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, et contribué à la brutale purification ethnique de l’Abkhazie (la moitié de la population expulsée d’un territoire où les Abkhazes proprement dits ne représentaient que 17 %). Par la suite, le Kremlin a toujours refusé le retour des habitants et les plans de paix internationaux, tout en profitant d’un mandat « d’interposition » militaire lui permettant de peser sur l’indépendance géorgienne.
Quand il a attaqué l’Ossétie du Sud, Saakachvili agissait-il sur ordre pour aider McCain, ou pour lui-même ? Le retrait de la menace russe, qui passe depuis 1993 par la réintégration, sous une forme ou sous une autre, de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, est un impératif pour tout gouvernement indépendant à Tbilissi. Après la « révolution des roses », qu’il est un peu court d’interpréter comme un putsch de la CIA, Saakachvili a multiplié les actions pour récupérer les deux provinces. À chaque tentative, la réaction russe a été plus virulente, les relations russo-géorgienne plus dégradées, les relations américano-géorgiennes plus fortes. Comme chaque été depuis 2004, la tension était vive cette année, et Saakachvili, persuadé du soutien américain, a foncé tête baissée dans un piège.
Nous devons dénoncer la politique occidentale quand elle alimente les tensions dans le Caucase. Mais nous devons aussi exiger des mesures, nécessaires pour tout processus de paix : le retrait des forces russes sur la frontière de la Fédération de Russie, le maintien des forces géorgiennes en deçà des frontières d’Ossétie et d’Abkhazie, l’installation d’une vraie force d’interposition multinationale dans ces territoires, puis le retour des réfugiés dans leurs foyers et le respect des droits nationaux de chaque peuple. Depuis les années 1990, des mouvements des sociétés civiles, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Russie et, dans une moindre mesure, dans le Nord-Caucase se sont efforcés de défendre le respect des droits de chacun pour la paix entre tous. Ces mouvements s’inquiétaient depuis longtemps des bravades nationalistes de Saakachvili, ils constataient aussi l’ampleur des manœuvres poutiniennes contre tous leurs efforts de solution civile sur le terrain. Leurs voix doivent être entendues. Et notamment au prochain Forum social européen de Malmö.
B. D.
-
Bernard Dréano est président du Cedetim (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale) et animateur de l’Assemblé européenne des citoyens (Helsinki Citizens’ Assembly France).
Monnaie et finances
Selon Dominique Plihon, dans sa dernière chronique « À contre-courant », parue dans le n° 1012-14 de Politis, « après le grand cycle de domination des marchés et de la finance, l’heure est venue pour les gouvernements de reprendre la main ». Qui n’en serait d’accord au vu des ravages de l’hypercapitalisme qu’il décrit si bien ?
Mais de quelle reprise en main parle-t-il quand il ajoute : « Ce mouvement a déjà été amorcé avec les aides publiques apportées aux établissements bancaires en faillite… » ? Faut-il comprendre que les gouvernements – c’est-à-dire les contribuables – seront contraints de mettre la main à la poche pour sauver un système qui ne mérite pas de l’être ? Ce n’est, hélas, pas impossible. Ainsi, en fin de cycle, les manipulateurs d’argent auraient raflé la mise – c’est-à-dire acquis un maximum d’actifs réels – et seraient en bonne position pour attaquer le cycle suivant. Ce n’est pas ça que nous voulons.
Or, dans la page courrier du même numéro de Politis, sous le titre « Dette publique », André Ferruit s’étonne, à juste titre, du mutisme général sur les thèses défendues par André-Jacques Holbecq et Philippe Derudder dans leurs ouvrages et sur leurs sites. Pourtant, ce qu’ils disent ne constitue-t-il pas une ébauche de ce que pourrait être une véritable reprise en main de la finance ? Ils réclament ni plus ni moins que l’émission de la monnaie soit sous contrôle des gouvernements et non pas aux mains de banquiers indépendants comme actuellement.
À vrai dire, le terme de « reprise en main » me paraît inadapté ; je préférerais celui de « prise en main ». En effet, la monnaie n’a jamais relevé exclusivement du pouvoir politique. Quand elle était d’or ou d’argent, il n’était pas possible de l’« inventer ». Monarques et républiques « battaient monnaie », c’est-à-dire la mettaient en forme, mais, en cas de manque de matière, étaient obligés d’en emprunter. Cependant, depuis bientôt quarante ans que le président Nixon a aboli la convertibilité du dollar, toutes les monnaies du monde ne sont plus que des symboles. Est-ce à dire qu’il faudrait revenir à la matérialité de l’or comme certains l’imaginent ? Si nous ne voulons pas ajouter aux guerres du pétrole celles des métaux précieux, mieux vaut s’en abstenir. Ne pourrions-nous, au contraire, prendre acte de cette fabuleuse nouvelle et en tirer les conséquences : la monnaie n’a aucune existence physique ; elle n’est que l’organisation des échanges économiques. Chaque société a donc toute liberté de s’organiser, d’émettre et de réguler sa propre devise. En un mot, le pouvoir monétaire reste à conquérir par les démocraties.
Propos extrêmes et utopistes, diront certains. Ne serait-ce pas plutôt une mise en cohérence de nos pratiques avec nos principes ? Il ne faut pas croire qu’Holbecq et Derudder soient isolés. Aujourd’hui, il existe en France, mais aussi en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et probablement ailleurs, tout un courant de pensée, certes minoritaire mais réel, qui va dans leurs sens. Cette contestation du crédit bancaire créateur de monnaie existe depuis plus d’un siècle, mais ce processus est si mal connu qu’aujourd’hui encore, et très curieusement dans les milieux financiers, il est courant de l’ignorer, quand tout simplement on ne le nie pas.
Cette affaire est trop sérieuse par les intérêts qu’elle met en cause et les perspectives qu’elle ouvre. Politis et d’autres devraient s’emparer de ce sujet tabou.
Jean Jégu, Igny (Essonne)
Politis a depuis, dans le n° 1015, consacré un article au livre d’André-Jacques Holbecq et Philippe Derudder, la Dette publique (p. 15)
L’entêtement nucléaire
Le dossier de Politis paru le 10 juillet et intitulé « L’illusion nucléaire » se conclut par cette phrase de Patrick Piro : « L’entêtement nucléaire est d’abord une question politique. »
Alors que nous travaillons, au Réseau Sortir du nucléaire, à la rédaction d’une plaquette sur le plutonium et le retraitement, nous nous demandons la raison de l’entêtement du lobby nucléaire à retraiter le combustible. Le prétexte officiel est de réduire le volume des déchets (ce qui est faux), mais tout le monde sait qu’il s’agit d’extraire 1 % du plutonium contenu, exclusivement, dans le combustible après utilisation dans les réacteurs nucléaires. Devant les difficultés et l’échec économique de la filière du plutonium, nous n’avons trouvé, comme justificatif, que l’argument de la stratégie militaire. Le plutonium disponible seulement dans le combustible usé est indispensable au maintien de la force de dissuasion nucléaire. Les quelque 250 têtes nucléaires installées sur les avions Mirage et les sous-marins nucléaires contiennent environ six kilos de plutonium chacune, soit au total 1,5 tonne. En cas de guerre nucléaire, il faut pouvoir renouveler ce stock. Or EDF donne, par an, 850 tonnes de combustible à retraiter à La Hague pour en extraire 8,5 tonnes de plutonium. Cela justifie le maintien à tout prix de la disponibilité des usines de La Hague et, qui plus est, du fonctionnement et du renouvellement des 58 réacteurs d’EDF. Ce choix stratégique du gouvernement français justifie l’installation du retraitement en un lieu facile à protéger, comme le Nord-Cotentin, et aussi la concentration des lieux de production du combustible usé contenant le plutonium dans seulement 18 sites en France. C’est ainsi qu’EDF contribue à la valorisation de la force de frappe nucléaire que le président Sarkozy propose actuellement à l’Europe. Patrick Piro a raison, le « renouveau » du nucléaire évoqué par ses promoteurs n’est qu’une illusion, mais il permet de justifier le maintien en fonctionnement des réacteurs vieillissants et la construction de nouveaux EPR. Les Français se laisseront-ils encore longtemps bercer par ces illusions ?
Jean-Pierre Morichaud, Vert
en Drôme-Ardèche
Tensions sur l’environnement
Depuis la Déclaration du Club de Rome de 1972 – « Halte à la croissance » –, les mises en garde et les signaux d’alerte se sont succédé. […] Il est aujourd’hui presque unanimement admis que les limites écologiques ne permettent plus un dévelopement sans bornes, sauf à mettre en danger les possibilités mêmes d’existence sur la planète.
Au cours des trente dernières années, le système capitaliste néolibéral a essaimé, et a été adopté par la plupart des pays […]. Face à l’émergence des questions environnementales et à l’obligation de remettre profondément en cause les notions de progrès et de croissance, que signifie la fuite aveugle en avant d’un système inégalitaire et écologiquement destructeur ?
La simultanéité, le parallélisme des deux évolutions fait s’interroger : s’agit-il simplement d’une concordance chronologique ? Ou bien l’engouement quasi général pour le néolibéralisme ne traduit-il pas une réaction régressive, une forme moderne de retour primitif à la loi du plus fort ?
Il est en tout cas indiscutable que la majorité des populations n’a pas pris la mesure des changements de mode de vie qu’implique la sauvegarde des bases naturelles de la vie.
Parmi le foisonnement d’idées et de propositions qui émanent des milieux alternatifs, il en est qui sont peu reprises. Comme le revenu maximum autorisé, défendu notamment par le politologue Paul Ariès, les sociologues Alain Caillé et Philippe Corcuff, et le journaliste Hervé Kempf, qui a aussi été approuvé par Geneviève Azam, Olivier Besancenot et Pierre Khalfa dans une tribune parue dans la revue la Décroissance (en février 2008). Sa mise en œuvre paraît toutefois aujourd’hui à ce point utopique qu’elle ne fait l’objet d’aucune popularisation.
Une démarche alternative ne peut pourtant faire l’économie d’une réflexion à ce sujet : l’attribution de revenus trop forts revient à fournir un pouvoir économique hors de tout contrôle démocratique ; elle permet un accaparement, voire une dilapidation de ressources utiles à tous ; par le jeu du mimétisme […], elle répand les valeurs de consommation ostentatoires et de gaspillage.
Lorsqu’on entend parfois dire : « Il ne faut surtout pas que toutes les populations du monde consomment comme nous (Européens) ou comme les Etats-Unis, il faudrait alors plusieurs planètes », cela revient en fait à ignorer les déclarations et chartes de droits de l’homme qui proclament l’égalité des êtres humains. Dans un monde aux ressources limitées, toute surconsommation des uns se fait au détriment des autres. […]
Non seulement la réduction de notre empreinte écologique est vitale sur le plan environnemental, mais elle devient incontournable pour des relations équilibrées entre pays et régions du monde. […]
Serge Seninsky
Pour aller plus loin…

Pont de Gênes : le cri de colère du grand-père d’une victime

Courrier de lecteur : Nos aînés dépendants méritent mieux

Courrier de lecteur : un ami de Mireille Knoll témoigne