Réfugiés : un harcèlement sans fin
Le cynisme récurrent des forces de l’ordre devient insupportable pour ces riverains solidaires du XVIIIe arrondissement de Paris.
dans l’hebdo N° 1439 Acheter ce numéro

Comme chaque matin de la semaine, les enfants se rendent à l’école Pajol, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Comme chaque matin, des migrants dorment comme ils peuvent sur le trottoir d’en face, et des bénévoles leur servent un petit-déjeuner grâce à l’opération « Café solidaire ». Mais le vendredi 27 janvier, c’est un autre genre d’opération qui a eu lieu. Sous les yeux des enfants, des policiers en civil – essentiellement des femmes – et d’autres plus équipés, affublés souvent du surnom de « Robocops », ont embarqué une quinzaine de réfugiés. « On va leur donner à manger et des papiers ! », a riposté un policier aux parents d’élèves indignés.
Si l’intervention n’a pas été musclée, le cynisme récurrent des forces de l’ordre devient insupportable pour ces riverains solidaires. Car la destination de la fourgonnette était bien le commissariat. Depuis, les mineurs auraient été relâchés et les adultes auraient reçu une OQTF (obligation de quitter le territoire français).
« Au-delà de l’incompréhension soulevée par l’absence de réponse politique à cette situation qui dure depuis maintenant plusieurs années et du caractère inadmissible de cette stratégie de harcèlement dont font l’objet les migrants dormant dans nos rues, il est insupportable que de telles opérations aient lieu, encore plus devant une école à l’heure de l’accueil des enfants », écrit Benoît Lochon, président de l’association Quartiers solidaires. Un éternel recommencement à la halle Pajol, laquelle avait vu s’installer le premier campement parisien de migrants en 2015, violemment évacué. C’est là aussi que des policiers confisquaient les couvertures des réfugiés lors des nuits glaciales début janvier.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

En CRA, le double enfermement des personnes psychiatrisées
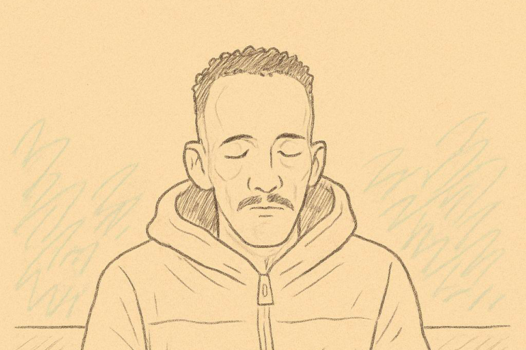
Ahmed N. voulait « soigner sa tête » : à Calais, les exilés abandonnés face aux souffrances psychologiques

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »








