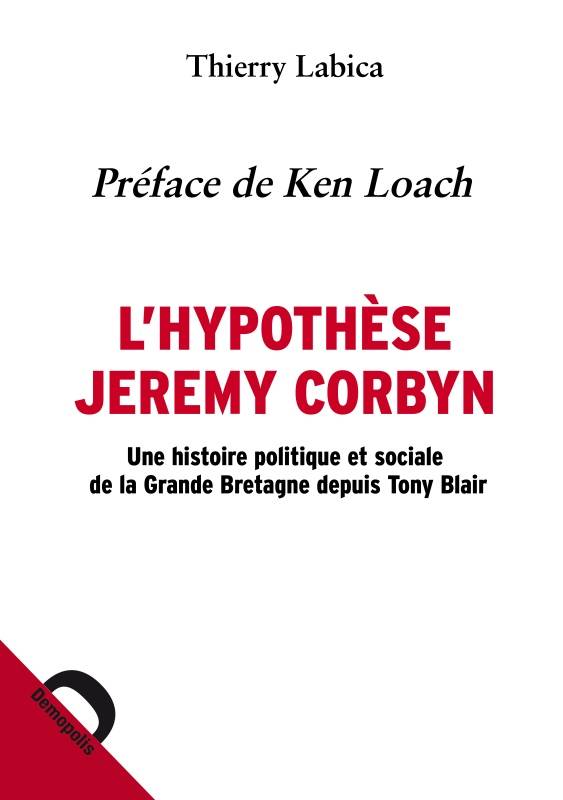« Liz Truss est l’agente de l’accaparement des ultrariches »
Thierry Labica, enseignant spécialiste en études britanniques à Nanterre, décrypte le déni de réalité manifesté par la nouvelle Première ministre britannique, alors qu’un mouvement social sans précédent agite le pays.
dans l’hebdo N° 1723 Acheter ce numéro

Le paradoxe restera sans doute dans l’histoire : la plus mal élue des Prime Minister du Royaume-Uni, Liz Truss, aura été l’ultime cheffe de l’exécutif à avoir rencontré la reine Élisabeth II pour prendre ses fonctions, deux jours à peine avant le décès de celle-ci, après un règne de soixante-dix ans. Une souveraine dont la fonction même garantit a priori la stabilité et le bon fonctionnement du système constitutionnel, démocratique (et très parlementaire) outre-Manche.
Or la nomination de Liz Truss au 10 Downing Street n’a été acquise qu’avec les suffrages de moins de 0,2 % des électeurs britanniques, quand celle-ci multiplie les prises de position outrancières à l’encontre des sujets les plus défavorisés de Sa Gracieuse Majesté, dans un contexte d’hyperinflation, notamment des tarifs de l’énergie ou de l’eau, en prônant une politique ultralibérale. Mais aussi en affichant toujours plus de mépris vis-à-vis des autres nations composant le Royaume-Uni, telles l’Écosse et l’Irlande du Nord.
Si les forts mouvements sociaux de ces derniers mois connaissent une pause (volontaire) du fait du décès de la reine, Liz Truss n’y répond pour l’instant que par une surenchère dédaigneuse jusque dans les nominations de ses proches collaborateurs et ministres. Thierry Labica, enseignant spécialiste en études britanniques à l’université Paris-Nanterre (1) analyse ce déni de réalité sociale et politique de la part du nouveau gouvernement tory. Un aveuglement qui s’apparente à une fuite en avant vers toujours plus d’inégalités et d’autoritarisme.
La mort d’Élisabeth II peut-elle signifier la fin de la monarchie ?
Thierry Labica : Assurément non, puisque la reine décédée a bien un successeur, désormais Charles III. Toutefois, la monarchie ne se porte pas au mieux, après un règne où Elizabeth II a réussi à incarner durant soixante-dix ans une institution stable et honorable. Aujourd’hui, c’est loin d’être le cas, avec notamment un prince Andrew (frère du nouveau roi) impliqué dans les scandales de pédophilie et d’abus sexuels de l’affaire Epstein, et le couple Harry et Meghan qui a fait sécession du Palais. Donc les affaires familiales ne vont pas très fort, également parce que l’unité du Royaume-Uni, normalement représentée par l’unité de la famille royale, déjà fragile, est sous le coup de forces centrifuges.
Et c’est un peu la même chose pour le Commonwealth. La nouvelle Première ministre ultralibérale et conservatrice, Liz Truss, a multiplié les déclarations outrancières expliquant qu’il fallait « ignorer » (sic) Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise indépendantiste, pourtant élue et réélue avec de fortes majorités. Pour l’Irlande du Nord, c’est encore plus violent, puisque, comme l’Ulster a pour la première fois donné vainqueur le Sinn Féin, parti réclamant son rattachement à la République d’Irlande, Liz Truss veut remettre en cause l’application de l’accord du Vendredi saint de 1998 (2), qui a mis fin au conflit armé long de trois décennies. Elle donne donc du grain à moudre aux nationalismes écossais et nord-irlandais, ce qui ne va pas vers l’unité nationale.
C’est vraiment un gouvernement de combat de la frange la plus à droite des parlementaires du Parti conservateur.
Enfin, je voudrais rompre un peu avec la présentation des médias français d’une immense émotion populaire autour de la mort de la reine. Il n’y a pas tant de personnes qui sont vraiment émues par ce décès. Déjà, en juin, pour le jubilé des soixante-dix années de règne, une part significative de la population britannique était indifférente, sinon hostile – sans parler des Écossais, des Gallois ou des Nord-Irlandais.
Je rappelle que le républicanisme est un mouvement assez fort outre-Manche, avec une longue histoire. Mais les médias français (et d’ailleurs) aiment à présenter l’Angleterre comme un mix de tradition et de modernité, mêlant châteaux et famille royale avec les cartes postales du « cool » anglais (ses cabines téléphoniques rouges, les Beatles et les black cabs…). Or, en ce moment, le pays connaît surtout un mouvement social sans précédent et il serait surprenant qu’il s’arrête soudainement. Même si Liz Truss va à coup sûr essayer d’exploiter le deuil royal, en présentant les grèves comme indignes dans le contexte actuel.
Qui est entré au gouvernement ? Celui-ci répond-il aux aspirations des Britanniques et à ce moment de deuil royal ?
Assurément non. C’est vraiment un gouvernement de combat de la frange la plus à droite des parlementaires du Parti conservateur. On aurait pu penser que la nouvelle locataire du 10 Downing Street allait constituer un exécutif pour soutenir l’unité nationale en ce moment « exceptionnel » et faire un effort dans le sens de la redistribution, s’inscrivant ainsi dans la vieille tradition compassionnelle des conservateurs.
Boris Johnson a lui-même un peu joué de cette fibre pendant le covid. Par exemple, pour tenter d’affirmer un consensus national et social, en répondant au moins à la demande largement partagée dans la population de taxes exceptionnelles sur les profits (énormes) des compagnies d’énergie. Mais pas du tout ! Liz Truss a délibérément refusé, en usant de l’argument ultra-éculé que cela ferait fuir les investisseurs étrangers et réduirait la compétitivité des entreprises britanniques. Au contraire, elle ne parle que de défiscalisation, de réductions d’impôts pour les entreprises et de mesures classiquement néolibérales. La constitution de son gouvernement illustre d’ailleurs parfaitement ses volontés en ce sens.
Son principal conseiller économique explique que le réchauffement climatique va profiter à l’agriculture britannique, comme en Sibérie !
Quelques noms seulement. Son principal conseiller économique, Matthew Sinclair, est l’un des fondateurs de l’Alliance des contribuables, un think tank très à droite, très anti-impôts, qui veut d’abord la suppression de la contribution fiscale « verte ». Sans être vraiment climatosceptique, il tient plutôt des discours expliquant que le réchauffement climatique va profiter à l’agriculture britannique, comme en Sibérie ! Le ministre des Entreprises, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, Jacob Rees-Moog, archi-brexiter et climatosceptique, est un défenseur affirmé des mégaprofits des entreprises de l’énergie, contre toute taxation exceptionnelle de ceux-ci, et hostile aux énergies renouvelables puisqu’il a voté contre toutes les mesures destinées à combattre le changement climatique.
Le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, est résolument pro-gaz de schiste et en faveur des dérégulations. Enfin, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a été un soutien du projet de déportation au Rwanda des réfugiés pour qu’ils y fassent leurs demandes d’asile et est partisane… de la sortie de Convention européenne des droits de l’Homme !
Bien qu’elle soit souvent présentée ainsi dans les médias, vous ne partagez pas ce sentiment que Liz Truss serait la « Margaret Thatcher 2.0 »…
Certes, la comparaison est assez tentante. Surtout dans le contexte actuel d’accroissement des inégalités et d’hyperinflation, on ne peut pas s’empêcher de faire le rapprochement avec ses récents propos antisyndicaux ou voulant interdire les grèves. On peut penser qu’elle a une volonté délibérée d’imitation, en s’habillant un peu de la même façon, en cultivant un style oratoire assez proche, aussi bien dans le ton que dans la violence outrancière de ses propos. Je ne sais pas si la comparaison est heureuse ou intéressante, mais elle cherche en tout cas clairement à flatter la frange la plus dure et la plus droitière du Parti conservateur, qui a été le seul à la désigner.
Mais, alors que Margaret Thatcher arrivait au 10 Downing Street après avoir gagné (souvent largement) les élections législatives – à trois reprises –, Liz Truss ne devient, elle, Première ministre de la cinquième économie du monde qu’avec les suffrages de moins de 0,2 % de la population du Royaume-Uni ! En effet, elle n’a jamais été désignée que par les seuls adhérents du Parti conservateur (160 000 personnes), dont elle n’a remporté que 57 % des suffrages, soit à peine plus de 90 000 voix, pour une population de 68 millions de personnes. Et dans l’opinion publique, selon les sondages, elle a environ 53 % d’opinions défavorables.
Cet été, la majorité conservatrice à la Chambre des communes a voté une loi qui autorise les entreprises à embaucher des intérimaires et des chômeurs pour briser les grèves et remplacer les travailleurs.
D’un point de vue démocratique, il y a donc un problème majeur. Mais ses déclarations contre les droits sociaux et syndicaux, pourtant déjà considérablement réduits depuis quarante ans, accroissent encore plus ce problème démocratique. En effet, cet été, la large majorité conservatrice à la Chambre des communes a voté une loi qui autorise les entreprises à embaucher des intérimaires et des chômeurs pour briser les grèves et remplacer les travailleurs qui ont cessé le travail – ce qui était interdit jusqu’ici. C’est bien là une nouvelle attaque majeure contre les droits démocratiques. Et c’est aussi une grave question de sécurité puisque les métiers des industries de l’énergie, de la santé, de l’éducation ou celui de conducteur de train ne s’apprennent pas en quelques heures !
Ceci intervient après un affaiblissement majeur des syndicats depuis la période Thatcher, puisqu’en quarante ans ils ont perdu plus de 50 % de leurs membres (passant de près de 13 millions à moins de 6 millions) ! Mais ils sont affaiblis aussi du point de vue des réglementations de l’action syndicale, puisqu’il est extrêmement difficile d’organiser une grève outre-Manche, les syndicats ne pouvant, grosso modo, que transmettre de l’information ou être dans la cogestion. Mais pas plus. On peut donc choisir cette analogie avec Thatcher, puisque les syndicats ont le droit d’exister, en gros, tant qu’ils ne bougent pas.
Elle semble ainsi en profond décalage avec la population mais même avec la base de l’électorat conservateur. N’est-elle pas dans une sorte de déni de réalité, notamment quand on voit les forts mouvements sociaux qui semblent assez soutenus par l’opinion ?
En effet. Les récentes études d’opinion montrent qu’une large majorité de la population est par exemple favorable à des nationalisations des secteurs de l’énergie, encore plus de la santé, de l’eau ou des transports publics. Même dans l’électorat conservateur, celui qui a voté pour Boris Johnson en 2019, une large majorité (53 %) est pour la nationalisation de ces secteurs d’activité. Concernant celui de la santé, 78 % des Britanniques dans leur ensemble souhaitent sa nationalisation. Ce qui signifie que Liz Truss n’est même pas en phase avec la grande majorité de ses soutiens électoraux, dans un contexte d’augmentation drastique des tarifs de l’électricité et du gaz (puisqu’ils ont crû de 54 % en avril et qu’ils doivent augmenter de 80 % le 1er octobre, puis encore de 50 % en janvier prochain).
Liz Truss semble sortie d’un roman de Charles Dickens, avec sa violence méprisante et sa méchanceté pour le peuple.
Outre le mépris pour les gouvernements élus d’Écosse et d’Irlande du Nord, Liz Truss rompt aussi par son style avec Boris Johnson : celui-ci pouvait mentir, jouer d’approximations, mais il semblait être une sorte d’aristocrate conservateur excentrique sorti d’une comédie anglaise un peu acide. Liz Truss, ce n’est pas du tout cela, elle serait plutôt sortie d’un roman de Charles Dickens, avec sa violence méprisante et sa méchanceté pour le peuple.
Quant à votre question sur un déni de réalité, on a l’impression qu’elle est un peu hors sol par rapport à l’opinion et aux électeurs conservateurs. Rien de ce qu’elle a proposé ne semble à la hauteur de la crise que traverse l’Angleterre, déjà lacérée par des problèmes sociaux anciens et une pauvreté croissante, mais c’est maintenant la classe moyenne qui va devoir choisir entre payer son loyer, se chauffer ou aller au supermarché.
Depuis le début de l’été, l’inflation des produits de consommation courante a atteint près de 11 %, et maintenant le gaz et l’électricité augmenteront de 80 % en octobre. Ce qui signifie que des gens vont consacrer 50 % ou 60 % de leurs revenus à payer leurs factures d’énergie, sans parler évidemment des conséquences pour les entreprises. La situation est donc explosive. Et tout aussi dramatique est la déconnexion entre les propositions de Liz Truss et le contexte social.
Un contexte social marqué par des inégalités criantes au Royaume-Uni…
Toute la politique des conservateurs, sans même remonter à la période Thatcher, a consisté à favoriser la concentration des richesses : l’austérité après la crise de 2008, le Brexit, puis la pandémie et maintenant la crise des prix de l’énergie, outre la guerre en Ukraine qui interagit avec tout cela, en attestent. Je dirais même qu’elle a été une politique d’accaparement des richesses par quelques-uns, à un niveau jamais observé. Et Liz Truss est bien l’agente de cette politique-là.
On a distribué 1,1 milliard de livres sterling aux actionnaires des entreprises d’eau, au moment où l’on dit aux gens qu’ils ne doivent plus arroser leur jardin pour économiser cette ressource !
Le Sunday Times publie chaque année la liste des plus grandes fortunes du pays. Or on note cette année que les 250 plus grandes fortunes totalisent une fortune plus importante que les 1 000 les plus possédantes il y a cinq ans. L’un des plus importants syndicats, Unite, a publié un rapport au début de l’été qui indiquait que les profits des 350 plus grandes entreprises du pays étaient supérieurs de 73 % après le covid qu’avant la pandémie. Les revenus des dirigeants des grandes entreprises ont augmenté en moyenne de plus de 25 %.
Hyperinflation : la charité pour seule réponse
D’ici à quelques mois, voire quelques semaines, nombre de ménages britanniques se verront contraints de choisir entre payer leur loyer, leurs courses au supermarché ou leurs factures de gaz et d’électricité. L’inflation, déjà à deux chiffres, devrait en effet atteindre début octobre le taux prohibitif de 80 % en ce qui concerne les tarifs de l’énergie. Dans cette situation socialement explosive, alors que la nouvelle locataire du 10, Downing Street, Liz Truss, n’évoque en réponse que d’hypothétiques baisses d’impôts, certaines initiatives semblent nous ramener à l’époque de Dickens. Ainsi, un très populaire jeu télévisé « offre » désormais à ses gagnants de régler « leurs quatre prochains mois de factures d’électricité ». Quant à Lord Benyon, député tory propriétaire d’un domaine de 56 km2 entourant son château multiséculaire, la société gérant son immense parc de propriétés immobilières à Londres, bien consciente que « les temps sont durs », vient (généreusement) d’accompagner les avis d’augmentation annuelle des loyers adressés à ses locataires de… la liste des banques alimentaires opérant dans leur quartier. Un geste « social »… O. D.
Je précise tout cela, car il ne s’agit pas uniquement des superprofits des seules grandes compagnies du secteur de l’énergie, comme on l’entend trop souvent. Même les sociétés de distribution d’eau accumulent des profits énormes, dans une gabegie incroyable, puisque des milliards de litres sont perdus chaque semaine du fait d’un réseau mal entretenu avec des fuites partout ! Et on a distribué 1,1 milliard de livres sterling aux actionnaires des entreprises d’eau, au moment où l’on dit aux gens qu’ils ne doivent plus arroser leur jardin pour économiser cette ressource !
La dureté du ton de Liz Truss et de son discours antisyndical, c’est la dureté nécessaire au maintien de cette politique qui ne va que se renforcer, au prix de crises graves. La dureté nécessaire pour défendre un système qui est juste indéfendable, et ce au sein même de sa base électorale.
C’est ce qui explique que les mouvements sociaux actuels, inédits depuis des décennies, sont populaires dans l’opinion. Est-ce que le Parti travailliste s’en trouve renforcé ?
En juin, dès les premiers jours de la grève (dans les transports et dans les ports surtout), après quelques déclarations très directes des leaders syndicaux, l’opinion publique a très vite soutenu le mouvement social. Cela se voit dans des émissions télévisées très populaires, pas franchement gauchistes, où s’exprime une grande compassion pour des gens qui, littéralement, ne pourront plus manger. J’ai même vu un titre du Financial Times qui indiquait que la renationalisation de l’eau ne coûterait « que » 14,6 milliards !
Ainsi, les intervenants dans le champ médiatique sont partis sur un discours classique antisyndical, mais ils ont rapidement dû modérer leur ton, avec une vision compassionnelle. Il existe donc un climat défavorable pour Liz Truss. Avec une hausse énorme des distributions de colis alimentaires, et des instituteurs qui transforment après la classe leurs écoles en une sorte de centre des Restos du cœur, où l’on distribue des produits d’hygiène pour les enfants, mais en réalité pour toute leur famille.
Les liens entre les syndicats et le Parti travailliste sont très distendus, comme en témoignent la réduction de leurs donations au parti ces dernières années.
Quelle a été la réaction du Parti travailliste ? Je rappelle que la direction, après s’être débarrassée de Jeremy Corbyn, n’a cessé de mener une sorte de chasse à toute sensibilité de gauche dans le parti. Jusqu’à exclure Ken Loach (qui avait, comme au moins 400 000 personnes, rejoint le parti avec Corbyn), alors qu’ils tenaient là une figure célèbre et médiatique assez exceptionnelle… Quant aux syndicats (qui sont les premiers donateurs financiers du parti depuis toujours), leurs liens avec le Labour sont très distendus, à nouveau, à commencer par la réduction importante de leurs donations au parti ces dernières années.
Dès le début des grèves, chez British Airways, dans les transports et les ports, la première déclaration de la direction du Labour a été d’interdire la présence d’élus travaillistes sur les piquets de grève. L’un d’eux a bravé l’interdiction et il a été viré ! Leur réflexe a été de dire : nous sommes un parti de gouvernement, nous n’avons rien à faire avec les grévistes, car l’opinion publique va être contre. Or c’est le contraire qui s’est produit.
En outre, partout où il y a des augmentations de salaires affichées, de 2 ou 3 %, ce sont en fait des baisses effectives (de 8 ou 9 %), puisque l’inflation, sans même parler des prix de l’énergie, s’élève maintenant à 11 %. Tout le monde comprend cela, sans être économiste ! La réaction instinctive du parti contre la grève n’a pas été propice à faire remonter sa cote dans l’opinion.
Quant aux nationalisations, auxquelles les gens sont favorables depuis des années, on aurait souhaité que les dirigeants travaillistes adoptent une position « opportuniste » face à l’opinion. Mais non. Ils continuent à tenir un discours embarrassé, sans arriver à se déclarer en faveur des nationalisations !
La direction du Labour exprime une sorte de superstition qui voudrait qu’afficher un soutien au mouvement social lui ferait perdre des voix.
Il a fallu attendre le milieu de l’été, puisque les mouvements ne s’estompaient pas (et même certains d’entre eux, locaux, comme celui des éboueurs de certaines villes, ont réussi à obtenir des augmentations de salaires de 10 %), pour que la direction travailliste infléchisse son discours. Voyant cette forte dynamique des mobilisations sociales et les menaces sur les prix se préciser, elle s’est sentie obligée de déclarer que les travaillistes étaient « bien sûr » du côté des grévistes, mais qu’appartenant à un parti de gouvernement ils se doivent d’observer un certain conformisme et de faire montre d’une respectabilité nécessaire.
Ils expriment là cette sorte de superstition qui voudrait qu’afficher un soutien au mouvement social leur ferait perdre des voix. Alors que, à la différence du PS de l’époque Hollande et Valls, qui tenaient les mêmes propos, le Labour a fait l’expérience, à l’époque de Corbyn, du fait que des positions, non pas révolutionnaires, mais vraiment favorables aux aspirations populaires avaient multiplié par quatre son nombre d’adhérents, et qu’en 2017 il a connu sa plus forte progression électorale depuis 1945. Jusqu’à manquer de remporter le poste de Premier ministre (pour Corbyn) à quelques milliers de voix près. Or le Labour, cet été, était encore derrière les conservateurs dans les sondages.
Évidemment, maintenant, vu la situation économique, et encore plus avec Liz Truss, les choses sont sans doute en train de changer. Mais la possibilité de leur succès électoral ne doit rien à leur propre mérite…
(1) Dernier ouvrage paru : L’hypothèse Jeremy Corbyn. Une histoire politique et sociale de la Grande-Bretagne depuis Tony Blair, Demopolis, 2019.
(2) Après des décennies de conflit armé ayant causé des milliers de morts, les catholiques (et, derrière le Sinn Féin, l’IRA), favorables au rattachement avec l’Irlande, et les unionistes protestants (anglicans), pour le maintien dans le Royaume-Uni, ont signé un accord dit « du Vendredi saint », le vendredi de Pâques 1998, organisant un partage du pouvoir entre les deux parties : le Premier ministre à Belfast, issu du parti vainqueur des élections, sera secondé par un vice-Premier ministre issu de l’autre communauté. Cet accord demeure, depuis, un modèle de résolution des conflits armés, internationalement reconnu.
Pour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international