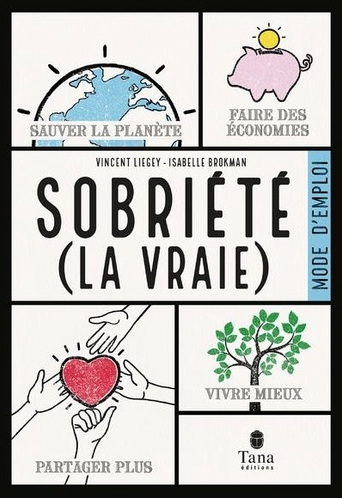« Je défends une sobriété joyeuse et émancipatrice »
L’ingénieur et essayiste Vincent Liegey publie, avec la journaliste Isabelle Brokman, « Sobriété (la vraie) », un guide d’alternatives pour un mode de vie pesant moins sur la planète. Il rappelle le véritable projet qu’il sous-tend : une société de la décroissance.
dans l’hebdo N° 1749 Acheter ce numéro

Sobriété (la vraie), mode d’emploi. Vincent Liegey et Isabelle Brokman, Tana éditions, 96 pages, 13,90 euros.
Né en 1979 à Besançon, Vincent Liegey a une formation d’ingénieur. Après plusieurs années à la tête de la sécurité ferroviaire de la gare d’Austerlitz, à Paris, il s’installe à Budapest en 2011. Pendant quatre ans, il travaille comme responsable du débat d’idées à l’ambassade de France. En 2015, il fonde avec quatre amis Cargonomia, un projet de livraison de nourriture en vélo cargo, véritable espace d’expérimentation de la décroissance.
On entend surtout parler de sobriété depuis la hausse du prix de l’énergie, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais d’où vient cette notion historiquement ?
Vincent Liegey : La majorité des civilisations humaines ont vite compris que le bonheur et la liberté ne peuvent se construire que si l’on est capable de faire preuve de tempérance, de s’auto-instituer des limites. L’exception, c’est notre société occidentale, qui a oublié cette précondition, notamment depuis la révolution industrielle, qui a conduit à l’utilisation des énergies fossiles.
En l’espace de cent cinquante ans, plusieurs générations ont eu accès à une quantité d’énergie monstrueuse et ont pu façonner nos environnements, imposer par la violence notre modèle de société. Une société de surabondance, frustrée, construite autour du consumérisme, de la publicité et de la croissance.
Depuis plusieurs années, nous avons vécu des chocs qui sont à la fois des accélérateurs et des révélateurs. La pandémie de covid a mis en évidence les défaillances d’un système où les chaînes de fabrication et d’approvisionnement font le tour du monde. Il suffit d’un grain de sable dans l’engrenage pour se rendre compte qu’on n’est plus capable de fabriquer des médicaments de base en Europe, par exemple.
C’est par la contrainte que nous sommes revenus à la notion de sobriété, sous forme d’austérité imposée pour les plus pauvres.
De la même manière, la guerre en Ukraine a été un accélérateur et un révélateur de phénomènes déjà en cours : la fin du pétrole et du gaz peu chers et faciles d’accès. Nous avons pris conscience que nos économies étaient totalement dépendantes de ces ressources que nous ne possédons pas dans l’Union européenne. Finalement, c’est par la contrainte que nous sommes revenus à la notion de sobriété, sous forme d’austérité imposée pour les plus pauvres. De mon côté, je défends une vision de la sobriété joyeuse et émancipatrice.
La définition de la sobriété est très liée à celle de la décroissance. La première notion est employée jusque dans le discours du gouvernement, mais la seconde est toujours méprisée. Comment expliquer ce décalage ?
Dans son discours d’annonce du plan de sobriété énergétique, Élisabeth Borne avait été très claire : la sobriété prônée par le gouvernement n’est surtout pas la décroissance ! Le sens du mot « sobriété » est récupéré et dévoyé pour préparer les plus pauvres à une forme d’austérité subie. Au contraire, si un projet sérieux et émancipateur de sobriété était mis en place, il impliquerait davantage de partage et s’appliquerait donc d’abord aux plus riches. Mais faire moins pour redistribuer plus, ce n’est pas du tout dans le logiciel politique des dirigeants français.
L’autre problème, c’est qu’on a donné l’impression que cette crise était passagère, qu’il suffirait de se serrer la ceinture quelques mois en attendant le retour de la croissance. Mais tous les travaux élaborés depuis des années montrent que nous sommes à la fin de ce modèle civilisationnel organisé autour du « toujours plus ». Nous avons déjà dépassé un certain nombre de limites planétaires (1). Au-delà d’être nécessaire, la sobriété est inéluctable. Mais je pense qu’elle est aussi souhaitable, à condition qu’elle soit portée politiquement dans le bon sens : faire moins, faire mieux et surtout partager plus.
Les limites planétaires sont les seuils que l’humanité ne doit pas franchir pour garantir la stabilité et la préservation de l’écosystème terrestre. Sur neuf limites définies, six ont déjà été dépassées.
C’est pour cette raison que je reste attaché au mot « décroissance » : il s’attaque directement dans sa sémantique au cœur idéologique du système dominant. On voit aujourd’hui comment la sobriété a pu être récupérée par la communication présidentielle et celle des entreprises. Au moment où la sobriété est devenue un mot médiatique, on a même entendu Geoffroy Roux de Bézieux [le président du Medef] parler de « croissance sobre ». Là où le terme de décroissance est beaucoup plus compliqué à récupérer.
Comment rendre cette sobriété souhaitable, dans une société où le bonheur reste associé à la consommation ? Comment changer d’imaginaire ?
Le changement des mentalités est déjà en cours. En juin 2021, l’Ademe [l’Agence de la transition écologique] a publié un dossier montrant que 83 % des Françaises et des Français aspirent à plus de sobriété.
Les comportements ont déjà commencé à évoluer autour de l’usage du vélo, d’une nouvelle alimentation ou d’un autre rapport au voyage. Je crois que l’été que nous avons vécu et la période de sécheresse que nous traversons toujours sont des accélérateurs de prise de conscience.
Nos sociétés du « toujours plus » génèrent aussi un épuisement physique et psychique.
Nos sociétés organisées autour du « toujours plus »génèrent aussi un épuisement physique et psychique. Les gens aspirent à ralentir, à retrouver du sens au travail, à s’épanouir dans leurs activités. Dans les faits, la sobriété heureuse est déjà attendue par les citoyennes et les citoyens.
Alors, la question, c’est : pourquoi n’arrivons-nous pas tous à aller plus loin ? Tout le monde ne peut pas passer à la sobriété aujourd’hui. Nous sommes grandement dépendants d’un système économique, d’un système technicien fait de voitures et de machines numériques. Faire un pas de côté vers la sobriété est encore difficile pour beaucoup de personnes. D’où la nécessité d’ouvrir ce débat, d’identifier les points de blocage et de proposer collectivement des pistes politiques pour avancer.
Ralentir, questionner son rapport au travail, c’est un luxe. La sobriété est-elle une question de privilégiés ?
La sobriété ne s’applique pas de manière égale à toutes et tous. Lorsqu’elle est comprise dans la logique de « faire moins », elle vaut essentiellement pour les plus riches. Pour les plus modestes, elle consiste plutôt à retrouver un seuil de dignité de vie, d’autonomie, d’estime de soi, de solidarité.
Nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à nous extraire du système dominant. Si j’ai pu me réapproprier des pans entiers de ma vie, c’est parce que j’ai eu la chance d’avoir des jobs bien rémunérés, de mettre de l’argent de côté et de rencontrer les bonnes personnes qui m’ont permis d’expérimenter des modes de vie alternatifs sans prendre de risques.
Qui dit sobriété dit produire moins, ce qui nécessite moins d’emplois rémunérés dans la logique du système actuel. Dans une société organisée autour du travail, la sobriété toute seule n’est pas suffisante. Il faut repenser ce contrat social noué autour du travail, qui invisibilise des tâches essentielles, souvent prises en charge par les femmes, et déconsidère l’engagement associatif.
La séquence autour de la réforme des retraites nous le montre bien. Le mot « retraite », déjà, impose un biais sémantique intéressant puisqu’il sous-entend qu’on se retire de la société. Pourtant, la grande majorité des retraités restent actifs, notamment dans la vie associative.
En pleine réforme des retraites, cette aspiration à ralentir se heurte aussi au discours du gouvernement qui impose de travailler plus longtemps.
Sur le travail, on a retrouvé un certain nombre de concepts qui appartiennent à l’ancien monde, auquel toute une élite reste très attachée pour deux raisons. D’abord parce qu’elle est la grande gagnante de ce système, mais aussi parce qu’il y a une véritable religion de la croissance. Il n’y a pas de hasard si, dans leurs discours de politique générale, Jean Castex puis Élisabeth Borne disent ne pas croire en la décroissance, mais en la « croissance verte », en la « croissance durable ». On est vraiment dans une logique de croyance et non d’argumentation rationnelle.
Il y a un retour très conservateur à la valeur travail et, derrière, la volonté de maintenir à flot un système qui s’effondre.
Au sujet du travail, c’est un peu pareil. Il est très difficile d’ouvrir un débat sur le sens du travail et la place du temps libre. Il y a un retour très conservateur à la valeur travail et, derrière tout ça, la volonté de maintenir à flot un système qui est en train de s’effondrer d’un point de vue économique, social, politique et environnemental. La sobriété a aussi vocation à questionner ces croyances et ces concepts toxiques.
Vous avez quitté Paris et votre emploi de responsable de la sécurité ferroviaire de la gare d’Austerlitz il y a un peu plus de dix ans, pour vous installer à Budapest. Pour quelles raisons ?
À l’époque, j’étais pris dans de nombreuses contradictions. D’un côté, c’était merveilleux de participer à l’organisation d’une grande gare ferroviaire où se passent tous les jours de belles histoires, où on est dans le voyage permanent, d’où on a fait partir des trains de nuit à une époque où ils étaient en train de disparaître.
Mais, d’un autre côté, une grande gare parisienne propose un système palliatif à un urbanisme totalement délirant, où les gens sont poussés à aller habiter toujours plus loin pour avoir des conditions de vie décentes. Dans ce trafic journalier, il y avait le RER C, les trains qui venaient d’Orléans ou de Tours, dont les gens descendaient fatigués pour venir travailler à Paris.
J’ai fini par ressentir une forme d’épuisement et je suis parti m’installer en Hongrie. Budapest est une grande ville cosmopolite qui a vécu ces cinq cents dernières années sous occupation étrangère ou dictature et a donc développé toute une culture de résistance par le contournement.
À la fin des années 2000, la société civile budapestoise est extrêmement dynamique et fait naître un réseau de lieux alternatifs. C’est dans ce contexte que j’ai travaillé pendant quatre ans à l’ambassade de France puis que j’ai cofondé le projet Cargonomia avec quatre autres personnes. Le but était d’expérimenter la décroissance en nous appuyant sur nos savoir-faire et ceux de nos réseaux les plus proches.
La sobriété, ce n’est pas seulement éteindre la lumière en sortant de sa chambre. C’est une réflexion engagée.
Nous avons commencé par une ferme bio à proximité de Budapest, en essayant de recréer des liens de solidarité entre la ruralité et la ville. Nous sommes aussi un peu précurseurs de l’utilisation des vélos cargos. En 2015, nous avons réuni ces deux piliers autour d’une coopérative et d’un petit centre logistique pour transporter des paniers de légumes avec les vélos cargos. C’était un lieu merveilleux, avec des traiteurs en vente directe, une boulangerie bio et des espaces pour accueillir des artistes.
Nous avions signé un bail de cinq ans pour louer cet espace mais, entre-temps, l’essor du tourisme de masse dans cette ville a fait exploser les prix de l’immobilier. Notre loyer a été multiplié par trois, en pleine pandémie, alors nous n’avons pas pu poursuivre le projet à cet endroit. Aujourd’hui, cependant, nous avons toujours cinq espaces à Budapest : des bureaux partagés, un atelier vélo, un bar alternatif et deux jardins, en permaculture pour l’un et en agroforesterie urbaine pour l’autre.
On entend de plus en plus parler d’écofascisme, cette tendance à l’accaparement du discours écologiste par l’extrême droite. Vous êtes arrivé en Hongrie au moment où Viktor Orbán devenait Premier ministre : que fait vraiment l’extrême droite pour l’environnement une fois au pouvoir ?
Sur ces questions-là, aussi bien environnementales qu’économiques, Orbán mène exactement la même politique que Macron. Il est en train de se réapproprier le discours écologiste, non pas au travers de l’écofascisme mais au travers du greenwashing. Il veut faire de la Hongrie la plateforme européenne de fabrication de batteries pour les véhicules électriques, en allant chercher le soutien financier de l’industrie automobile allemande, sud-coréenne et chinoise (2).
À Debrecen, deuxième ville de Hongrie, le géant chinois de la production de batteries CATL a annoncé en août dernier l’installation de la plus grande usine de fabrication de batteries électriques d’Europe. Un projet énergivore et consommateur d’eau, qui comporte aussi des risques de contamination des sols et des nappes phréatiques par des substances toxiques.
Fabriquer ces batteries nécessite une quantité monstrueuse d’eau et, en période de choc hydrique, cela a fait naître un mouvement de résistance à ce projet. Viktor Orbán le justifie pourtant avec le même type de narration que l’on trouverait dans la bouche d’Emmanuel Macron : les batteries sont une innovation technique qui va créer de l’emploi et de la croissance verte.
La sobriété, ce n’est pas seulement éteindre la lumière en sortant de sa chambre. C’est une réflexion engagée, humaniste et émancipatrice. Pour éviter une réappropriation de ces idées, il faut continuer à les politiser.
Quant à la récupération par l’extrême droite des idées de décroissance et de sobriété, il y a eu des tentatives de la part de certains idéologues mais, en général, ça ne va pas loin. Les dirigeants d’extrême droite restent avant tout des néolibéraux. La décroissance fait le lien avec des mouvements émancipateurs, de solidarité, d’hospitalité envers les réfugiés climatiques, qui seront de plus en plus nombreux. Des valeurs étrangères à l’extrême droite.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »
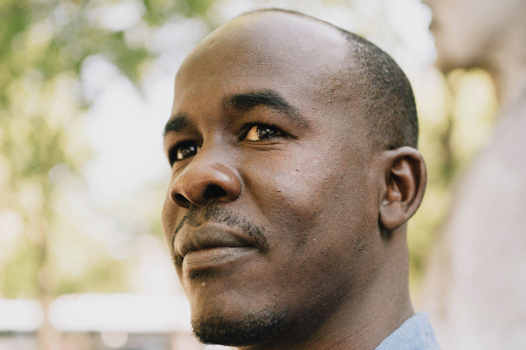
Hamad Gamal : « On se demande si nos vies de Soudanais comptent autant que les autres »

François Sarano : « Il y a une vraie lueur d’espoir pour les océans si on s’en donne les moyens »