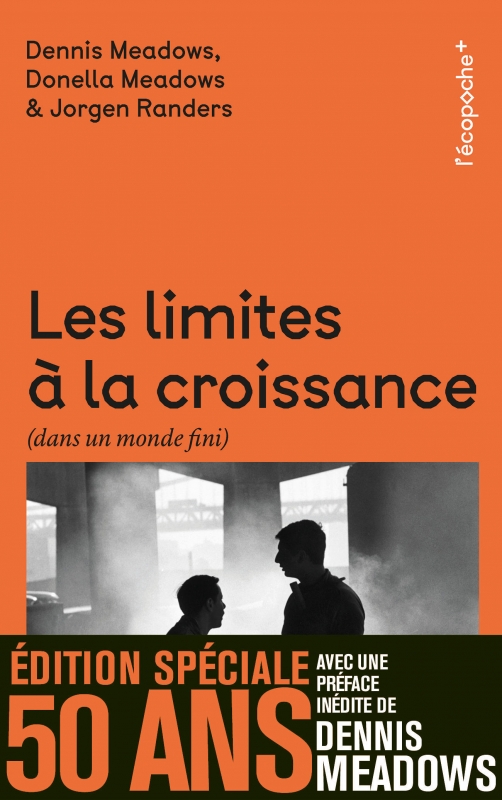Une planète qui bascule
Plus encore que le réchauffement climatique, les limites planétaires, peu connues, constituent des indicateurs du caractère systémique des dégradations écologiques et invitent à repenser nos modèles, à l’heure de la COP 27.
dans l’hebdo N° 1731 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
Éco-anxiété : tempête dans les têtes Écologie : « Il faut mettre en œuvre une sobriété systémique »En 1972, le rapport intitulé « Les limites à la croissance » – plus connu sous le nom de « rapport Meadows » – alertait déjà sur la finitude des ressources terrestres. À la demande du Club de Rome, une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) – dont Dennis et Donella H. Meadows – modélisa les impacts de l’activité humaine sur la planète afin de visualiser les différents scénarios d’une croissance physique exponentielle dans un monde fini.
Sa conclusion était limpide : il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. L’écho de ce rapport a été très important et a suscité de nombreuses critiques – de la part des élites politiques, mais aussi de certains économistes, sur la méthodologie, sur la fiabilité des données de l’étude et, surtout, sur les potentielles conséquences de ses conclusions.
Lire aussi > Éco-anxiété : tempête dans les têtes
L’année suivante, le premier choc pétrolier tend à confirmer que les énergies fossiles sont limitées, mais la foi en de nouveaux gisements et de nouvelles technologies aveugle toujours la planète. Cinquante ans plus tard, le rapport Meadows est devenu une référence théorique, mais n’a pas servi de détonateur pour les décideurs politiques.
« N’importe lequel des systèmes de gouvernance pourrait potentiellement créer un meilleur avenir pour l’humanité si seulement il s’intéressait à l’équité, à l’environnement, à la résilience et au bien-être […]. Il y a cinquante ans, je pensais naïvement que notre rapport motiverait les dirigeants à adopter une vision à plus long terme. Il a échoué sur ce point », confie Dennis Meadows dans la préface de la nouvelle version du rapport (1).
Points de bascule
Pourtant, leur scénario du business as usual semble se confirmer au cours des dernières décennies, et les limites planétaires censées sonner une ultime alarme sont franchies les unes après les autres, dans une sorte d’apathie générale.
En 2009 a lieu une nouvelle tentative de donner un indicateur inédit pour alerter les dirigeants sur la nécessité d’agir en créant le cadre des limites planétaires.
Des scientifiques du Stockholm Resilience Center ont quantifié les risques liés aux perturbations anthropiques et identifié neuf paramètres vitaux, avec des seuils à ne pas franchir pour préserver l’écosystème terrestre : climat, biodiversité, ozone stratosphérique, cycles biochimiques, eaux douces, acidité de l’océan, utilisation des terres, aérosols dans l’atmosphère et « entités nouvelles ».
Quatre de ces limites planétaires, et pas des moindres, sont dépassées depuis 2015 : celles du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité, de la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, ainsi que le changement rapide d’usage des sols. Cette année, de nouvelles données révèlent que le cycle de l’eau, plus particulièrement l’eau verte qui est absorbée par les végétaux et contenue dans l’eau douce, a atteint un seuil inédit.
Lire aussi > Il n’y a plus d’eau de pluie potable sur Terre
Et pour la première fois, des chercheurs européens ont évalué la quantité d’« entités nouvelles » (telles que les pesticides ou les microplastiques) introduites dans l’environnement par l’homme et concluent que « l’humanité opère actuellement en dehors des limites planétaires » pour ces pollutions.
Les limites planétaires mettent en évidence la nécessité de la décroissance, car nous rendons la Terre inhospitalière et inhabitable.
« Les limites planétaires doivent devenir un référentiel pour les politiques et dans notre culture commune, parce qu’elles montrent le côté systémique des dégradations écologiques. Le climat n’est qu’un problème parmi d’autres, même s’il est majeur, analyse le philosophe Dominique Bourg. Elles mettent en évidence la nécessité de la décroissance, car nous rendons la Terre inhospitalière et inhabitable. »
Sur le plan théorique, les limites planétaires sont connues et régulièrement citées. En 2011, Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations unies, déclarait aux dirigeants du monde : « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux. »
En France, le rapport 2019 sur l’état de l’environnement du ministère de la Transition écologique et solidaire consacrait un chapitre à la question, précisant que, par sa consommation ramenée proportionnellement à l’échelle du globe, le pays dépasse six des neuf limites planétaires. Mais elles ne constituent toujours pas le cadre prioritaire de l’action politique.
Lire aussi > « Il faut mettre en oeuvre une sobriété systémique »
« Le référentiel des limites planétaires démontre qu’il n’y a pas de solutions techniques simples, car elles auront toujours des effets sur d’autres variables. Si on a recours à la géo-ingénierie ou à des techniques de refroidissement du climat, cela engendrera des effets en chaîne sur la biodiversité, la biosphère, etc. », détaille Aurélien Boutaud, docteur en sciences de la Terre et de l’environnement, et consultant indépendant (2).
Pour lui, la notion primordiale est celle des points de bascule, même s’il est encore impossible de les situer précisément. « C’est comme sur un lac gelé : l’épaisseur de glace est de plus en plus fine en s’éloignant du bord. Plus vous avancez, plus les probabilités de casse sont grandes. Une fois que ça casse, c’est irréversible, explique-t-il. Sur le changement climatique, les scientifiques savent qu’au-delà de 350 parties par million (ppm) de CO2 dans l’atmosphère, une bascule s’opère. Nous sommes à 420 ppm, donc nous avons déjà franchi une frontière. »
Sans volonté politique, de simples baromètres
Aurélien Boutaud reconnaît l’importance de développer des indicateurs à l’interface des sphères scientifique et politique, comme les limites planétaires ou l’empreinte écologique. Mais sans volonté politique, ils resteront des baromètres, dégainés de temps en temps dans des discours ou des rapports.
Dans les années 1980, les alertes des scientifiques sur la dégradation de la couche d’ozone ont été entendues par la communauté internationale. En 1987, le protocole de Montréal était signé et engageait les pays à interdire les substances responsables de la destruction de la couche d’ozone, comme les chlorofluorocarbures (CFC) utilisés dans l’industrie du froid.
Les décideurs se disent encore que le changement climatique est un problème parmi d’autres, et pas le plus grand défi auquel l’humanité a été confrontée.
La réactivité politique a été facilitée par le fait que peu de secteurs économiques seraient impactés, contrairement aux changements radicaux et systémiques indispensables pour lutter contre le changement climatique. Les blocages politiques proviennent d’une vision dominante de la croissance économique comme seule ligne à suivre, mais aussi de l’incapacité à imaginer le futur au prisme des ravages écologiques.
« Les décideurs se disent encore que le changement climatique est un problème parmi d’autres, et pas le plus grand défi auquel l’humanité a été confrontée. Ils ne perçoivent pas ce qu’implique un réchauffement de 3, 4 ou 5 °C en termes de pertes humaines, souligne Aurélien Boutaud. D’autre part, ils fixent encore des objectifs de transition à l’horizon 2050, alors que les scientifiques affirment que tout se joue dans les cinq à dix ans à venir. »
La théorie du donut
Cette prise de conscience peut aboutir à des changements de paradigmes précieux. Pour son plan de relance post-confinement en 2020, la ville d’Amsterdam a décidé de s’inspirer de la théorie économique du donut, créée par l’économiste Kate Raworth et le Doughnut Economics Action Lab (Deal), et fondée sur deux limites : le plancher social – assurant les besoins sociaux fondamentaux des citoyens (l’accès à l’eau, aux soins de santé, à des logements sains) – et le plafond environnemental – se référant aux limites planétaires.
Sur le plan juridique, la Convention citoyenne pour le climat, lancée par Emmanuel Macron, avait défendu l’inscription dans le droit français des limites planétaires et du crime d’écocide, ainsi que la création d’une Haute Autorité des limites planétaires (Halp), une instance supra-ministérielle indépendante chargée de contrôler que chaque loi, règlement ou projet industriel est compatible avec ces références. Malgré des soutiens politiques et au sein de l’administration, cette proposition a été exclue de la loi climat et résilience, votée en 2020.
Lire aussi > « Emmanuel Macron intoxique le débat climatique »
_« Le droit de l’environnement reconnaît déjà le concept de limites planétaires puisqu’il est présent dans la loi relative au gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire. Nous avons désormais besoin d’__une instance capable de s_’_en saisir pour en faire une nouvelle grille de lecture pour nos politiques territoriales. Car il y a aujourd’hui des tas de projets incompatibles avec ces limites planétaires, notamment ceux liés à l’activité minière en Amazonie »_, décrypte Marine Calmet, juriste et cofondatrice de l’organisation Wild Legal.
Il ne faut plus parler isolément de climat ou de biodiversité, mais mettre en lumière une vision globale et systémique des problèmes.
Elle est convaincue que cette idée n’est pas totalement abandonnée, mais demande du temps et des moyens afin que soit pensé et développé un outil juridique adapté. La prise de conscience citoyenne devra passer par un effort de pédagogie de la part des militants, des associations et des médias qui s’empareront de ce sujet.
« Il ne faut plus parler isolément de climat ou de biodiversité, mais mettre en lumière une vision globale et systémique des problèmes », souligne Audrey Boehly, autrice du podcast « Dernières limites » (3), qui décortique le contenu du rapport Meadows, les débats sur la croissance économique et les enjeux des limites planétaires au sens large.
Lire aussi > Climat : les journalistes face à leurs responsabilités
Cette ingénieure de formation et journaliste scientifique a reçu une claque en découvrant récemment le rapport Meadows : premier choc de n’avoir jamais entendu parler de ce texte, deuxième choc en prenant conscience des effets en cascade des ravages écologiques. Elle compte désormais transmettre cela au plus grand nombre : « Nous avons besoin d’une masse critique de citoyens pour infléchir les politiques publiques et porter le message que nous vivons dans un monde fait de limites, et non dans un monde d’abondance ! »
(1) Les Limites à la croissance (dans un monde fini)_, éd. Rue de l’échiquier, mars 2022.
(2) Coauteur, avec Natacha Gondran, des Limites planétaires_, éd. La Découverte, 2020.
(3) Podcast menant l’enquête en treize épisodes, à écouter sur toutes les plateformes : smartlink.ausha.co/dernieres-limites
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes
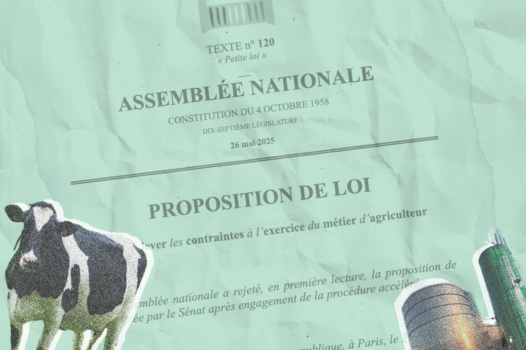
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides