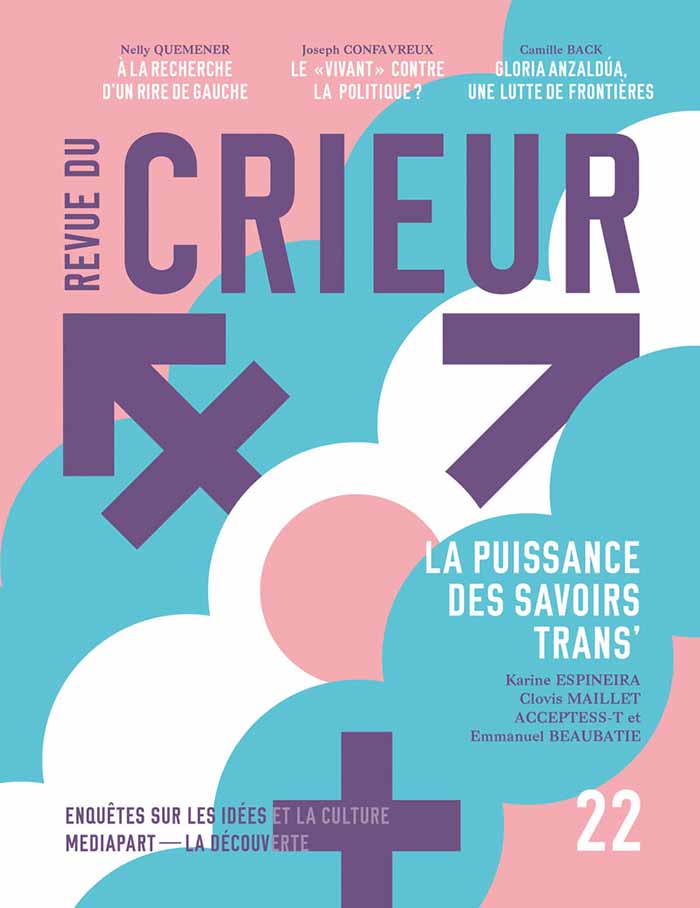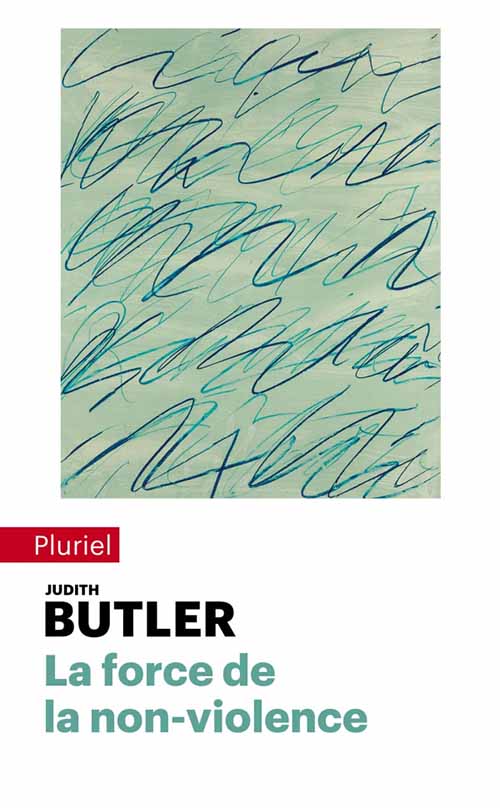La « vue sur mer » confisquée
Fruit d’une « recherche-action » sur l’évolution sociale et immobilière de Douarnenez, un ouvrage mené par un collectif d’habitants a analysé le phénomène du tout-tourisme dans cette ville côtière bretonne.
dans l’hebdo N° 1753 Acheter ce numéro

© FRED TANNEAU / AFP.
Habiter une ville touristique. Une vue sur mer pour les précaires, collectif Droit à la ville Douarnenez, préface de Mickaël Correia, Éditions du Commun, 256 pages, 16 euros.
« Dans un territoire touristique, c’est une question comme celles des résidences secondaires qui tend à exacerber la violence des inégalités sociales. La violence de ne pas pouvoir accéder à un logement quand quelqu’un d’autre peut posséder et jouir de deux maisons, pour le plaisir. »
C’est celle des « volets fermés », visibles dans chaque rue, qui indiquent que tant de maisons ne sont ouvertes en ville que quelques semaines par an, en général l’été. Or, comment un territoire peut-il vivre dans ces conditions, quand toujours plus de propriétés immobilières en son sein soulignent qu’en fait ses « habitants » ne vivent pas là…
Par ce travail remarquable d’enquêtes et d’interviews auprès des Douarnenistes qui, toujours plus précaires, assistent à la transformation de leur petite ville et à la « confiscation » de leur « vue sur mer », le collectif Droit à la ville Douarnenez décrit comment leur cité bien-aimée se voit réduite à une « marchandise » par une systématique et quasi-exclusive « mise en tourisme », se traduisant par des « violences sociales » et des « rapports de domination » toujours plus aigus. Ou comment, jour après jour, le modèle de la « start-up nation », chère à Macron (et à d’autres), supprime, ou efface, les « usages populaires » de la ville.
« Mais vous vivez ici, l’hiver aussi, vous ? »
Disparition des commerces de proximité, apparition de « galeries », d’espaces de « coworking », construction de parkings (vides la plupart des mois de l’année), piétonnisation des rues du centre-ville avec force pavés en granit… l’ancienne petite cité ouvrière et sardinière du Finistère-Sud a été profondément bouleversée ces dernières années.
La presse locale salue d’ailleurs régulièrement ce « regain d’activité » et, surtout, le « boom de l’immobilier » dans cet ancien port sardinier « désormais bien intégré aux circuits de vacances ».
Notaires, promoteurs et agents immobiliers, commerçants, propriétaires de meublés touristiques, tous se réjouissent, se frottent les mains : grâce à ce « raz-de-marée », les capitaux affluent, les prix augmentent, « l’attractivité » du territoire progresse.
Mais, revers de la médaille, l’enquête montre surtout que les Douarnenistes doivent se résigner à « accepter une autre vie » (car « sans apport, face à des investisseurs qui payent cash »), à « partir ailleurs, et d’abord “en retrait du littoral” ».
L’une des plus improbables leçons du travail de ce collectif, qui a emprunté son nom au livre du philosophe marxiste Henri Lefebvre, Le Droit à la ville (Seuil, 1968), réside dans les réflexions glanées dans les queues des magasins, lancées par les nouveaux propriétaires (des résidences secondaires). Comme celle-ci : « Mais vous vivez ici, l’hiver aussi, vous ? Douarnenez, c’est chouette quand il fait beau, quand il y a plein de gens. Mais l’hiver… »
Colonisation lente
Cette recherche, menée auprès de la population qui assiste à cette sorte de colonisation lente, mais non moins violente, de leur cadre de vie, montre bien comment une certaine classe possédante ne recule devant rien pour prendre possession de leur environnement.
Résister collectivement aux volets fermés comme aux ghettos dorés.
Car Douarnenez « n’est pas soumise à un processus naturel, ni à une abstraite loi du marché ou une inévitable gentrification » : la violence de cette prise de possession de la ville et de son habitat, si typique des politiques néolibérales et surtout de la Macronie, apparaît dans toute son insouciance vis-à-vis des « premiers de corvée ».
Cet essai est donc aussi une mise en lumière de la nécessité de la « conflictualité sociale au sein des questions urbaines ». Celle de « renouer avec la revendication d’un droit à l’émancipation par l’urbain ». Et « à résister collectivement aux volets fermés comme aux ghettos dorés »…
Les ouvrages de la semaine
« La puissance des savoirs trans », Revue du crieur, n° 22, La Découverte/Mediapart, 160 pages, 15 euros.
Au cœur de nombreuses paniques morales portées par la droite réactionnaire, la transidentité est l’objet de beaucoup de fantasmes bien éloignés de la réalité. Pourtant, dans le champ de la recherche universitaire, nombre de penseur·ses trans questionnent leurs propres identités et leurs enjeux. Loin des plateaux de CNews, la Revue du crieur consacre le cahier central de son édition d’avril à la puissance des savoirs trans, un dossier notamment porté par deux excellents articles, celui de la sociologue Karine Espineira autour de la légitimité des intellectuel·les trans à travailler sur ce sujet, et celui du collectif Acceptess-T, manifeste pour un accès à la santé, vital pour cette communauté, et à sa compréhension.
La fin des monstres. Récit d’une trajectoire trans, Tal Madesta, La Déferlante Éditions, 112 pages, 15 euros.
Voilà une bonne nouvelle ! L’excellente revue féministe La Déferlante lance sa maison d’édition. Pour « prolonger des compagnonnages entamés dans les pages de la revue » dans des formats plus longs. Ce projet s’ouvre avec un texte aussi émouvant qu’engagé, retraçant l’itinéraire d’une « trajectoire trans », celui du journaliste Tal Madesta. Son récit documente la redéfinition de « son rapport à soi, aux autres, au monde social », mais aussi « l’expérience désolante de la violence transphobe ». Et c’est toute cette « révolution intime », entre rage et liberté, qui fait aussi de son livre un formidable plaidoyer pour l’émancipation des personnes trans.
La force de la non-violence. Une obligation éthico-politique, Judith Butler, traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Jaquet, « Pluriel », 256 pages, 10 euros.
Est-on empli de colère, il est souvent difficile de s’y tenir. C’est pourtant toute la force de cette réflexion de Judith Butler que de nous en convaincre. À l’heure où il est tentant de céder à son envie de violence, notamment face à la surdité hypocrite d’un pouvoir retors à toute négociation, la philosophe rappelle que la non-violence n’est « ni la passivité, ni le renoncement à l’action », ni un « pacifisme naïf, ni l’aspiration inconséquente à une forme de pureté morale ». C’est au contraire un « idéal », mais aussi une exigence « éthico-politique » s’appuyant sur les pensées de Freud, Benjamin, Arendt ou Foucault, telle une vraie « rupture avec le monde et ses propres impulsions ». En somme, une « éthique » fondée sur l’égalité et l’anti-individualisme.
Pour aller plus loin…

L’Union Désastre

Des essais pour l’été

« Les Penn sardin savaient trouver la joie dans la misère »